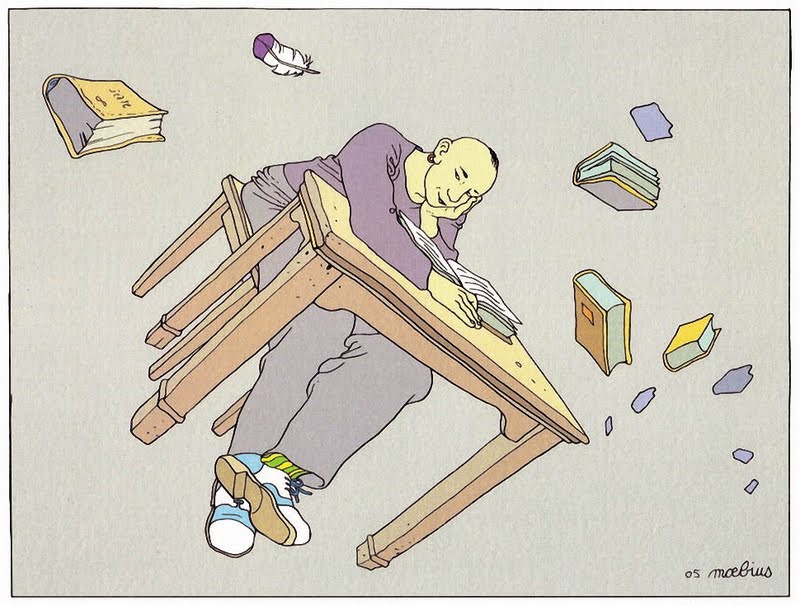Ceci n’est pas un blog très « fun ». C’est essentiellement le support qui me permet de transmettre à mes élèves de terminales , au lycée George Sand, de Nérac, une version complète de leurs cours, qui peut leur permettre de préciser leur prise de notes et d’en colmater éventuellement les brèches. Curieux et passants: vous êtes bienvenus…mais l’austérité du style vous le rappellera bien vite: ceci est un instrument de travail.
La Religion
Deux étymologies pour le mot « religion » : relegere signifiant « relire » et religare signifiant « relier ». Lucrèce dans son De Rerum natura l’étymologie religare déclare : « je viens défaire les nœuds dont la religion nous entrave »
- La religiosité est-elle une dimension essentielle de l’homme ?
1) La spiritualité : une dimension essentielle ?
Est-ce que, si l’homme perdait totalement tout sens du religieux, il s’appauvrirait ?
On a peut-être raison de voir trois parties dans l’homme :
- le corps
- l’intelligence
- l’âme, elle-même divisée en deux composantes : sensibilité/ spiritualité
Ce qui nous amène à nous interroger sur les conséquences d’une perte possible de la spiritualité : si l’homme devenait complètement « sourd » à cette composante, perdrait-il quelque chose de lui-même ?
- Marcuse pose la question dans L’homme unidimensionnel : est-ce qu’une civilisation complètement matérialiste et technicienne est une civilisation où l’humain, dans l’homme, s’appauvrit ?
Est-ce que la déchristianisation n’entraine pas la médiocrité d’une époque « sans âme » ?
L’homme peut-il facilement se passer de l’affirmation d’un Absolu, d’une Transcendance ?
2) Universalité du sentiment religieux
Ne pas réfléchir au niveau de l’individu : beaucoup de personnes se passent de toute forme de spiritualité. Mais ce n’est plus vrai au niveau de l’espèce : toutes les sociétés humaines connues développent des formes de croyance religieuse.
Henri Bergson : « On trouve des sociétés qui n’ont ni science, ni art, ni philosophie. Mais il n’y a jamais eu de société sans religion ».
Toute la différence, c’est la proportion des athées et des croyants dans une société donnée. Mais la religion existe partout dans le monde.
D’ailleurs, si les religions établies perdent leur crédibilité, les sectes prennent le relai, comme si le besoin religieux de certains devait absolument trouver un débouché.
Quelles différences faites-vous entre sectes et religions ?
| RELIGION | SECTE |
| Pratique majoritaire | Pratique minoritaire |
| légitimité | Mal vue, dénigrée |
| officialité | Secret, caractère occulte, initiation |
| prosélytisme | |
| intéressement | |
| Dieu : un être abstrait | Dieu : un humain vivant, contemporain |
| Absence de respect du croyant (pratiques contraignantes, aliénantes) : endoctrinement, conditionnement | |
On voit que toutes ces distinctions sont relatives : certaines religions s’apparentent beaucoup à des sectes / certaines sectes sont aussi respectables que des religions.
On serait même assez tentés de dire que les religions sont des « sectes qui ont réussi » (cf. les persécutions subies par les premiers chrétiens, quand ils n’étaient qu’une poignée d’ « allumés » dont le leader était Jésus Christ)
De plus, les sociétés qui sont les plus éloignées de la religion de leur origine (nos sociétés occidentales déchristianisées) sont encore tout imprégnées de rites qui sont le témoin d’un besoin de type religieux :
Texte de Mircea Eliade (historien des religions, d’origine roumaine) Le Sacré et le Profane ; 1957 (Hatier p 196 / photocopie) :
- Proposez un titre
- Mircea Eliade pense-t-il que la religion est essentielle à l’homme ? Pourquoi ?
« La majorité des « sans-religion » se comportent encore religieusement, à leur insu. Il ne s’agit pas seulement de la masse des « superstitions » ou des « tabous » de l’homme moderne, qui ont tous une structure et une origine magico-religieuse. Mais l’homme moderne qui se sent et se prétend areligieux dispose encore de toute une mythologie camouflée et de nombreux ritualismes dégradés. Comme nous l’avons mentionné, les réjouissances qui accompagnent la Nouvelle Année ou l’installation dans une maison neuve présentent, laïcisée, la structure d’un rituel de renouvellement. On constate le même phénomène à l’occasion des fêtes et des réjouissances accompagnant le mariage ou la naissance d’un enfant, l’obtention d’un nouvel emploi, une promotion sociale, etc. […]
En somme la majorité des hommes « sans-religion » partagent encore des pseudo-religions et des mythologies dégradées. Ce qui n’a rien pour nous étonner, du moment que l’homme profane est le descendant de l’homo religiosus et ne peut pas annuler sa propre histoire, c’est-à-dire les comportements de ses ancêtres religieux, qui l’ont constitué tel qu’il est aujourd’hui. D’autant plus qu’une grande partie de son existence est nourrie par des pulsions qui lui arrivent du tréfonds de son être, de cette zone qu’on a appelée l’inconscient. […]
[…] dans la mesure où l’inconscient est le résultat des innombrables expériences existentielles, il ne peut pas ne pas ressembler aux divers univers religieux. Car la religion est la solution exemplaire de toute crise existentielle, non seulement parce qu’elle est indéfiniment répétable, mais aussi parce qu’elle est considérée d’origine transcendantale et, en conséquence, valorisée en tant que révélation reçue d’un autre monde, transhumain. La solution religieuse non seulement résout la crise, mais en même temps rend l’existence « ouverte » à des valeurs qui ne sont plus contingentes ni particulières, permettant ainsi à l’homme de dépasser les situations personnelles et, en fin de compte, d’accéder au monde de l’esprit.
[…] l’homme areligieux des sociétés modernes est encore nourri et aidé par l’activité de son inconscient, sans pour autant y accéder à une expérience et à une vision du monde proprement religieux. L’inconscient lui offre des solutions aux difficultés de sa propre existence, et dans ce sens il remplit le rôle de la religion, car, avant de rendre une existence créatrice de valeurs, la religion en assure l’intégrité. En un certain sens, on pourrait presque dire que, chez ceux des modernes qui se proclament areligieux, la religion et mythologie se sont « occultées » dans les ténèbres de leur inconscient – ce qui signifie aussi que les possibilités de réintégrer une expérience religieuse de la vie gisent, chez de tels êtres, très profondément en eux–mêmes. »
Mircea Éliade, Le Sacré et le Profane, 1957, Gallimard, coll. « Folio essais », 1988, p. 173-180.
Un des intérêts de la religion : être pris dans un sens collectif : plutôt que de laisser à l’individu la tâche écrasante de donner du sens à sa vie, la religion met à la disposition de tous une sorte de « grille de lecture » collective (fut-elle négative cf. le péché) qui relie l’individu à l’humanité toute entière.
Bergson : « Certains, sans doute, sont totalement fermés à l’expérience mystique, incapables d’en rien éprouver, d’en rien imaginer. Mais on rencontre également des gens pour lesquels la musique n’est qu’un bruit »
On peut avoir cette « sensibilité », ce besoin d’absolu, sans jamais avoir entendu parler de religion (ce besoin va alors s’investir ailleurs) ; on peut également avoir baigné dans une enfance religieuse et y être complètement hermétique : l’éducation n’y fait rien.
Si l’on suit Bergson, on en vient à déplorer la tristesse d’un monde uniquement rationnel, un monde sans infini, sans choses qui nous dépassent, sans « incompréhensible », sans énigmes (ou : dont les seules énigmes sont les lacunes de la science)
« La religion fait partie de la culture, non comme dogme ni même comme croyance mais comme cri »
Merleau-Ponty
Quelle échappatoire ? La poésie…le théâtre : l’art… : le sacré, le sens
Tout le problème est de savoir si l’homme suffit à épuiser l’ordre du sens ou s’il est obligé de postuler un autre ordre, par rapport auquel sa vie puisse prendre sens.
3) Suffisance ou insuffisance de la Raison humaine, de l’ordre du Réel ?
Si la Raison humaine suffit, on peut rester dans l’ordre de l’Immanence : la valeur est dans l’être. L’homme doit se suffire à lui-même. Ses possibilités résident en lui seul : le sens de la vie est à produire, pas à attendre « d’en haut ».
Si la Raison humaine ne suffit pas, l’accomplissement de l’homme se fait nécessairement dans un ordre qui le dépasse : l’être (la vie vécue) est coupé à jamais de la Valeur. On voit déjà ceci à l’œuvre dans la théorie platonicienne des Idées, sans même que l’idée d’un dieu intervienne.
L’idée religieuse par excellence, c’est l’idée d’une distinction entre le profane et le sacré.
Le PROFANE = le quotidien, la réalité empirique et connue. Il est neutre quant à la valeur.
Le SACRÉ = le domaine où toutes les conduites humaines sont codifiées très rigoureusement. Il est chargé de valeur (saturé de valeur) mais cette valeur est bipolaire : le sacré est tantôt infiniment désirable, tantôt terriblement dangereux. Il est à la fois un domaine interdit (au risque d’être « profané ») et un domaine promis (l’objet d’une espérance).
Dans quelle mesure ne peut-on pas dire qu’une scène de danse, que les planches d’un théâtre, ne représentent pas, eux aussi, une expérience du sacré ? Nul n’est autorisé à s’y produire que les « officiants » (les artistes). Dans la salle, chacun est silencieux et recueilli (attend, pour tousser, qu’il y ait un « blanc » dans le spectacle).
Edward Bond : « Le théâtre partage ses limites avec la religion. La religion n’est que du théâtre qui veut être vrai »
Cette idée du sacré s’accompagne souvent d’une inversion : dans un lieu sacré, pendant une période sacrée, l’humain est régi par d’autres lois que profanes : ainsi, le sacrifice renverse l’interdit du meurtre. Les sacrifices rituels constituent toujours une transgression de l’interdit du meurtre (la loi commune est, momentanément, niée). Dans le christianisme, on peut se demander s’il y a une abolition des sacrifices ou leur consécration : le Christ s’est sacrifié pour son peuple. L’eucharistie peut être vue comme une sorte de cannibalisme symbolique : le chrétien mange, rituellement, régulièrement, le corps de son dieu (« Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang »)
Parlons un peu du cannibalisme. En progressant, l’ethnologie a découvert que le cannibalisme n’a jamais été ce qu’on avait d’abord pensé : un moyen commode de faire le plein en protéines animales. Le cannibalisme est presque toujours cannibalisme sacré (l’expression est de G. Bataille) : ainsi, en Nouvelle-Guinée, les femmes mangent les hommes, dans la Maison des hommes (à laquelle elles n’ont pas accès en temps normal). Elles mangent des parties précises, en fonction de leur lien de parenté avec le mort et de leur position sociale dans la tribu). Elles le font pour s’approprier (et donc transmettre) les qualités spirituelles et morales du mort. Il n’est donné qu’aux meilleurs d’être mangés.
4) Le religieux et le surnaturel
La religion repose sur l’idée du surnaturel …mais tout ce qui est surnaturel ne relève pas du religieux.
De même, il y a une partie, dans la religion, qui échappe au surnaturel : son inscription dans l’institution (la hiérarchie ecclésiastique, le pouvoir politique des dignitaires religieux).
Un exemple de surnaturel : la magie
Chez les peuples qui pratiquent la magie, elle est une action hallucinée où nous mimons une action réelle que nous ne pouvons pas accomplir, en invoquant une puissance de la nature qui confèrera une efficacité réelle à notre action symbolique (pratique vaudoue de la « transe du faiseur de pluie »). L’homme prétend agir (à distance) sur les éléments.
Dans la magie, l’homme refuse donc son impuissance.
Dans la religion au contraire, dans la prière, l’homme s’humilie comme impuissant. Et se contente de demander, humblement. Ce sont deux attitudes complètement différentes.
Quels sont les phénomènes surnaturels auxquels vous pouvez penser ?
Tables tournantes, voyance, prémonition, hypnose, ovnis
La religion, c’est quelque chose de bien précis. Il faut :
- un dogme (une doctrine)
- une morale
- un culte
- une assemblée de croyants
- une relation personnelle avec un Etre Surnaturel Unique (ou : avec des êtres surnaturels)
II. Interprétations (critiques) de la religion (T ES : Nietzsche, Sartre, Freud)
- Feuerbach(XIXème, matérialisme athée)
L’homme a créé Dieu : il a érigé en objet son essence propre. La religion est une scission de l’homme avec lui-même. Il a posé Dieu en face de lui, comme un Être opposé à lui.
Pour se libérer du sentiment de ses limites, l’homme imagine un être parfait, qui possède précisément ce qui lui manque.
C’est comme si l’homme faisait deux parties de sa propre essence : l’une, négative, qu’il reconnaît comme lui-même. L’autre, positive, qu’il appelle Dieu et dans laquelle il s’aliène :
Ce que l’homme est : fini, imparfait, temporel, impuissant = humain
Ce que l’homme n’est pas : infini, parfait, éternel, tout-puissant = divin
Mais en vérité, c’est sa propre essence que l’homme adore.
Pour Feuerbach, la vraie séparation est : ce qui appartient à l’individu / ce qui appartient à l’espèce. A Dieu, on a prêté les caractéristiques de l’espèce : la somme des perfections des individus.
La force, et le paradoxe, du Christianisme est le suivant : Dieu a un double caractère : il a toutes les perfections du genre + il est conçu comme un individu (une sorte de Sur-personne).
Feuerbach propose de substituer à cette religion de Dieu une « religion de l’Homme ». Elle serait basée sur l’amour de l’homme pour l’homme. L’idée est de faire cesser cette hypocrisie par laquelle l’homme s’adore dans Dieu : autant qu’il s’adore de manière plus directe.
2. Nietzsche
Généalogie de la morale (vx Russ p 411): La religion est ce mensonge qui transforme la faiblesse en mérite, l’impuissance en bonté, la crainte en humilité, la lâcheté en patience, en vertu.
Les croyants sont des « faux monnayeurs » (roman de Gide en 1925)
Cette « officine où l’on fabrique l’idéal » sent le mensonge à plein nez.
Texte 15 p 388(Russ) : la mort de Dieu/ Hatier : 15 p 197 : Ecce homo
Ici, Nietzsche part d’un constat : Dieu est mort !
Cependant, cet événement est ambigu : il libère les philosophes et les « esprits libres » : « l’horizon nous semble de nouveau libre »
En même temps, l’humanité porte la culpabilité de sa mort (« c’est nous qui l’avons tué ») : l’acte est insensé, énorme, peut-être prématuré : l’homme est orphelin.
Il nous reste à devenir nous-mêmes des dieux pour être à la hauteur de cette action.
En même temps, c’est bel et bien une délivrance : l’idée de Dieu = la plus grande objection contre l’existence. Les « autres mondes » créés par les deux grandes religions universelles (le Bouddhisme et le Christianisme, Nietzsche ne parle jamais de l’Islam) sont synonymes de non-être, du non-vivre, de la volonté de ne pas vivre. En effet, ces religions condamnent le désir, le plaisir, la puissance. En elles, les instincts de décadence prennent le pas sur les instincts d’épanouissement : la Volonté de Néant triomphe de la Volonté de Puissance.
Or, Nietzsche est l’apôtre de la Volonté de puissance, non pas comprise comme la volonté d’être toujours le plus fort, mais celle de faire de toutes nos forces ce que nous faisons .
Ce qu’on appelle l’immoralisme de Nietzsche, c’est sa critique de la morale classique comme une « morale des moutons ». Avec l’aide de la religion, nous encensons la faiblesse afin de culpabiliser les forts. Nous le faisons, dans la mesure où nous ne sommes pas capables de la force (l’humilité chrétienne comme vertu cardinale).
De plus, le « tour de force » du Christianisme, c’est l’idée de la dette infinie : le Christ se proposait de « racheter les péchés » des hommes. Il voulait prendre sur lui la dette que nous avons envers notre créateur. Or, nous l’avons tué : la dette est devenue écrasante à jamais. L’homme est renvoyé à une éternelle culpabilité.
Nietzsche entend remplacer la morale religieuse, fondamentalement nihiliste, par la morale du Surhomme (l’homme n’est rien d’autre qu’une forme transitoire : un pont entre la bête et le surhumain).
N.B : Nihilisme = idéologie qui nie la notion de vérité absolue, de valeurs morales, et conteste la légitimité de la contrainte exercée sur les individus (anarchisme, amoralisme)
Du point de vue de la morale traditionnelle, Nietzsche est nihiliste / Nietzsche affirme que le vrai nihilisme est celui de la morale judéo chrétienne.
Dostoïevski, Les Frères Karamazov : « Si Dieu est mort, tout est permis » (Raskolnikov)
N’y a-t-il de morale que garantie par Dieu ?
3. Kierkergaard (fin XIXème, père de l’existentialisme, importance de la subjectivité)
Ce philosophe est très utile pour nuancer l’idée que la religion et la morale diffusent le même message : il y a un contenu moral dans toutes les religions. Mais aussi, dans toutes les religions, le point extrême (la sainteté/ le fanatisme ?) suppose une abolition de la morale.
Théorie des « trois stades » :
- stade esthétique : en dessous de la loi (Dom Juan : l’homme des sensations) : c’est la vie dans l’instant : jouissance = immédiateté ; une quête infinie et insatisfaisante. C’est la singularité comme égoïsme.
- Stade éthique : la loi morale (le mari : l’habitude) : c’est la soumission à la loi immuable, c’est l’ordre de la répétition. C’est l’universalité de la loi.
- Stade religieux : au-dessus de la loi (le Saint : l’homme de Dieu) : transgression de la loi au nom de valeurs plus élevées. C’est la singularité d’un rapport unique à Dieu.
Au stade religieux, il y a une suspension de l’éthique au nom d’un idéal supérieur. C’est même cette suspension qui conditionne l’accès à une morale supérieure.
Pour les juifs et les chrétiens, c’est l’histoire d’Abraham confronté à l’ordre sacrificiel (immoler son fils Isaac). La découverte de la singularité de sa relation avec Dieu met Abraham au-dessus de l’éthique (l’éthique, domaine de l’universel, est niée au nom de l’exception)
1er stade : individualité infra-morale
2ème stade : universalisme de la morale
3ème stade : singularité supra-morale
<VOCABULAIRE>
Dogme = article de foi, auquel le croyant doit obligatoirement adhérer pour être accepté comme tel (croyance + autorité). L’ensemble des dogmes constitue la doctrine.
Révélation = phénomène surnaturel par lequel les vérités divines sont révélées aux hommes (trois religions révélées : Judaïsme/Christianisme/Islam)
Cléricalisme = sclérose de la religion vers sa composante institutionnelle (très peu pour le spirituel/ tout pour le temporel). L’Eglise : un appareil de pouvoir comme les autres.
Victor Hugo : profondément croyant ET profondément anti-clérical // grande sévérité de Kant par rapport aux atrocités commises par l’Eglise : ce qui se fait « au nom de la parole du Christ » n’est pas nécessairement fidèle à cette parole (il ne suffit pas de se réclamer de quelqu’un pour en être le digne représentant).
Laïcité = 1) Principe d’une stricte séparation du domaine religieux et du domaine politique (on veut que l’Etat n’exerce aucun pouvoir religieux/que les Eglises n’aient aucun rôle politique)
2) Respect d’une parfaite neutralité religieuse de l’espace public, qui serait, pour les citoyens, l’assurance que n’importe laquelle de leurs croyances sera respectée. Non pas obliger à l’absence de religion mais au contraire permettre une PLURALITE religieuse. L’idée n’est pas de favoriser une doctrine anti-religieuse (l’athéisme) sur l’une ou l’autre des doctrines religieuses : l’athéisme n’est pas « res publica ». Exemple de la Russie stalinienne : un athéisme d’Etat est aussi anti-laïc qu’une religion officielle.
Un peu d’histoire :
1598 : Edit de Nantes : Henri IV proclame le principe de la tolérance religieuse
1685 : Edit de Fontainebleau = révocation de l’Edit de Nantes. Louis XIV rompt avec la liberté de penser : « Un Roi, une Foi, une Loi ».
Pb : est-ce la neutralité DE l’espace public ou la neutralité de tous DANS l’espace public ?
La religion est une affaire privée, mais cela ne contraint pas le croyant à l’isolement (il y a des affaires privées d’ordre collectif) : collectif (un ensemble qui n’inclut pas la totalité des hommes) ≠ public
L’idéal laïc : ne pas mettre en avant ce qui divise les hommes mais ce qui les unit.
N.B : on peut être croyant ET laïc comme athée ET laïc. C’est savoir créer une distance à soi qui permet que s’ouvre un pan d’universalité où peut se trouver un accord avec ceux qui sont d’une opinion différente.
Coran, 2ième Sourate, 54ème verset : il n’existe pas de contrainte légitime en matière de religion.
Ce qui concerne l’Etat, ce sont les actes, pas les croyances.
Croyants (pratiquants/non-pratiquants + orthodoxes/ hétérodoxes (« bricoleurs ») ≠Non-croyants :
Athée = personne qui affirme l’inexistence de Dieu (qui est CONTRE la religion : anti-religieux)
Agnostique = personne qui n’affirme aucune conviction religieuse (doute ou indifférence) : sans religion ; areligieuse
III. La croyance religieuse est-elle nécessairement en conflit avec la raison ?
Présupposé : le conflit existe. Et pas seulement parce qu’il a, historiquement, eu lieu : ce conflit est nécessaire (essentiel antagonisme entre : la foi / la science et la philosophie)
Introduction : Jusqu’au XVIIIème siècle, en Occident, la religion était incontestée. On ne se demandait pas si l’on était croyant ou pas : on était croyant par définition, comme on est italien, suisse ou malien : par naissance. La croyance religieuse faisait partie de l’identité profonde de l’individu. Ceci n’empêchait pas qu’on se définisse comme « animal raisonnable ». L’exercice de la Raison et la profession d’une croyance coexistaient sans problème apparent. C’est encore le cas de nos jours dans certains états où l’appartenance de l’individu à une religion va de soi et fait partie de son identité (elle figure, d’ailleurs, sur sa carte d’identité cf. Egypte, entre autres).
Cependant, en Occident, à partir du XVIIIème siècle, une distinction nouvelle apparaît : CROIRE et SAVOIR ne reviennent plus au même. Telle est la naissance du conflit : la religion veut exercer une tutelle sur les sciences et la philosophie/ la Raison veut s’affranchir du droit de regard de la Religion. Cette volonté d’autonomie de la Raison s’est traduite par un conflit ouvert, initié par les philosophes du XVIIIème siècle : hommes de Raison qui ont proclamé leur droit de se déclarer athées.
Quelles sont les raisons profondes de ce conflit ? Religion et Raison sont-elles inévitablement conduites à se contredire ou à s’ignorer ? Comment pouvons-nous, nous qui sommes des êtres raisonnables, penser le rapport qu’il y a entre la Foi et la Raison. Est-ce nécessairement en donnant raison à l’une et tort à l’autre ?
Nous remarquerons, au préalable, que cette question se pose de façon beaucoup plus aiguë pour le croyant : celui qui pense que la foi est synonyme de superstition ne s’encombre pas longtemps de la question : il a choisi son camp.
Le croyant, quant à lui, doit réussir à se penser à la fois comme croyant et comme être de raison (c’est-à-dire comme humain) : pour lui, une tension existe entre ces deux appartenances.
- Incompréhension entre la foi et la raison
Voyons tout d’abord en quoi la Raison et la Croyance s’excluent l’une l’autre. Tentons d’expliquer le pourquoi de leur dialogue impossible.
Il faut tout d’abord éviter de dévaluer la croyance en faisant un contresens sur le mot « croire »/ croire en Dieu et croire qu’il fera beau demain sont deux actes totalement différents et même antinomiques : dans un cas, on affirme avec force, on exprime son adhésion profonde / dans l’autre, on « pense mollement », on espère vaguement, on suppose…
Croyance religieuse = assentiment de l’esprit à une vérité sans justification rationnelle.
On voit bien que la Raison est d’emblée disqualifiée, hors-jeu.
Partant de là, toute tentative de la raison pour comprendre le phénomène de la croyance est vaine. Dieu, c’est l’impensable. Et la Foi se présente d’emblée pour ce qu’elle est : irrationnelle (elle repose sur des faits irrationnels par excellence : les miracles). Les miracles sont des faits que je ne connais pas dans leur nature de faits. Si j’en étais le témoin, il n’y aurait pas de croyance. Réfléchissons sur la figure du disciple Thomas, qui fut surnommé « Thomas l’Incrédule ». Alors que des bruits courent, en Judée, qui prétendent que ce Jésus crucifié quatre jours plus tôt est ressuscité, Thomas clame : « Quand j’aurais vu le Christ de mes yeux, quand j’aurais mis mes doigts dans ses plaies , je croirai qu’il est ressuscité ! ». Thomas se trompe : il devrait dire : je SAURAI qu’il est ressuscité. Jamais Thomas ne devient « croyant » (c’est pourquoi la tradition fait toujours état de lui comme incrédule) : le croyant, c’est celui qui adhère SANS VOIR, SANS SAVOIR. Il n’y a de croyance qu’en l’absence de preuves, qu’en l’absence de connaissances.
Et c’est bien parce qu’il est impossible à la Raison de comprendre la Croyance que toutes les interprétations de la Religion par la Raison sont réductrices. Selon la Raison-raisonnante, la croyance s’apparente toujours à la magie, à la superstition. (« Croire, c’est aussi fumeux que la ganja », a dit Gainsbourg dans Negusa nagast).
a. Quand la Raison englobe la religion : trois exemples d’interprétations réductrices de la religion par la Raison (la philosophie)
SARTRE : La religion est la bouée de sauvetage d’un esprit pas assez mûr, ou d’une liberté pas assez courageuse pour affronter ses responsabilités. Ni pour regarder la mort en face. La religion est une fuite.
L’explication la plus commune de la religion par la Raison, c’est l’ignorance : la religion répond aux questions auxquelles la science n’arrive pas (pas encore) à répondre. « Dieu, cet asile de l’ignorance » (Spinoza) et la prière, « le désespoir de la Raison » (texte de Spinoza, Hatier 1 p 272)
« Une religion, qu’est-ce d’autre qu’une doctrine qui explique quelque chose que l’on ne comprend pas (l’existence de l’univers, de la vie, de la pensée…) par quelque chose que l’on comprend encore moins (Dieu) ? »
André Comte-Sponville (Présentation de la philosophie)
FREUD : L’Avenir d’une illusion (1932) : Hatier 13 p 195/ Russ 12 p 406
3 explications de la religion
– la détresse infantile
– l’exigence de Justice
– la curiosité (énigmes de la vie)
L’illusion religieuse apporte à l’homme une consolation. Elle répond à la « détresse infantile », laquelle se prolonge toute la vie : détresse de l’homme, qui se sent si petit, perdu dans l’univers infini (on sent cela chez Pascal), si impuissant face à la mort. Quel réconfort que de pouvoir se dire : « je suis l’enfant chéri d’un Père Tout-puissant. Grâce à Lui, je suis au centre de l’univers ».
La religion relève de l’infantilisme, de la névrose (maladie d’origine non physiologique qui se caractérise par des troubles affectifs et émotionnels et une conscience excessive des états morbides). Névrose suscitée par le désir de protection d’un Père (le désir archaïque d’un père tout-puissant, juste et protecteur)
Russ 14 p 438 : le besoin d’admirer de l’homme (vir ?) : de la proximité entre le Père et le besoin du Grand Homme. Le besoin de héros (on peut penser au cinéma américain).
La religion est un « poison doux-amer » administré dès l’enfance.
On peut tenter un parallélisme entre l’individu et l’humanité : de même qu’à l’adolescence, l’enfant cesse d’idéaliser son père et voit, souvent cruellement, ses limites, une humanité vraiment mature saura, bientôt ( ?), se passer de Dieu.
MARX : Hatier 12 p 194/ Russ 2 p 362: « La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, elle est le cœur d’un monde sans cœur comme elle est l’esprit d’une époque sans esprit : elle est l’opium du peuple » Contributions à la critique de la philosophie du Droit de Hegel (1843)
Cette phrase dit la vertu consolatrice de la religion, sa vertu compensatrice (moyen facile de remplir un vide, solution de facilité), sa vertu dormitive. La religion est ce qui est utilisé par les politiques pour endormir le peuple. Pour qu’il prenne moins conscience de sa misère, de son exploitation, pour qu’il ne se révolte pas. La fausse espérance d’un au-delà affaiblit la volonté d’améliorer la vie « ici et maintenant ».
« Sans être un militant d’aucune religion, je pense que l’on peut reconnaître la religion comme une source d’apaisement utile au fonctionnement de la République. »
(Nicolas Sarkozy / La République, les religions, l’espérance / p. 157)
Aujourd’hui, ce qui n’est plus vrai de la religion peut toujours valoir pour les matchs de foot, les séries télévisées ou la télévision en général. Petit rappel : c’est dans les pays les plus durement exploités de la planète (ex : le Brésil) que l’engouement pour le football est le plus spectaculaire.
Pour Marx, la Foi et la Raison sont opposées : c’est la classique opposition entre l’illusion et la Raison.
A la lumière de ces trois exemples, on voit que rationaliser la croyance revient à détruire la foi. Cependant, le point de vue qui était le nôtre jusqu’ici, c’était que la Raison voulait comprendre la croyance. Voyons maintenant comment la Religion essaie de se défendre de la Raison, de la tenir à distance.
b. Quand la Religion englobe la Raison
Parlons ici du rôle du DOGME : c’est l’énoncé d’une vérité indiscutable, figée, qu’on ne peut qu’admettre. Elle est présentée comme le fondement de la foi.
Le dogme met la Raison hors-jeu. On ne peut qu’adhérer au dogme ou le refuser, pas en discuter les termes : ni jugement personnel ni raisonnement.
Est ainsi révélée l’essence du religieux : une demande d’adhésion inconditionnelle, sans esprit critique. On connaît l’apologie de la « foi du charbonnier » : la Foi est un sentiment ; les croyants les plus ardents ne sont pas forcément les plus subtils (au contraire !)
Idem : l’idée de REVELATION.
On aboutit donc à une antinomie. C’est celle qu’avait annoncé Pascal : « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas »
L’intelligence et les sentiments sont deux ordres radicalement différents, qui ne peuvent se comprendre l’un l’autre.
Saint Paul : « La sagesse des hommes est folie aux yeux de Dieu. La sagesse de Dieu est folie aux yeux des hommes » (cf. parabole des « ouvriers de la dernière heure »)
Une solution subsiste toutefois : à défaut de se comprendre, la Religion et la Raison ne peuvent-elles pas se tolérer ? D’autant plus qu’elles ont certains points communs.
3. Possibilités de conciliation entre croyance et raison
1ère tentative de conciliation : sur le terrain de la Raison : on va essayer de justifier rationnellement la croyance ; on va tâcher de prouver que Dieu existe.
Les théologiens, qui sont à la fois des hommes de religion et des hommes de Raison, vont, pendant des siècles (de saint Augustin à Kant) tâcher de produire des preuves de l’existence de Dieu.
Exemple : preuve ontologique = preuve par l’idée de Parfait : saint Anselme (reprise par Descartes et par Leibniz) : Dieu est l’Etre infiniment parfait, l’Etre tel qu’il n’en existe pas de plus grand OR, s’il n’existait que dans la pensée, on pourrait en concevoir un plus grand encore, qui existerait aussi dans la réalité DONC, Dieu existe nécessairement dans la réalité. Dieu possédant tous les attributs (Beauté, Bonté, Perfection…il possède nécessairement aussi l’Existence). L’essence de Dieu inclut son existence/ preuve « physico-théologique »…
Néanmoins, force est de reconnaître l’échec de ces preuves : d’une part, elles n’ont jamais convaincu personne (personne ne parvient à l’adhésion intime parce qu’il est convaincu par une démonstration). De plus, Kant a démontré leur vanité : vers la fin de la Critique de la Raison pure (« antinomie de la Raison pure »), il met face-à-face les preuves de l’existence de Dieu et les preuves de l’inexistence de Dieu. L’idée de prouver que Dieu existe est abandonnée à jamais.
2ième tentative de conciliation : tentative intéressée, sur le terrain de la politique : utilisation de la religion par le politique.
Ceux qui détiennent le pouvoir utilisent la religion comme un moyen de renforcer leur autorité.
Saint Paul, Epître aux Romains XIII ; I.7 (Itinéraires philosophiques STT p 173) : « Il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu »
Devoir d’obéissance au pouvoir temporel qui s’enracine dans la religion. L’aspect conservateur de la religion en fait un allié objectif pour l’ordre établi.
On pense aussi à la théorisation du « droit divin ».
Texte de Bossuet : le droit divin
On pense aussi aux multiples guerres où les belligérants proclament : « Dieu est avec nous ! ».
Selon Rousseau, la religion fournit le « supplément d’autorité » dont a besoin le pouvoir politique. (Si la menace « qu’on vous coupe la tête ! » ne suffit pas, le monarque peut ajouter « et vous irez griller dans les flammes de l’enfer pour l’éternité ! »)
Cependant, on n’est plus en train de parler ici d’une alliance entre la Foi et la Raison : on est en train de dénoncer la collusion entre deux institutions : la Religion et le Pouvoir politique. Ce que la religion demande au croyant, c’est d’être raisonnable c’est-à-dire de se plier aux autorités.
3ème tentative de conciliation : la morale
Il s’agit d’un authentique point commun entre la religion et la raison : on pense immédiatement à la prohibition du meurtre, fondement de la morale religieuse comme de la morale laïque. De même, la plupart des préceptes religieux (les prescriptions alimentaires notamment) coïncident avec les principes rationnels de l’hygiène : doit-on voir un simple effet du hasard entre la prohibition du porc dans la religion musulmane et le fait que ce soit la viande dont les bactéries sont les plus longues à neutraliser par la cuisson ? (c’est le raisonnement mené par Maïmonide, grand philosophe juif du Moyen-âge). De la même manière, l’imposition aux croyants de périodes de jeûne (le Ramadan pour les musulmans, le Carême pour les chrétiens) coïncide avec les préceptes de la diététique.
Allons jusqu’à l’idée qu’on pourrait réduire la religion au contenu de sa morale. On trouve trois applications à cela :
- le Bouddhisme, religion sans Dieu ni âme (tous deux tenus pour des illusions dérivées du désir de protection et de conservation de soi), et même sans religiosité (textes 12 et 13 in Khodoss T2 p 140 //Walpola Rahula Hatier ES p 294 ; S p 285, 4 p 427. A ce titre, le bouddhisme est plus une sagesse, une philosophie basée sur l’annihilation du désir, qu’une religion.
- Le « Dieu des philosophes » (la religion naturelle) : ce n’est pas un vrai Dieu car il n’a pas engendré le moindre culte : c’est ce qui reste de la religiosité après la critique philosophique de toutes les religions établies. Dans le déisme, Dieu n’est pas une personne mais un principe philosophique abstrait.
- Le projet de Kant : celui d’une Religion dans les limites de la simple Raison : tout ce qui, dans la religion, dépasse la Raison, est écarté. Il reste la morale, dont Kant affirme qu’elle est l’essence de la religion. « La religion est la connaissance de nos devoirs comme commandements divins ». Mais qu’est-ce qu’une religion sans transcendance et sans culte ? Une religion sans mystère, sans rien qui dépasse la Raison, est-ce encore une religion ?
Si la Raison et la Croyance sont irréductibles l’une à l’autre, ainsi qu’on vient de le prouver, sont-elles pour autant en conflit ? Oui, si on les pense comme en concurrence, mais il existe une autre façon de les penser : les penser comme séparées et indépendantes.
- La Raison et la Croyance doivent être absolument séparées l’une de l’autre
L’enjeu majeur de la Critique de la Raison Pure est de reconnaître Raison et Croyance comme absolument séparées l’une de l’autre. Le projet de Kant est de discerner les frontières de la Raison et celles de la Foi afin de définir à chacune son domaine propre.
Après Kant, la condamnation de Galilée (par le Tribunal de l’Inquisition, donc le Vatican, en 1633, pour la thèse de l’héliocentrisme) est devenue impossible : l’Eglise a enfin compris que si elle condamne des faits, elle se ridiculise. La démonstration scientifique se suffit à elle-même. La Raison n’a plus à se plier aux dogmes de l’Eglise. Il faut tout de même nuancer ceci : aujourd’hui encore, aux Etats-Unis, la théorie de Charles Darwin et Alfred R. Wallace (la théorie de l’Evolution des espèces) est contestée par les fondamentalistes chrétiens (les créationnistes).
De même, le fait religieux est d’un autre ordre que la Raison, qui ne peut ni l’affirmer ni l’infirmer.
D’après Kant, il y a trois questions fondamentales, qui résument toutes les questions philosophiques possibles (Russ 1 p 292) :
– Que puis-je connaître ? (Raison théorique) : Critique de la Raison Pure
– Que dois-je faire ? (Raison pratique) : Critique de la Raison Pratique
– Que m’est-il permis d’espérer ? (Croyance, Foi)
Dès lors, dire que la religion est réfutée par la science, c’est se tromper, tout confondre. C’est faire l’erreur qu’on faisait avant Kant, quand on pensait la Raison et la Foi comme en concurrence sur le même terrain.
Les explications biblique et scientifique du monde n’ont pas du tout la même vocation : l’explication mythique de la Bible ne prétend pas dire COMMENT cela s’est fait mais POURQUOI (quelle est la raison d’être de l’Homme ? du monde ?). La religion explore le domaine du SENS.
Certes, elles ont pour point commun la recherche de la vérité, mais il ne s’agit pas du tout du même type de vérité.
Vérités contingentes : « je me suis foulé la cheville », M.Bidule a quitté le gouvernement.
Vérités rationnelles : 2+2=4 (toutes les équations mathématiques) : vérités construites par l’esprit ; universalité ; adhésion nécessaire.
Vérité comme valeur : « Christ est vivant » « Arnaud Montebourt est le meilleur » : vérités d’adhésion, qui constituent un engagement subjectif que prend librement l’énonciateur. Est « vrai » ce qui donne sens à mon existence.
Hegel prétend tout autre chose : pour lui, la vérité est une mais elle se présente sous des formes complètement différentes: « La religion, ainsi que l’art mais sous une autre forme expose la vérité absolue : la philosophie pense et saisit conceptuellement ce que la religion représente »
Ainsi, la religion donne une image de la vérité / la Raison la pense, la conceptualise.
On préfèrera poser la stricte séparation des domaines.
Nietzsche in Humain, trop humain : « Il n’existe entre les religions et la science véritable ni parenté, ni amitié, ni même inimitié : elles vivent sur des planètes différentes »
N’oublions pas qu’il existe des philosophes (ou des scientifiques) croyants, c’est-à-dire des gens qui excellent dans l’exercice de la Raison et qui, en même temps, sont des croyants fervents, juifs, chrétiens ou musulmans. C’est bien qu’ils savent distinguer les deux ordres, entre lesquels ils n’aperçoivent pas de contradiction.
LA LIBERTÉ POLITIQUE

image tirée du film d’animation Léviathan, du croate Simon Bogojevi-Narath
Définition de la POLITIQUE : l’ensemble de ce qui concerne la vie de la cité (polis)
Le politique = le domaine des institutions où se prennent les décisions qui concernent le « vivre-ensemble » des hommes
Dites les notions philosophiques qu’on rencontre
AUTRUI (+ le BIEN)
Une certaine organisation dont les hommes se sont dotés par convention
Individu : individuum (atome isolé), indépendance
Société : collectivité : humains se rassemblent dans des collectivités, liens de dépendance réciproque (contrainte). Illustration : la division du travail.
Toute la question est de savoir s’il est naturel à l’homme de vivre en société (Aristote : « l’Homme est un animal politique » = social : nous sommes des animaux grégaires : comme les abeilles, les fourmis, les castors, les loups…) ; naturalité de la société (continuation de la famille) ou si au contraire on a une juxtaposition d’individus qui souffrent de devoir vivre ensemble ( ≠ Rousseau : l’homme est naturellement solitaire ; Nietzsche : certains disent souffrir de la solitude, moi, j’ai toujours souffert de la multitude)
Les sociétés sont-elles naturelles ? Sont-elles artificielles ?
Pb : comment les Eléments peuvent-ils ne pas se trouver brimés par le Tout ? (réduction d’une pluralité à une unité)
Etat : ensemble organisé des institutions politiques, judiciaires, policières, administratives, économiques, sous un gouvernement autonome et dans un territoire propre
I. L’Etat est-il l’ennemi de la liberté ?
Idée de départ : Obéir / être libre : la vraie liberté = la liberté sauvage, indivisible (Bakounine), absolue : absence totale de contraintes
La liberté est-elle compatible avec la vie de l’homme en société et avec la structuration des sociétés par des ETATS ?
.
1) Liberté naturelle et liberté civile (vocabulaire de Rousseau)
- A) Y a-t-il liberté avant la vie en société ? (question préalable)
Texte de Rousseau in le Contrat social : Russ 10 p 261 – Hatier 6 p 369 : du prétendu « droit du plus fort » :
Dans l’état de nature, il y a des victoires et des défaites mais pas de droit ni de devoir. Il y a, certes, des gagnants et des perdants, mais rien de durable là-dedans, rien d’irréversible, rien de légitime.
Distinction de LA FORCE et du DROIT : on ne peut parler d’un « droit du plus fort »
On a tort de parler de la « loi du plus fort » : la force = ce qui prévaut là où le droit n’existe pas
Le FAIT / la NORME, morale ou légale
B) Pourquoi sortir de la « liberté sauvage »
– sortir du conflit avec autrui :
L : Hobbes cf. Russ 1 p 165 (voir aussi texte 2 p 167 : pour les sceptiques)
S/ES : Hatier Texte 1 p 63 : la société civile est la « guerre de tous contre tous » ; on ne peut en sortir que si chacun abandonne sa prétention à avoir droit sur toutes choses.
Arbitrage qui seul peut sortir l’homme de cette guerre
Le pacte social comme un pacte de soumission nécessaire.
Sans lui, nous allons vers notre mutuelle destruction : texte 4 p 168 : « Aussi longtemps que chacun conserve le droit de faire tout ce qui lui plaît, tous les hommes sont dans l’état de guerre ».
Pour Hobbes (XVIIème, Le Léviathan), ce qui est naturel, c’est le jeu des passions humaines mais il mènerait vite à l’autodestruction de l’espèce humaine sans la création d’un artifice : l’invention de l’Etat.
l’Etat comme « instance supra-individuelle d’arbitrage »
S/E.S : Hatier texte 10 p 349 : J’abandonne mon droit à me gouverner moi-même à un homme ou à une assemblée d’hommes. Délégation réciproque du pouvoir de gouverner ».
– garantir une certaine égalité avec autrui : tension entre les notions de LIBERTE et d’EGALITE
Dans l’état de nature, absence totale de contraintes mais inégalité (des forts et des faibles) : pour qu’il n’y ait pas de domination (absolue) de l’homme par l’homme, nécessité de concilier la liberté des uns avec celle des autres
(Pour Rousseau, la domination des uns par les autres à l’état de nature n’est jamais très préoccupante parce que les passions sont faibles, les inégalités limitées, la supériorité physique toujours ponctuelle et la situation réversible)
Idée d’un sacrifice : j’abandonne une partie de ma liberté pour faire droit à celle d’autrui :
Article 4 de la « DDH » de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. »
Principe de réciprocité + nécessité d’un arbitrage (critères fixes, neutres)
– assurer la sécurité : la première et la plus élémentaire des libertés : celle de rester en vie.
Je fais le sacrifice d’une partie de ma liberté pour que ce qui m’en reste soit garanti par la force publique. Le souci de la conservation de soi-même est allégé : il ne repose plus sur mes seules épaules (ex : institution de la police)
L’invention des lois
2.Le rôle de la LOI
Restreint-elle la liberté ? Dote-t-elle l’individu de droits ? (une entrave à la Liberté ou sa condition de possibilité ?)
Réponse de Montesquieu : « Dans une monarchie bien réglée, les sujets sont comme des poissons dans un grand filet : ils se croient libres et pourtant ils sont pris « . Les bonnes lois = de grands filets dans lesquels les poissons sont pris mais se croient libres / les mauvaises= ces filets dans lesquels ils sont tout de suite si serrés qu’ils se sentent pris.
(N.B : bifurcation de la liberté au « sentiment » d’être libre)
A. Spinoza : « la fin de l’Etat est la liberté »
Texte de Spinoza : Traité théologico-politique , chapitre XX (1670) : la fin de l’Etat est la liberté (91)
Puisqu’on en est en train de parler des différents types d’obéissance, je cite Montaigne, à propos des Rois : « Toute inclination et soumission leur est due, sauf celle de l’Entendement. Ma raison n’est pas duite à se courber et à fléchir, ce sont mes genoux »
(// Pascal, Trois Discours sur la condition des grands : respect d’établissement/ respect naturel)
B. Rousseau : Obéir aux lois pour ne pas obéir aux hommes
Texte de Rousseau : 8ème Lettre écrite de la Montagne (photocopie ou Russ 15 p 266)C’est l’obéissance aux lois, impartiales, universelles, qui nous libère de l’obéissance aux hommes. L’obéissance à la loi est fondamentalement une obéissance dans l’égalité alors que l’obéissance aux hommes se fait dans un esprit d’inégalité.
On commence peut-être à être convaincu de la compatibilité des lois et d’une certaine liberté des hommes (liberté limitée mais liberté quand même). Si vous êtes non seulement un peu convaincus mais très convaincus, alors vous jugez que les lois sont la condition de possibilité de la Liberté.
Il reste vrai malgré tout que les Lois sont une limite (nécessaire) au pouvoir des individus
Ce qui reste à montrer maintenant, c’est que la Loi se pose comme limite aussi par rapport au pouvoir de l’Etat :
C) J.S Mill : « Sur lui-même, l’individu est souverain »
Thème : l’usage de la force publique contre l’individu (le pouvoir de contraindre)
Objectif : le limiter
Texte de John Stuart Mill (XIXème): (92): On n’a le droit d’user de la force envers quelqu’un d’autre que « pour assurer sa propre protection »
« Le seul but légitimant l’usage de la force envers un membre (de la communauté) est de l’empêcher de faire du mal aux autres »
ligne 15 : « le seul aspect de la conduite de quelqu’un qui relève de la société est celui qui concerne les autres » ; lg 18 et 19 : « Sur lui-même, l’individu est souverain »
Tout autre critère est illégitime : « il ne peut pas être légitimement contraint d’agir ou de s’abstenir sous prétexte qu’il est meilleur pour lui d’agir ainsi, sous prétexte que cela le rendrait heureux ou que, dans l’opinion des autres, agir ainsi serait sage ou même juste » :
Illégitimité de l’argument : « c’est pour ton bien !»
Illégitimité de la référence aux « grandes valeurs morales » : ce qui est sage ; ce qui est juste.
On est devant un texte qui a pour souci de préserver à l’individu le maximum de liberté (par rapport aux lois) : la Loi a sa place entre moi-même et les autres mais non pas entre moi et moi-même.
2) Quels sont les enjeux que vous apercevez pour ce texte ?
La drogue/ Le suicide (légal = moral)/ Le nudisme, l’exhibitionnisme / la vaccination obligatoire/ La prostitution
Le « lancer de nains »…
3) Le principe mis en lumière par J.S Mill vous parait-il respecté par la Loi dans notre Société ?
S’agit-il seulement de limiter l’usage de la force par l’Etat ou bien encore de limiter le rôle de l’Etat au seul rôle de protection des individus les uns des autres ? Dans ce deuxième cas, on aurait une interprétation libérale du rôle de l’Etat (la loi n’a pas à intervenir entre le travailleur et l’employeur, ni pour fixer des taux, encadrer le prix des marchandises…) : le moins d’Etat possible
Conclusion : texte qui permet de faire une distinction très nette entre :
Conseiller, faire à quelqu’un des remontrances, le persuader, raisonner avec lui, le supplier
≠ le contraindre, le châtier
Dissociation de la Loi et de la Morale
La Loi ne dicte pas tout, elle ne légifère pas sur tout (elle ne dit pas quel est le Dieu auquel croire, combien d’enfants avoir, comment rompre avec son petit ami)
Hobbes : la Liberté existe « dans le silence de la loi » : dans ces occasions où elle se tait, dans l’espace laissé vacant entre ce qu’elle prescrit et ce qu’elle interdit entre l’obligatoire et le prohibé.
On vient de voir un certain nombre d’analyses selon lesquelles il y a un accord profond entre l’Etat et la Liberté. Ce qu’il faut voir maintenant, c’est que cet accord ne peut exister que là où l’Etat procède d’un bon établissement : là où les sujets se mettent d’accord sur un contrat social qui fonde l’Etat (dire sa vocation, dire ses limites).
Soit on considère comme Machiavel que le pouvoir est arbitraire : qu’il ne peut être fondé en droit, ou comme Aristote qu’il est naturel à l’Homme d’être gouverné : théorie du fondement naturel de la société: l’homme qui vit à l’écart des autres n’est pas réellement un homme mais soit une bête, soit un dieu. Chez Aristote, le chef est conçu sur le modèle du père; soit on considère que l’autorité politique procède d’une convention passée entre des individus naturellement libres et égaux. Le pouvoir ne procède pas de la Nature, pas de Dieu, mais de la Volonté humaine.
L’organisation politique est alors pensée comme une création artificielle des hommes.
3) Le Contrat social selon Rousseau (= le fondement de l’Etat)
Pour répondre à la question initiale : « l’Etat opprime-t-il ? » (question de la compatibilité de l’Autorité et de la Liberté), il faut remonter à l’origine de l’Etat.
Si l’origine de l’Etat est un bon contrat, alors la liberté est préservée.
But du Contrat social (1762) : montrer ce qu’est un bon contrat.
- Mauvais contrat et bon contrat
Remarque : il existe un mauvais contrat
Rousseau en donne un exemple dans le D.O.I. : cf. Russ p 260 texte 9 : l’imposteur qui instaure la propriété privée par la déclaration : « ceci est à moi ».
Le mauvais contrat, c’est celui qui assure l’inégalité OR nul ne peut vouloir être victime de l’inégalité : Cf. KH p 465 8B : « Dire qu’un Homme se donne gratuitement, c’est dire une chose absurde et inconcevable : un tel acte est illégitime et nul » : celui qui se désavantage s’est fait berner : tromperie qui entraîne la nullité du contrat (clause d’annulation des mariages : si le contrat n’est pas passé entre deux individus libres et égaux). Le contrat étant un acte libre de la volonté, un contrat qui instaure une inégalité est nécessairement fondé sur une tromperie.
Si l’Etat s’origine dans un mauvais contrat, l’Homme est opprimé et malheureux, c’est le règne de l’injustice.
N.B : C’est aussi le cas s’il n’y a pas de contrat du tout : là où l’Etat est imposé par la force. Ex: population vaincue (guerre) forcée de rentrer dans l’Etat vainqueur.
Le bon contrat :
Il s’agit de « trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun – s’unissant à tous- n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’avant » (GF 51) Russ 12 p 264
Chacun aliène sa liberté naturelle pour gagner la liberté conventionnelle. Chacun s’aliène totalement (aliène tous ses droits) à toute la communauté. Le comble de l’aliénation ? Non, car chacun, se donnant à tous, ne se donne à personne.
En effet, j’acquiers sur l’autre tous les droits que je lui ai cédé sur moi : tout le monde a intérêt à ce que le joug soit le plus léger possible (principe de réciprocité).
B) Pacte social (= Contrat social) / pacte politique
Le pacte social, c’est la volonté des individus de « faire corps ». Il en découle, du côté des citoyens, le sentiment d’être unis, de constituer une nation : c’est – depuis la Révolution française – ce qui fonde la nation française.
Ce n’était pas le cas avant : il y avait bien « nation », mais elle était fondée autrement.
A la Révolution française, la notion de nation est refondée : on ne la pense plus comme une identité collective : il n’est plus nécessaire d’avoir les mêmes coutumes, la même origine ethnique, le même credo pour constituer une nation mais « seulement» de se mettre d’accord sur les principes du « vivre-ensemble » = pacte social : quelque chose de totalement universalisable
Pas de communautarisme : ce ne sont pas nos points communs qui font de nous un peuple, c’est notre volonté de constituer un peuple
Différenciation des concepts de population (laos) et de peuple (demos) : la population, c’est l’ordre du fait + la référence à une localisation / le peuple, c’est de l’ordre de l’idée : c’est une notion politique (volonté commune)
Comment un laos devient-il un demos ?
Par un pacte social
Idée d’un « pacte social » antérieur au pacte politique : consentement que chacun donne pour agir avec les autres comme un seul et même corps.
Acte fondateur : Renonciation à la liberté de l’état de nature. C’est après seulement qu’il appartient de décider quelle forme va prendre le pouvoir politique, quelles institutions etc (= pacte civil).
FIN : décision de vivre ensemble : pacte social
MOYEN : pacte civil
Parce que le pacte civil (politique) s’appuie sur un pacte social qui lui est antérieur, Locke légitime le droit de s’opposer, en certaines circonstances, à l’autorité.
- Locke Traité sur le gouvernement civil: le peuple est libéré de son devoir d’obéissance dès lors que l’autorité devient absolue, tyrannique, et dévie de son but : la conservation des biens et des personnes.
Même chose dans la « Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis d’Amérique » : les hommes sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables (la liberté ; la recherche du bonheur) : « Toutes les fois qu’une forme de gouvernement devient destructrice de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l’abolir et d’établir un nouveau gouvernement ».
Dès lors, on voit que l’idée d’un pacte social antérieur au pacte politique est un merveilleux outil pour penser la désobéissance : on peut abolir la forme du pouvoir politique sans abolir la nation.
N.B : Précision qui concerne la souveraineté (l’exercice réel du pouvoir de décréter)
Pour Rousseau, dans une démocratie, l’individu est à la fois SUJET et SOUVERAIN
Ainsi, dans une démocratie, tout citoyen est membre du Souverain. Le meilleur système étant alors la démocratie directe : mais la démocratie directe n’est possible que dans les cités de petite taille (trop de temps consacré par tous à la vie politique : dichotomie grecque : citoyens / travailleurs: femmes, esclaves) : solution : la délégation de souveraineté : je délègue mes pouvoirs à des représentants, professionnels de la politique. L’exercice de la souveraineté est un aspect particulièrement délicat du fonctionnement des démocraties.
Problème de la trahison toujours possible par les mandataires de leur mandat.
C) La Volonté Générale : une universalité problématique
Chacun se met sous la direction suprême de la volonté générale (Contrat social, Livre 2)
Qu’est-ce que c’est ?
C’est la volonté du peuple souverain, composé d’individus égaux en droits et qui forment librement un corps politique et moral.
Les Lois = l’expression de la volonté générale (d’où : obéir aux lois = s’obéir à soi-même, par la médiation de l’Etat)
Lecture facultative : Kh 13 p 446 : « l’objet des lois est toujours général » ; les lois sont « des registres de la volonté générale » ; Hatier 11 p 373
Cependant, le libre-jeu des volontés individuelles ne converge pas spontanément vers le Bien Public (Rousseau n’a pas l’optimisme de Locke)
PB : Comment une multitude aveugle qui souvent ne sait pas ce qu’elle veut pourrait-elle inventer un système de législation ? (fac : KH p 478 : le public a besoin d’un guide : le législateur).
En effet, le peuple n’est pas spontanément unanime : il y a les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes, les gens de droite et les gens de gauche ; ceux qui ont tout et ceux qui n’ont rien : les « intérêts de classe » : comment tous ces gens différents, aux intérêts antagonistes peuvent-ils avoir une « volonté générale » ?
Si on comprenait « volonté générale » comme plus petit commun dénominateur entre ce que dicte l’intérêt des uns et celui des autres, elle est égale à zéro. Elle est introuvable.
Cette idée de volonté générale repose sur celle d’intérêt général : sur la conviction qu’il est possible de dégager un intérêt général de la somme des intérêts particuliers.
Cependant, la volonté générale n’est pas la simple somme des intérêts de chacun : l’intérêt général ne se somme pas arithmétiquement : il ne se dégage qu’entre individus capables de faire abstraction de leurs intérêts particuliers.
VOLONTE GENERALE ≠ VOLONTE DE TOUS
N.B : ponctuellement, mon intérêt particulier peut être en contradiction avec l’intérêt général. A l’intérieur de mon intérêt particulier, je ne garde que ce qui est compatible avec l’intérêt général. Si j’adhère au contrat social, celui-ci prévoit qu’en cas de conflit, je fais prévaloir l’intérêt général sur mon intérêt particulier.
Par conséquent, la volonté générale est la volonté de tous ceux qui arrivent à avoir pour but l’intérêt général, le Bien Commun. Donc, c’est par un effort moral vers l’égalité (vertu) que les citoyens doivent renoncer à tout intérêt particulier et égoïste. Et c’est ainsi que se dégage la volonté générale.
Etre citoyen, ce n’est pas se prononcer sur la loi en fonction de ses intérêts particuliers (exemple de l’héritage) mais en consultant sa conscience, dans le silence des passions, sur le Bien commun de la cité (cf. Russ. texte 13 : p 265)
Une universalité problématique (des lois : de l’adhésion au Contrat social)
(N.B : non pas à comprendre comme : les mêmes lois sur toute la surface de la Terre mais les mêmes lois pour tous à l’intérieur d’une société donnée).
Il est de l’intérêt de tous que la loi existe (même si certaines lois lèsent mes intérêts) mais il y a quelques individus qui peuvent ne pas le voir : qui refusent la Loi.
Il est d’intérêt général que tous se soumettent à la volonté générale. En effet, la société juste n’est réalisable que si tous adhèrent au même C.S : si tous reconnaissent la volonté générale. Que faire de celui qui ne le comprend pas ?
C.S p 54 (Russ 14 p 265) : « Quiconque refusera d’obéir à la volonté générale, on l’y contraindra : on le forcera d’être libre » : (oxymore) c’est la loi qui rend libre : on a le droit d’imposer la loi à celui qui conçoit sa liberté en dehors de la loi. Ce faisant, on rend possible la justice au niveau collectif + on ne commet pas d’injustice envers celui qu’on contraint (cf : « c’est pour ton bien »)
Danger que représente l’individu qui ne se soumet pas à la loi (on pense à Kant : celui dont la maxime de l’action n’est pas universalisable : celui qui souhaite que la loi vaille pour tous mais non pour lui : qui prétend faire exception à la loi).
Le C.S suppose qu’il n’y ait personne ni hors-la-loi (en-deçà) ni au-dessus des lois (une position de transgression + une position d’abstraction)
Seule la soumission de tous à la loi est la condition de la liberté au niveau collectif.
Le pire serait que certains individus, indépendants des lois, profitent de la loi pour maintenir les autres dans leur dépendance personnelle (la loi au service des maîtres : perversion terrible). Sans la loi, la liberté peut ressembler à celle dont parle Marx : « la liberté du renard libre dans le poulailler libre ». Autre perversion : la loi des parrains mafieux : une loi qui n’a rien à voir avec l’intérêt général ; lois faites par et pour certains intérêts individuels. Quand on dit de quelqu’un qu’il « fait sa loi », c’est plutôt qu’il impose sa force. De même, l’autorité parentale, c’est l’arbitraire parental.
On voit ici que la condition 1ère d’une société juste, c’est l’égalité des citoyens devant la loi.
Autre façon de le dire : universalité de la loi : tous y sont soumis.
On vient de dire comment sont traités ceux (minorité) qui refuseraient la loi. Il faut encore dire pourquoi la plupart accepte la loi.
L’acceptation de la loi = sa reconnaissance comme juste = sa légitimité.
D) La Légitimité
Rousseau renvoie la notion de liberté à la notion de légitimité.
Le fondement de la liberté, ce sont 1) des lois justes
2) un Etat légitime
Que sont des lois justes ? des lois qui expriment l’intérêt général.
Rousseau insiste sur l’idée qu’il n’y a rien de plus redoutable que des lois injustes.
LE POUVOIR LEGITIME = LA FORCE + LE DROIT : contre une force, j’oppose la mienne sauf si je reconnais comme légitime cette force. Alors, pas d’affrontement. L’ensemble des lois et le respect que je leur porte rend l’exercice de la force inutile : je reconnais le pouvoir pas seulement comme puissant mais aussi comme ayant le droit de faire usage de cette puissance.
LA LOI INJUSTE = LA FORCE + L’APPARENCE DU DROIT
L’existence de lois injustes laisse l’individu plus pitoyable que l’absence de lois car dans l’état de nature, je ne reconnais aucun droit à mon agresseur : je me défends. Si l’injustice prend la forme de la loi, je suis beaucoup plus impuissant (Cf L’état de guerre vieux Russ texte 7 « la violence »: « partout le fort armé contre le faible du redoutable pouvoir des lois »). Je suis moins démuni contre la violence physique des individus que contre la violence institutionnelle des lois injustes.
Deux critères de légitimité : la libre-adhésion ; l’universalité.
Libre-adhésion problématique car je nais toujours dans un Etat où les lois sont déjà faites (pas de « table rase » à chaque génération). Argument selon lequel « je peux toujours m’en aller » (exil idéologique)
Ainsi, Rousseau rend possible de penser des lois injustes : la légalité n’est pas la légitimité
LEGALITE : l’existence des lois ; respect (formel) des lois
LEGITIMITE : l’adhésion intime avec ces lois ; reconnaissance des lois comme justes.
Ce divorce entre légalité et légitimité est la source de l’injustice au niveau de la vie politique : vie en commun de tous.
Aristote :
| Régimes politiques : formes pures | Formes corrompues (dégradées) |
| monarchie | tyrannie |
| aristocratie | Oligarchie (gouvernement des plus riches) |
| république | démocratie |
Si l’intérêt général domine : forme pure / si c’est l’intérêt particulier qui domine : forme corrompue.
II. La Justice et le droit
1) Un outil pour penser les lois injustes : le droit naturel.
Texte de Léo Strauss (Roussel p 131) : (93) Antériorité de certains principes moraux par rapport au droit positif. Le droit naturel est un étalon du juste et de l’injuste ; il est antérieur au droit positif ; il est supérieur au droit positif (cf. cours sur le droit)
2) La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
17 articles, déclarés en 1789, en préambule à la Constitution, acte politique majeur : texte qui émane de l’Assemblée des représentants du peuple : légitimité.
Des précédents : 1689 (GB) : « The Bill of Rights »: limitation du pouvoir royal.
1776 (USA): « Declaration of Independence »: la souveraineté est désormais aux mains de citoyens libres et égaux devant la loi et l’impôt.
* Déclarer des droits, ce n’est pas les inventer. Rendre clairs : faire venir à la conscience ce qui était confusément ressenti / porter à la connaissance du public quelque chose qui était tombé dans l’oubli. Ils sont reconnus comme antérieurs : ils étaient légitimes avant même qu’on les formule. Texte adressé à l’humanité toute entière (ambition universelle).
« droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme » :
*Deux catégories :
Les « droits de l’homme » = des libertés, qui limitent le pouvoir du politique
Les « droits du citoyen » (exclusion faite des femmes) = des pouvoirs politiques conférés aux citoyens
DROITS DE L’HOMME : Droit de s’appartenir à soi-même → droit de propriété
Droit de choisir sa religion (ou droit de ne pas en avoir)
Droit de défendre sa vie contre tout agresseur
Fondamentalement, tous ces « droits de » garantissent la liberté contre le pouvoir (droit de ne pas être…). L’Etat est fait pour l’individu et non l’individu pour l’Etat.
C’est l’affirmation symbolique de principes. Ils sont tenus pour légitimes car appartenant à la nature humaine. Ils sont antérieurs au Droit positif. Même à l’état de nature, ils existaient.
* Nouveauté du concept : ce sont vraiment des droits de l’homme = de l’individu = de tout homme / Avant le XVIIIème, il y avait des droits mais ils étaient spécifiques : en fonction de ma classe sociale, ma profession, mon statut (ex: femme mariée). Conception holiste (organiciste) de la société : société pensée comme antérieure et supérieure aux individus.
Avec les droits de l’homme, on prône la réversibilité des positions (= l’égalité des individus)
Ils sont d’inspiration philosophique : théorie de droit naturel + théorie du contrat social (dans l’état de nature, chacun ne peut compter que sur lui-même pour la défense de leurs droits naturels. Nécessité d’une autorité politique pour faire respecter ces droits. Or, la nature a fait les hommes libres : illégitimité de l’autorité d’un homme sur un autre : les hommes doivent décider eux-mêmes de créer cette autorité politique (accord)
DROITS DU CITOYEN : concernent la participation du citoyen au pouvoir politique. Ils ne concernent plus l’humain mais seulement le masculin. La partition vie publique/ vie privée a survécu à la révolution. Les femmes sont cantonnées dans le domaine privé (c’est seulement en …1944 qu’elles obtiendront le droit de vote).
Problème : les DDH ont un statut hybride : c’est à la fois l’affirmation symbolique de principes universels ET ils ont force d’obligation pour les nations démocratiques.
Ils sont donc valables pour tous MAIS pour certains plus que pour d’autres.
Hors démocraties, que vaut l’invocation des droits de l’homme ? Vanité du droit s’il n’y a pas quelqu’un qui garantit ces droits (pour qui mon droit crée-t-il une obligation ?
DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME DE 1948 : une nouvelle catégorie de droits : des droits sociaux. Ce ne sont plus des « droits de… » comme en 1789 (citoyenneté formelle //protection de l’individu contre l’Etat) ; ce sont des « droits à… » obtenir quelque chose (santé, éducation, travail) : citoyenneté réelle. Ils impliquent l’intervention de l’Etat en faveur des individus (des « droits-créances »)
Mais qui peut garantir ces droits sociaux ? L’Etat ne peut s’engager à fournir du travail à tout citoyen + aucun patron ne peut être obligé d’employer TEL individu.
Ces droits ne sont donc des obligations pour personne…vaine revendication ?
3) Le légalisme (ou : positivisme juridique)
La justice et la force : antinomiePascal : Pensée 298 (95) (Roussel p 198). Voir en parallèle avec T.L Russ 3 p 202
Il est juste que ce qui est juste soit suivi, il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite, parce qu’il y a toujours des méchants ; la force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force ; et pour cela, faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste.
La justice est sujette à dispute, la force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi, on n’a pu donner la force à la justice, parce que la force a contredit la justice et a dit que c’était elle qui était juste. Et ainsi ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste.
Cf aussi KH texte 9 p 444/ Hatier p 95) : de la stupidité de prendre pour roi le fils aîné de la reine + de l’utilité de cette convention (96)
La sauvegarde de l’ordre exige quelquefois que la morale soit bafouée (que le juste soit condamné et l’agresseur amnistié) : idéalisme contre réalisme
« Dura lex, sed lex » : positivisme juridique : je dois obéir à la loi parce que c’est la loi. L’ordre juridique vaut pour lui-même (pour son efficacité) indépendamment de sa concordance avec une norme morale de ce qui est juste ou injuste. Car il peut y avoir désaccord (cf Pascal: on en vient tout de suite aux mains) au sujet du juste.
Hans Kelsen : texte 8 p 477 et 12 p 480 : « il y a tant de normes du juste qu’il est indispensable de rendre la loi positive indépendante »
Parfois, ceux qui sont au pouvoir font ce choix : « Mieux vaut une injustice qu’un désordre ». C’est par exemple le raisonnement qui fut fait par Ponce Pilate, gouverneur de la Judée : quoique persuadé de l’innocence de Jésus, il a choisi de le condamner afin d’apaiser la foule en colère.
L’ordre public prime la justice individuelle, la morale.
Légalisme = refus de la distinction entre légalité et légitimité
Illustration du légalisme : la condamnation de Socrate (considéré, en tant que philosophe, comme agitateur, comme dangereux corrupteur de la jeunesse) : son refus de se soustraire à la sanction (incitations de son ami Criton), quelqu’injuste qu’il la tienne (cf. Le Criton, Platon)
Je vis en société = j’accepte l’autorité des lois. Je m’y soumets de toutes façons
Cf Alain texte in Roussel p 138 : « accepter l’arbitrage », (97)
Je n’obéis pas aux lois parce qu’elles sont bonnes mais parce qu’elles sont l’ordre et qu’on a besoin d’ordre pour le changer
Réformer une loi n’est pas transgresser une loi: quelque chose de collectif et de définitif / quelque chose d’individuel et de ponctuel
Objection : On n’est pas obligé d’être d’accord avec l’ordre, de le sacraliser : on peut contester l’Etat. Le désordre peut être un moyen de hâter l’avènement de la Justice, de promouvoir des valeurs qui sont transgressées par l’Ordre.
4) La contestation de l’Etat
- Les critiques à l’encontre de l’Etat
La définition neutre (celle du dictionnaire) :
Etat : « autorité souveraine s’exerçant sur l’ensemble d’un peuple et d’un territoire déterminé » (non pas une personne – sauf Louis XIV en 1655 : « l’Etat, c’est moi » – mais un corps politique qui gouverne en fonction de l’intérêt général)
Trois facteurs :
1 : l’occupation permanente d’un territoire (contre exemple : la diaspora juive entre 70 (destruction du temple et juifs chassés par les Romains) et 1948)
2 : la monopolisation de la législation sur ce territoire (contre exemple : la France d’avant Louis XIV, où le pouvoir était partagé entre la royauté et la noblesse)
3 : la concentration du pouvoir entre les mains d’un petit nombre (contre exemple : la démocratie grecque antique : tous les citoyens se partagent l’exécutif à tour de rôle, par tirage au sort).
Passons maintenant à des définitions plus polémiques :
L’Etat : une instance supra-individuelle d’arbitrage (Hobbes): le risque, c’est une dérive vers son pouvoir arbitraire.
L’idée qui fonde l’Etat, c’est de substituer l’ordre public à la tyrannie privée.
Le risque, c’est que ce pouvoir se transforme en une forme suprême de tyrannie.
Soupçon qui pèse sur l’Etat : il préfère un ordre injuste au désordre. C’est ce que veut dire l’invocation de la « Raison d’Etat » : plutôt l’injustice que le désordre.
Présupposé : le maintien de l’ordre public est une fin qui justifie tous les moyens (suspension des lois ordinaires de la République)
Définition (polémique) de l’Etat par Max Weber (sociologue allemand, début XXème) : « il faut concevoir l’Etat contemporain comme une communauté humaine qui, dans les limites d’un territoire déterminé (…) revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence légitime » (cf Le Savant et le politique 2ème partie)
Problème soulevé : celui de la légitimité de l’Etat
Antinomie : violence / légitime (s’il y a violence, c’est que quelque chose est violé dans la personne humaine: son corps, ses biens, le respect qu’on lui doit…) : alliance de l’excès (l’abus) et du juste
N.B : différence entre FORCE (puissance potentielle, virtuelle) et VIOLENCE (usage démesuré, brutal de la force) : la violence est l’usage de la force au-delà du droit. Toute violence est donc illégitime.
Dès lors qu’il y a « monopole », n’y a-t-il pas risque d’excès ? Qui va être garant que l’Etat n’abuse pas ?
« pour son propre compte » : divorce entre le Bien Commun (l’intérêt général) et ce qui convient à l’Etat comme structure : dérives: risque de détournement de l’intérêt général au profit de quelques particuliers ( nomenklatura) ; risque de clôture sur soi : l’Etat n’est plus un instrument au service de tous mais une structure qui vise surtout à se maintenir elle-même
(Dilemme : Justice / Ordre)
Conservatisme : tendance intrinsèque à l’Etat : maintien de l’ordre civil et de la hiérarchie sociale. Etymologie : Etat – estat- « stare » : se tenir stable, en latin
La « raison d’Etat » peut servir d’alibi (état d’urgence : crise qui implique que la légalité soit temporairement suspendue. Les « intérêts sup de la nation » exigent que… : qui sont ceux qui décident de ces intérêts ? Qui contrôle qu’il en va bien du Bien Commun ?
Illustration : l’usage anti-immigration qu’ont fait les différents Etats des lois anti-terroristes prises après les attentats du 11 sept 2OO1 (de nouveaux droits individuels ont été bafoués : moins de liberté, au nom de la sécurité)
Elle est invoquée pour justifier une action injuste, inconstitutionnelle.
Nécessité pour un Etat démocratique de se doter d’instances de contrôle : devoir de vigilance de chaque citoyen : l’Etat agit selon des règles que tout citoyen est en mesure de connaître ; saisir les Tribunaux administratifs…
L’Etat n’est qu’une forme plus abstraite et plus organisée de la domination de l’homme par l’homme
Réduction d’une multiplicité (opinions) à une unité (loi)
L’Etat : une entité artificielle, uniformisante et asservissante
Nietzsche : Aurore : « Aussi peu d’Etat que possible »
A.S.Z : « Etat : ainsi se nomme le plus froid des monstres froids » (Russ 12 p 386)
Illustration : Administration : disposer aveuglément des personnes comme si elles étaient des choses.
Il y a divorce entre l’Etat et le peuple.
L’Etat est censé être le représentant du peuple : c’est faux. Il y a là une trahison (Etat usurpateur, qui se fait passer pour la voix du peuple alors qu’il en est l’ennemi)
B) L’utopie d’une société sans Etat : l’anarchisme
Non pas sens courant : désordre pagaille mais l’anarchie = le but d’un mouvement politique : celui du mouvement anarchiste : XIXème, mouvement libertaire (la liberté comme valeur suprême)
Orientation principale : anti-étatisme.
Lutte contre l’aliénation religieuse (Eglise) et contre l’aliénation politique (Etat) « ni dios ni amo »
Deux tendances : * anarchisme communiste : Bakounine, Kropotkine
* anarchisme individualiste : Max Stirner, Proudhon
L’anarchisme répudie toute idée d’autorité comme contraire à la liberté individuelle, valeur par excellence.
Principe d’autonomie de la volonté individuelle
Le fédéralisme est appelé à remplacer l’organisation étatique (Etat qui toujours centralise, hiérarchise / pluralisme : LA valeur des anarchistes)
Suppression de l’argent : « à chacun selon ses besoins » (rappel : pas de principe d’autorité qui dise quels sont ces besoins : « prenez ce qu’il vous faut »)
Suppression de la propriété privée en ce qu’elle engendre l’injustice
Société basée sur la responsabilité individuelle, la solidarité : associations, auto-gestion (non pas absence de règles mais toutes les règles se prennent en commun)
En quoi est-ce une utopie ?
Les obstacles à sa réalisation sont minorés
1) problème du passage de la société réelle à la société idéale non résolu (quelques pistes quand même pour entraîner le « dépérissement de l’Etat » : désorganiser la société, y compris par le terrorisme)
- problème de la nature des hommes : rapacité des hommes, inconséquences… : ce n’est pas un hasard si l’anarchisme recule au XXème siècle : après qu’on a vu l’homme à l’œuvre dans la seconde guerre mondiale (les uns exterminer tout un peuple / les autres s’arranger pour n’en rien savoir cf le film Amen de Costa Gavras), comment lui accorder encore tant de crédit ?
III. Quelle Justice ?
1) la justice dans l’égalité
- A) Aristote : Justice du Père / Justice entre citoyens
Ethique à Nicomaque : deux sortes de Justice 1) celle de Père (ou du Maître) ; 2) celle qui existe entre citoyens.
- a) La Justice du Père = l’Autorité (« rendre justice »)
C’est une Justice qui ne peut être que juste car « il n’est pas d’injustice au sens propre à l’égard de ce qui vous appartient en propre » : nul ne peut être injuste envers sa femme ou son enfant car c’est comme une partie de lui-même, or « nul ne choisit délibérément de se causer du tort » (l’entité de référence : la structure familiale, identifiée au Chef de famille.
Vision périmée mais…il existe encore aujourd’hui des cas de « suicide » familiaux perpétrés par le « chef de famille ».
La Justice est l’apanage de celui qui « rend Justice » = fait la loi.
b) Au sens de la « justice entre citoyens», la justice concerne les individus qui sont des égaux. C’est le seul sens qu’aujourd’hui nous comprenons : celui qui rend possible d’être juste, ou de ne pas l’être.
B) le postulat d’égalité
Dans ce que nous concevons comme une société juste, les positions sont modifiables : une action nouvelle doit pouvoir changer l’ordre qui a résulté d’une action antérieure ( ≠ société de castes, société d’Ancien régime )
C’est la raison pour laquelle un jugement « en justice » concerne toujours des actes et jamais des personnes (idée chrétienne de la conversion, du Pardon)
Il y a, dans les démocraties, un certain postulat d’égalité ; qui fonctionne comme un voile d’ignorance (cf J.Rawls Cité de la Justice) : ce qu’on veut ignorer, ce sont les inégalités de fait (milieu, intelligence etc.).
Il en découle un paradigme assurantiel fondé sur la notion de risque (fin XIXème) : le risque (chômage, maladie, vieillesse) est également partagé par tous de façon aléatoire (Etat-Providence, Sécurité sociale). Aujourd’hui, déchirure du voile d’ignorance sous l’effet de la connaissance médicale (déterminismes biologiques, génétiques).
Autre illustration du voile d’ignorance : l’égalité des voix qui dicte que le vote de l’abruti et celui de l’individu éclairé valent chacun une voix.
Qui dit égalité dit forcément : formalisme abstrait : ne pas aller regarder le réel de trop près.
C) l’égalité devant la loi ne suffit pas
Ernst Bloch (philosophe allemand début XXème): la même loi pour tous, est-ce que cela veut dire l’égalité ? L’égalité devant la loi interdit aux riches comme aux pauvres de voler du bois ou de coucher sous les ponts. Elle empêche si peu l’inégalité qu’elle la protège. (cf photocopie)
L’égalité des droits pérennise l’inégalité de la société.
Inégalité de fait confortée par l’égalité des droits.
Les lois protègent les intérêts des classes supérieures.
Qu’est-ce qu’une société juste ? Une société où les lois ne sont pas faites par les dominants et pour les dominants.
Joseph de Maistre : « la loi juste n’est pas celle qui s’applique à tous mais celle qui est faite pour tous »
Confrontation possible avec le texte d’Alain : le droit assure l’égalité : (98)
Qu’est-ce que le droit ? C’est l’égalité. Dès qu’un contrat enferme quelque inégalité, vous soupçonnez aussitôt que ce contrat viole le droit… Le droit règne là où le petit enfant qui tient son sou dans sa main et regarde avidement les objets étalés, se trouve l’égal de la plus rusée ménagère. On voit bien ici comment l’état de droit s’opposera au libre jeu de la force. Si nous laissons agir les puissances, l’enfant sera certainement trompé ; même si on ne lui prend pas son sou par la force brutale, on lui fera croire sans peine qu’il doit échanger un vieux sou contre un centime neuf. C’est contre l’inégalité que le droit a été inventé. Et les lois justes sont celles qui s’ingénient à faire que les hommes, les femmes, les enfants, les malades, les ignorants soient tous égaux. Ceux qui disent, contre le droit, que l’inégalité est dans la nature des choses, disent donc des pauvretés. Alain, Propos sur les pouvoirs (18 octobre 1907)
Lacordaire, prêtre français et député d’extrême gauche, XIXème : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. »
John Rawls : Il part du constat que notre société n’est pas juste.
Faites une expérience de pensée : imaginez que vous faites partie d’une très haute assemblée qui déterminerait l’ensemble des lois et des règles qui doivent régir la société de demain. Vous légiférez sur tout une bonne fois pour toutes et vous tombez raides morts. Vous vous réincarnez dans la société dont vous avez voté les lois mais à n’importe quelle place (femme, nanti, éboueur, enfant d’immigré). Détail important : vous savez, au moment où vous légiférez, que vous êtes appelés à être à n’importe quelle place dans cette future société)
Présupposé : 1) il y a des places plus ou moins enviables : il y a de l’inégalité dans la société
2) le rôle de la loi est d’en réduire les effets
3) notre Société est injuste parce que ceux qui ont le plus de pouvoir ne sont pas ceux qui sont confrontés à des situations sociales et économiques difficiles : on revient à la critique de Bloch.
Conclusion (paradoxale) de Rawls : il faut maintenir une certaine inégalité, dans la mesure où elle profite au Tout : société où il y a des motivations, des stimulations : espoir d’accéder à un meilleur statut). Il faut garder l’inégalité dans la mesure où elle profite aux moins favorisés. Possibilité d’une action en faveur des défavorisés : discrimination positive ?
Aux yeux de beaucoup, il semble trop idéaliste de vouloir supprimer les inégalités : volonté au moins de les limiter :
fixation par Rousseau d’un seuil du tolérable : L’égalité minimale, c’est qu’aucun homme ne puisse en acheter un autre et qu’aucun homme ne soit assez démuni pour être tenté de se vendre à un autre (seuil inférieur en-deçà duquel pas de justice, pas de liberté)
(Réflexion sur le contrat de travail, contrat de droit privé, qu’on passe d’égal à égal )
Rousseau : la Liberté sans l’Egalité n’est qu’un vain mot.
L’inégalité maximale, c’est le refus de voir dans l’autre mon semblable (cf. Controverse de Valladolid ; ou encore le débat théologique du Moyen-Âge sur l’existence d’une âme chez les femmes)
- Quelle conception de la Justice ?
‘A chacun selon la loi’ : positivisme, loi sacralisée
‘A chacun selon son rang’ : sociétés archaïques, statiques, hiérarchiques. Conservatisme
‘A chacun selon ses mérites’ : présupposé du monde capitaliste, du monde du travail : le salaire est adéquat aux mérites
‘A chacun pareil’ : le comble de la justice ou le comble de l’iniquité ? (cf parabole des ouvriers de la dernière heure)
‘A chacun selon ses besoins’ : principe anarchiste, principe des Allocations Familiales
A) Aristote: JUSTICE COMMUTATIVE/ JUSTICE DISTRIBUTIVE
Justice commutative = justice selon l’arithmétique : selon la stricte égalité : à chacun est donné et demandé la même chose.
(cf Gorgias 507a sur l’égalité géométrique)
De la justice distributive, Aristote dit que la répartition se fait « proportionnellement aux besoins et aux mérites » : problème : ce n’est pas du tout la même chose : il faut choisir !
L’équité, c’est : à chacun selon le juste. L’équité est supérieure à l’égalité arithmétique. Ainsi, la justice distributive est préférée à la justice commutative.
Il n’est pas forcément juste que chacun ait « pareil ». A partir de là, il y a encore un choix : 1) les meilleurs doivent avoir le mieux (option Calliclès) (Justice rétributive)
2) les plus démunis doivent avoir le plus (Justice distributive)
Bilan : la justice commutative est éliminée. Ce n’est pas Aristote qui théorise la Justice rétributive, c’est Max Weber.
Max Weber part du constat de l’inégalité des hommes: physique, intellectuelle, morale. Enorme « loterie génétique » (l’inégalité est naturelle).
Deux options : 1) tenter de l’effacer par l’effort social :
JUSTICE DISTRIBUTIVE, corrective
2) tenter de rétribuer chacun selon ses qualités :
JUSTICE RETRIBUTIVE
Mises en œuvre d’une Justice distributive :
BUT : passer de l’égalité en droits à l’égalité en faits (l’égalité réelle).
Pour qu’il y ait « égalité des chances », il faut une volonté politique d’en faire plus pour les plus défavorisés
U.S.A : « affirmative action » : politique des quotas dans les universités (correctif des inégalités culturelles entre ethnies) : seul moyen que le Droit soit au service de la Justice.
En France, « discrimination positive ». Par exemple : obligation faite aux entreprises d’employer des personnes handicapées (amendes si elles ne le font pas) Ou encore la législation sur la parité : en droit, les femmes sont éligibles, aussi représentatives du peuple que les hommes / dans les faits, elles sont très sous représentées dans les sphères du pouvoir.
Cependant, ces lois sont insatisfaisantes : c’est humiliant pour un noir ou une femme d’être accepté « au nom de sa particularité » (le droit est universaliste : l’individu, entité abstraite qui ne doit pas être particularisée). Les hommes sont élus en tant qu’individus, les femmes sont élues en tant que femmes : une femme a le droit de ne pas agir « en tant que femme » J’exige qu’on puisse faire abstraction de ma race, de mon sexe, pour m’élire. Seulement, c’est la seule façon de renverser un rapport de force réel (et immobile)
Ces pratiques sont transitoires, appelées à disparaître (cf : « je serai une post-féministe dans un monde post-patriarcal »). Le jour où on refuse un latino-américain dans une faculté américaine parce que le quota des 11% est atteint, cette mesure se retourne contre l’inégalité)
La démonstration
I . Qu’est-ce qu’une démonstration ?
A) Montrer / Démontrer
Vous êtes dans un marché ; à un stand, le vendeur interpelle le gogo : « approchez tous messieurs et dames, je vais faire sous vos yeux ébahis une démonstration » : et le vendeur de mettre du beurre dans la poêle pour faire cuire la crêpe et vous démontrer que le fond de la poêle ne colle jamais !
Sommes-nous d’accord pour appeler ceci une démonstration ?
Le public qui assiste à la « démonstration » attend d’être convaincu. On est ici dans le registre du « faire-voir » et du « faire-valoir ». La démonstration de la valeur d’un objet technique a pour enjeu le fait d’emporter l’adhésion (= de susciter l’acte d’achat) d’un auditoire. On veut provoquer un effet sur l’opinion. On vise une action qui est une réaction (l’achat). L’intention est flagrante ; c’est elle qui constitue le moteur de la soi-disant « démonstration ».
Mais on s’adresse au voir et non au raisonner : la démonstration commerciale montre plus qu’elle ne démontre. Elle est exhibition. Elle est basée sur une mise en scène / la vraie démonstration, au contraire, s’adresse aux « yeux de l’esprit » : constater une efficacité « de ses propres yeux » constitue, à la limite, un exemple qui rentre dans une preuve mais ne constitue pas une réelle démonstration : il faut maintenir une distinction essentielle entre montrer et démontrer.
Ainsi, c’est de manière abusive que l’on parle de « démonstration en actes ». Je donne un exemple d’une telle démonstration : Platon prétendait définir l’Homme comme un « bipède sans plumes » : démonstration en actes …du contraire (= réfutation en acte) par Diogène le Cynique : il jeta un coq déplumé au milieu de l’assemblée où Platon professait. (Le même réfutait l’impossibilité du mouvement selon Zénon d’Elée…en faisant marcher Achille)
De même, quand on parle de « démonstration de force », c’est de « monstration de force » qu’il faudrait, en toute rigueur, parler.
Montrer concerne l’ordre du visible et du réel / Démontrer concerne l’invisible et l’intellectuel.
Une démonstration est d’emblée quelque chose qui appartient au registre de la connaissance ; son enjeu est général (abstrait), son effet est indirect.
| Les facultés | Les matériaux | Les domaines |
| La Raison
La Logique |
Les symboles
Les chiffres Les expériences Les faits Les objets (« pièces à conviction ») Les mots Les discours (argumentation) |
Les mathématiques
L’histoire La Justice (pénale) La philosophie |
Ex : Théorème d’Euclide : « par deux points distincts, on ne peut mener qu’une seule droite »
La démonstration se fait uniquement grâce à la logique et aux axiomes de base : aucun recours à l’expérience.
Idem : « les 3 angles d’un triangle font deux droits » : démonstration (rationnelle) / vérification (armé du rapporteur et par le calcul des angles).
B) La Raison, faculté sur laquelle s’appuie la démonstration
La démonstration est un processus intellectuel par lequel j’entends prouver que j’ai raison d’affirmer ce que j’affirme : si j’ai raison, cela veut dire que je rejoins dans la vérité LA RAISON, unique, commune à ceux qui savent, et qui veulent, s’en servir.
Descartes : « le bon sens est la chose au monde la mieux partagée » (S 17)
La démonstration appartient au registre de la méthode : cette méthode vise LA VERITE et donc l’ACCORD DES ESPRITS. En effet, si quelque chose est démontrable et que la démonstration est faite à mon intention, je peux ne pas comprendre (celui qui fait la démonstration doit alors reprendre sa démonstration, la recommencer) mais je ne peux pas ne pas y adhérer : c’est la force contraignante de la Vérité : 8X8=64 : on n’est pas libre devant une Vérité démontrable : elle s’impose à nous. Pas de libre-arbitre là-dedans. L’erreur est infinie / la Vérité est une
(C’est le ressort du comique de dénonciation : le tyran absolu : celui qui prétend décider de l’heure qu’il est ou que 5+5 feront 12 : G.Garcia Marquez Cien anos de soledad :le tyran : – quelle heure est-il ?le sujet : – l’heure qu’il vous plaira Seigneur !)
L’énorme avantage qu’on y trouve, c’est l’universalité de ce type de Vérité. Soit je l’ignore, soit je la possède mais si je la possède, je rejoins la foule immense de ceux qui savent, qui sont unis par cette vérité qu’ils possèdent.
La démonstration est le moyen le plus parfait pour s’assurer de la connaissance de quelque chose. C’est la construction, par étapes successives, d’une solution toujours justifiée. C’est un ensemble de propositions (sous forme de symboles ou pas) très rigoureusement enchainées les unes aux autres. Au terme de cet enchainement de propositions se trouve un résultat incontestable (=CQFD)
Rq : c’est un peu la même chose pour l’argumentation, qui n’est pas à proprement parler une démonstration : elle s’appuie elle aussi sur la Raison : l’argumentation s’adresse toujours à un auditoire particulier, mais, à travers lui, elle vise un auditoire universel : on en appelle à l’arbitrage de la Raison.
Texte du Gorgias : l’assentiment de Polos. Socrate en appelle à n’importe quel auditeur de bonne foi
C) La Logique, science de la démonstration
Cette méthode est fondée sur la logique. La logique, science de la démonstration, fut fondée par Aristote (IVème avant JC). C’est une science du raisonnement qui repose sur un ensemble de principes qu’on juge constitutifs du raisonnement humain : on part donc de l’idée que tous les humains ont un esprit constitué de la même façon (postulat de l’identité de la Raison en tous les hommes). Ces principes sont en très petit nombre et constituent l’outil d’un nombre de raisonnements infini.
Je vous donne les trois principaux :
-le principe d’identité (A=A) : derrière son apparente inutilité, il stipule qu’au cours d’un raisonnement, un même terme doit toujours être pris dans le même sens (/ Sophisme)
-le principe de non–contradiction (si A est vrai alors non-A est non-vrai ; A ne peut être à la fois B et non-B) : ex : si un nombre entier est pair, il ne peut pas être impair.
-le principe du tiers exclu (il n’y a que deux valeurs : vrai et non-vrai, pas de 3ème possibilité : de 2 propositions contradictoires, si l’une est vraie, l’autre est nécessairement fausse). On appelle aussi ces principes des lois universelles de la pensée. Elles sont indémontrables.
La démonstration est donc une méthode, fondée sur la logique, dont le but est de donner le maximum de solidité (l’universalité) à ce que l’on pense.
N.B : La démonstration relève d’une exigence de l’esprit : celle de tous ceux qui ne veulent pas se contenter de la conviction morale (texte de Hume : le face-à-face stérile entre ceux qui sont convaincus que le Moi existe et ceux qui ont la conviction intime du contraire) ni du succès qui résulte des applications d’une théorie (argument de Freud : l’hypothèse de l’inconscient est vraie…puisque j’ai des succès thérapeutiques !)
La démonstration repose sur la méthode hypothético-déductive : on part de prémisses dont on ne sait pas si elles sont vraies ou fausses mais on effectue à partir d’elles une déduction rigoureuse qui nous donne l’assurance que si elles sont vraies alors la conclusion l’est aussi.
|
|||
|
|||
C’est le cas du syllogisme (forme classique du raisonnement logique) le plus connu :
Tous les hommes sont mortels (prémisse 1 : majeure)
(Or) Socrate est un homme (prémisse 2 : mineure)
(Donc) Socrate est mortel (conclusion)
( la notion d’ « homme » est le moyen terme : c’est lui le véritable opérateur de la démonstration)
Il conviendrait d’ajouter des si aux prémisses….alors la conclusion serait vraie. Ce qui rend la démonstration certaine, c’est que la conclusion ne renferme rien de plus que ce qui est déjà compris dans les prémisses : le syllogisme n’étend donc jamais notre connaissance : il met en forme de manière rigoureuse nos raisonnements. Simple méthode de déduction.
La Logique est une science formelle : elle s’attache à la forme (correction du raisonnement : validité) et non au contenu (vérité).
L’avantage de la logique formelle, c’est qu’elle permet une distinction précieuse entre la VALIDITE et la VERITE :
Quelques syllogismes…
Tous les hommes sont mortels (prémisse 1 = majeure)
Socrate est un homme (prémisse 2 = mineure)
Socrate est mortel (conclusion)
Certaines femmes sont françaises
Justine est une femme
Justine est française
Certains humains sont des hommes
Gaëlle est humaine
Gaëlle est un homme
« L’enfant marche à quatre pattes
Le chat marche à quatre pattes
L’enfant est un chat »
Cf. Rhinocéros, Ionesco
Toutes les baleines miaulent
Tous les chats sont des baleines
Tous les chats miaulent
La Validité, c’est la rigueur des enchaînements : on l’appelle aussi « vérité formelle »
La Vérité, c’est la conformité du fondement du syllogisme à la réalité : on l’appelle aussi « vérité matérielle ».
Pour qu’il y ait vérité, il faut que le contenu des prémisses soit vrai ET que le jugement soit valide.
N.B : un jugement non valide peut quand même aboutir à une conclusion vraie, mais on ne dira pas de l’ensemble du syllogisme qu’il est vrai.
Aristote nous donne des critères pour distinguer une démonstration valide d’un paralogisme (démonstration fallacieuse : qui veut tromper).
Un paralogisme est un raisonnement qui contredit un (ou plusieurs) des principes logiques :
Exemple :Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous
Plus il y a de trous, moins il y a de gruyère
Donc, plus il y a de gruyère et moins il y a de gruyère
Le terme de gruyère n’est pas pris dans le même sens dans la majeure – morceau de plus en plus grand – et dans la mineure – morceau de taille identique mais dans lequel on ferait de plus en plus de trous.
On pourrait aussi objecter que ce n’est pas vrai parce que c’est l’emmenthal qui possède des trous et non le gruyère : mais on sort alors de la question de la validité (du raisonnement) pour la question de la vérité (l’accord des prémisses avec le réel).
La démonstration ne concerne pas la question du vrai. C’est cela, ce que veut dire « hypothético-déductif » : Pour que la démonstration soit pertinente, il faut que les prémisses soient vraies, MAIS de cela, on ne discute pas. La démonstration n’est pas une méthode de Vérité mais seulement une méthode de raisonnement.
C’est ainsi qu’il faut entendre le « si » : on ne se prononce pas sur la vérité des propositions.
Tout mode de raisonnement de ce type est appelé hypothético-déductif. C’est le cas de la majorité des raisonnements de la science (« si les hypothèses de Darwin sont exactes…on doit observer que… »)
N.B : en philosophie aussi, on est souvent dans l’hypothético-déductif : ex « Si par conscience on entend aptitude à percevoir le réel, alors… »
N.B : Qu’appelle-t-on « un raisonnement par l’absurde » (ou : démonstration par l’absurde) ? : On démontre une proposition en prouvant que sa contradictoire conduit à une conséquence évidemment fausse ; or, de deux propositions contradictoires, si l’une est vraie, l’autre est nécessairement fausse (principe du tiers exclu). Ce mode de démonstration est accepté par commodité, quand il est moins difficile de démontrer la contradictoire que la proposition initiale (démonstration indirecte).
CROIRE (adhésion subjective, optionnelle) / SAVOIR (Vérité objective, contraignante)
INTUITIF/DISCURSIF
Discursif = qui se rapporte à une opération de pensée procédant de manière médiate (jugement, raisonnement…)
Intuitif = possédé de manière immédiate, donné par l’intuition ; toujours déjà présent à l’esprit et considéré comme hors de doute) Il y a deux cas de figure : soit une vérité repose sur une évidence intuitive (non-démontrable mais jugée non susceptible d’erreur) soit elle nécessite une justification rationnelle. C’est la démonstration (rationnelle, toujours sous-entendu) qui fournit la meilleure de ces justifications.
N.B : Descartes considère les vérités intuitives comme plus solides encore que les vérités démontrées mais c’est parce qu’il croit en un Dieu qui sème dans l’esprit humains des « vérités éternelles » innées (ex : idée de Moi, idée de Dieu ; Russ p 194)
D) Argumenter, est-ce démontrer ?
PERSUADER/CONVAINCRE : peut-on démontrer avec des mots ? Une argumentation vaut-elle démonstration ?
L’argumentation cherche-t-elle l’accord ou la vérité ? (enjeu : la philosophie). Accord : il y a plusieurs vérités ; j’en choisis une et je veux y rallier autrui / Vérité : elle est une : il faut la trouver.
Le point commun entre convaincre et persuader, c’est qu’il s’agit de deux actions sur la conscience d’autrui.
Convaincre, c’est entrainer l’assentiment de l’interlocuteur par des arguments rationnels ou par une démonstration. Pour peu qu’on soit capable de suivre une démonstration, on ne peut pas ne pas être d’accord.
Persuader, c’est emporter l’adhésion par tous les moyens possibles : rationnels et irrationnels : en faisant impression sur la sensibilité, les sentiments, sur l’imagination du lecteur. Ainsi, je peux être plus persuadé par l’effet du talent oratoire de mon interlocuteur, par la beauté de son discours, que par le contenu de ce qu’il me dit (l’oral : poids charnel) Caractère impressionnable de l’auditeur. On ne cherche pas le vrai mais le vraisemblable (ce qui a l’apparence du vrai)
Gorgias : un discours produit un effet sur l’auditeur ou le lecteur // dans son livre sur La Psychologie des foules (1865), le sociologue Gustave Le Bon montre que les foules sont particulièrement sensibles à la persuasion). Lorsqu’il est pris dans un groupe, l’individu voit sa faculté de discernement diminuée.
N.B : Platon lui-même a souvent recours aux mythes, quand il considère l’interlocuteur comme incapable de s’élever au rationnel.
N.B : on peut posséder une vérité solide, en être convaincu et pourtant n’en être pas persuadé : cf. Ionesco : tous les hommes se savent mortels mais aucun n’y croit vraiment (cf. « Je sais bien, mais quand même ! … » cf. le roman de Léon Tolstoï : La Mort d’Ivan Illitch).
Ce qui signifie que la conviction comme la persuasion peuvent être coupés de la vérité.
Il est question du type d’adhésion, de rapport, qui nous unit avec une affirmation, avec une vérité.
Platon (in Gorgias): la conviction est la « croyance que donne la science » / la persuasion, la « croyance dénuée de science » : talent de l’orateur + crédulité des auditeurs = vulnérabilité des ignorants.
N.B : frontière faible entre l’une et l’autre : souvent, des motivations egocentriques (la recherche du pouvoir ou son maintien) font glisser de l’argumentation (qui se contente de faire partager ses convictions, de les proposer) vers des techniques de persuasion (manipulation de l’auditeur qui vise à lui imposer certaines opinions). On peut même dire que, dès lors qu’un intérêt est en jeu (ramener des électeurs dans son camp, des ouailles dans son Eglise), tout dispositif argumentatif est une machine de guerre au service de la persuasion.
L’argumentation = une sorte de démonstration, qui se fait sur le terrain du langage, et avec le recours possible à des faits ≠ la démonstration formelle (dont le meilleur exemple est le calcul mathématique), parce qu’elle est sur le plan des idéalités, n’est pas astreinte à cette nécessité de consulter les faits pour savoir si ce qu’on dit est vrai. Elle seule possède une force contraignante.
N.B : il existe des domaines où la démonstration est impossible (ce sont même les plus importants : la vie réelle) : Il est impossible de démontrer la justesse d’une décision morale / il est nécessaire d’argumenter pour la justifier
II. Tout est-il démontrable ?
A) Du besoin de démonstration : qu’est-ce qui doit être démontré ?
- Les thèses = un système de propositions qui ont besoin d’être démontrées. Parce qu’elles ne sont pas des idées claires et simples qu’on possèderait de manière intuitive (des évidences), elles ont besoin d’une justification rationnelle : ex : la thèse de Darwin selon laquelle l’évolution des espèces repose sur un processus de « sélection naturelle du plus apte », n’a rien d’évident. Il faut que Darwin développe tout le dispositif de l’Origine des espècespour parvenir à nous convaincre de la valeur de sa thèse.
Explicitation de ses principes + accumulation d’observations concordantes = conviction rationnelle.
Dans les sciences, à partir du moment où une thèse a reçu une mise en forme rationnelle cohérente (principes, hypothèses, lois), elle est considérée comme une théorie (ex : Darwin : « théorie de l’évolution des espèces » ; Freud : « théorie de l’inconscient psychique »).
On dira plutôt théorie dans le registre de la science et thèse dans celui de la philosophie.
Il s’agit d’une explication plausible et qui se donne le mal de présenter une argumentation qui exhibe les raisons qui la fondent, peu importe, finalement que ces raisons soient des idées, des faits ou des symboles : argumentation rationnelle en mathématique comme en philosophie.
L’opinion, par contre, n’est pas quelque chose d’argumenté : on l’a … sans trop savoir pourquoi : savoir par ouï-dire, sans justification rationnelle (= confiance = croyance)
≠ une thèse n’existe pas sans un corps de propositions qui permettent de la justifier.
B) Toute vérité n’est pas démontrable
- Le domaine de l’irrationnel
Le démontrable = le rationnel ; il va de soi que le domaine de l’irrationnel n’est pas concerné par la démonstration :
- Le divin: s’il y avait une démonstration possible de l’existence de Dieu, la Foi serait tuée (voir / croire cf saint Thomas l’Incrédule). Pourtant, pendant des centaines d’années, les théologiens ont tenté de mener des raisonnements destinés à prouver l’existence de Dieu (ex : saint Anselme : preuve ontologique = preuve par l’idée de parfait : Dieu est l’Etre tel qu’il n’en existe pas de plus grand or, s’il n’existait que dans la pensée, on pourrait en concevoir un plus grand que lui qui existerait aussi dans la réalité donc, Dieu existe nécessairement dans la réalité. / preuve physico-théologique : il y a tant d’ordre, de régularité, de finalité, de beauté, d’unité dans le cosmos, qu’il ne peut être le fruit du hasard)
Dans la Critique de la Raison Pure, Kant expose toute la série des preuves de l’existence de Dieu puis les détruit une à une : par des preuves de la non-existence de Dieu (cf. chap : l’antinomie de la Raison pure : de l’impossibilité d’une preuve ontologique (…etc) de l’existence de Dieu). N’en faites pas pour autant de Kant le roi des athées : il ne l’était pas : seulement, il établit Dieu dans son domaine : celui de l’inconnaissable (non pas « que puis-je savoir ? » mais « que m’est-il permis d’espérer ? ») : CROIRE et SAVOIR sont distincts pour jamais.
Kant : « je devais donc supprimer le savoir pour trouver une place pour la foi » (préface à la 2° édition)
- L’intime, les sentiments: je sens que je suis libre, je sens que je suis amoureux, je sens que je suis angoissé : puis-je le prouver ? éprouver ≠ prouver.
Quelle différence y a-t-il entre exprimer son amour et en faire la preuve ? (les prétendants des contes de fées qu’un méchant beau-père envoie combattre des dragons ou escalader les montagnes…prouvent-ils leur valeur ou leur amour ?) Dom Juan n’est-il pas un expert en « déclarations d’amour » ? (impénétrabilité des consciences, possibilité du « mensonge en actes »).Qu’est-ce qu’une « preuve d’amour » ? (si c’est un diamant (cf.publicité), c’est plutôt une monstration de richesse qu’une démonstration de quoi que ce soit).
Peut-on prouver ses sentiments par des actes (sacrificiels) ? On retrouve le distingo : montrer ≠ démontrer. Les sentiments, nous tentons de les exprimer (et c’est difficile : l’ineffable) mais il n’y a pas de preuve irréfutable à produire à qui nous croit hypocrites. Les meilleurs témoignages sont dans les gestes, les actes : le problème de l’acte, c’est qu’il demande à être interprété (il est ambigu) : il y a des parents qui « dévorent de baisers » leur enfant et qui ne savent pas bien l’aimer pour autant.
C’est aussi la limite au texte de Kant sur la « voix de la conscience » : Kant y exprime son « intime conviction » que tout homme a en lui une conscience morale. En faire la démonstration lui est impossible : c’est le postulat de Kant : vous même devez l’accepter comme tel.
La morale semble appartenir au domaine des sentiments : Comment faire pour convaincre qqn qui ne comprendrait pas que « tuer son semblable » est immoral ? Qui ne verrait pas de problème à infliger une punition injuste (cf le « cabinet noir » du professeur Itard) ? On est démuni. Vous pouvez toujours crier « c’est injuste ! » ; vous ne pouvez rien contre le cynique qui répond : « et alors ?… »
Ex : Le jugement de Salomon = le sacrifice que fait une mère comme preuve qu’elle est bien mère. On a ici un renversement : c’est le sentiment (amour maternel) qui est produit comme preuve d’un fait (avoir donné le jour à…)
- La morale et la politique: domaines où il n’y a pas de vérités universelles mais seulement des certitudes subjectives et des probabilités :
L’argumentation : un mode de raisonnement qui relève de la probabilité plutôt que de la certitude assurée.
Rappelons la distinction que fait Descartes, au début du Discours de la méthode , entre la Théorie et la Pratique : dans la théorie, nous fier seulement aux vérités démontrées / dans la Pratique, nous devons souvent accepter l’incertain, nous contenter du probable et quand même raisonner
L’action juste exige le plus souvent une réponse rapide : s’il fallait se décider après démonstration des raisons d’agir, nous resterions cloués sur place la plupart du temps. Il y a délibération de l’esprit mais dans le domaine de l’opinion : il faut une méthode pour adopter une opinion droite :
Descartes : « Lorsqu’il n’est pas en notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions, nous devons suivre les plus probables ».
Tout n’est pas mathématisable. Une bonne partie de ce qui compte le plus pour les humains n’est pas mathématisable.
Il y a, à présent une question bien plus dérangeante encore: y a-t-il, au sein du domaine rationnel, de l’indémontrable ?
2) le domaine rationnel
– Les axiomes (du verbe grec : « axioun » = juger digne, juger valable): évidence première, prémisse, point de départ d’une démonstration.
Deux cas de figure : soit l’axiome est considéré comme une hypothèse ; soit il est tenu pour un postulat
Distinction entre hypothèse et postulat :
Une hypothèse est une proposition initiale, émise provisoirement, elle se présente comme « à démontrer »
un postulat (≠ axiome) est indémontrable : il est ce qui sert de base à la démonstration (il est quelquefois appelé « proposition première »(ex : toutes les démonstrations de la géométrie sont basées pendant des siècles sur les postulats d’Euclide (qu’on appelle aussi « axiomes d’Euclide »/ géométries non-euclidiennes).
N.B : quand un philosophe nous demande d’accepter un postulat, c’est pour construire, sur la base de ce postulat, un édifice rationnel.
Qu’un postulat soit indémontrable ne l’invalide pas ; tandis qu’une hypothèse indémontrable doit être abandonnée (question du statut de l’inconscient psychique)
- Le modèle de la déduction mathématique:
Euclide : Eléments de géométrie : on part de propositions premières, indémontrables. Ainsi, tout l’édifice de la démonstration repose sur ces indémontrables.
Aristote Organon : toute démonstration part d’une reconnaissance intuitive première, c’est sur cette base qu’on construit un accord raisonné. Il est nécessaire « que la science démonstrative parte de prémisses qui soient vraies, premières, immédiates, plus connues que la conclusion, antérieures à elle, et dont elles sont les causes ».
Descartes : il s’agit d’évidences (vérités premières) : on les connait par intuition / toutes les autres vérités font l’objet d’une déduction.
Leibniz trouve insuffisant ce critère de l’évidence (le préjugé n’est-il pas ce qui, pour l’individu, relève de l’évidence ?)
Le principe d’un raisonnement (= son point de départ) a donc deux statuts très différents: soit on le considère comme une vérité indémontrable, mais évidente, soit on lui donne seulement le statut d’hypothèse qui donne le cadre de référence du raisonnement : les axiomes d’Euclide définissent le système à l’intérieur duquel on va raisonner : géométrie à deux dimensions dans lequel on peut démontrer que la somme des trois angles d’un triangle forme l’équivalent à deux angles droits (= 180°) : en dressant des parallèles aux côtés du triangle, on examine l’équivalence des angles alterne/externe et on démontre que la proposition selon laquelle : « les 3 angles du triangle font 2 droits » est nécessairement vraie. / dans la « géométrie convexe » de Riemann, les axiomes sont différents (géométrie dans l’espace) : les théorèmes d’Euclide ne sont plus vrais (triangle dessiné sur un ballon : angles plus aigus < 180°).
De plus en plus, au XXème siècle, l’axiomatique est comprise comme un système formé d’hypothèses : si l’on modifie les hypothèses, on trouve d’autres résultats.
C’est donc la limite désormais posée à une démonstration : elle ne vaut que dans un cadre donné (un système).
Toute vérité mathématique est relative à son système d’axiomes : toute méthode hypothético déductive repose sur une axiomatique : caractère conditionnel des vérités mathématiques.
Découverte par Gödel (en 1931) de l’inconsistance de certaines théories mathématiques : il peut arriver qu’une théorie prouve à la fois une chose et son contraire (rupture avec le principe du tiers exclu) : la proposition g est démontrable mais non-g l’est aussi : on ne peut savoir si g est vraie ou fausse. En arithmétique, toutes les propositions vraies ne sont pas démontrables. g est indécidable (théorème d’incomplétude). Gödel prouve que la vérité (même mathématique) ne peut pas être exprimée en termes de démonstrabilité.
L’ensemble des vérités possibles est plus important que l’ensemble de ce qui démontrable.
La Réalité est plus riche que l’ensemble des connaissances possibles.
On ne peut enfermer le vrai dans le démontrable ni le démontrable dans la mécanique du calcul.
- Le domaine des sciences expérimentales : le statut des Lois de la nature
Elles sont établies par l’expérience ; elles ne sont pas déduites.
On touche ici à la différence entre déduction et induction :
induire, c’est conclure d’un fait observé un autre fait attendu (anticiper l’expérience future) : on se fonde sur la supposition que l’ordre de la nature est immuable ; que « les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets ».
En toute rigueur, il ne s’agit pas de vérité ici mais seulement de probabilité. Voilà ce qui concerne les sciences expérimentales.
D’où la mise en question de Hume : la relation de causalité est-elle bien fondée (rationnelle) ou relève-t-elle tout simplement de l’habitude : « consécution nécessaire » ? N’est-ce pas finalement notre foi en le « tel que cela c’est toujours passé, cela se passera toujours » ? (…et ainsi, dit Hume, la poule qui a toujours vu la main se tendre pour lui donner du grain se fait un jour égorger en toute confiance par cette même main)
Texte de Hume (Hatier p 245) / Russ p 261 textes 3 et 4
CONCLUSION
Heureusement qu’existe cette procédure qui consacre certaines vérités, les soustrait à l’opinion, fournit les bases d’un accord universel et non subjectif : la démonstration est une école d’impartialité. Il y a une espèce de plénitude du CQFD : tranquille assurance de qui « retombe sur ses pieds ». Satisfaction de l’intelligence devant la boucle bouclée (cercle : figure de la perfection). Ecrire CQFD, c’est écrire : « mission accomplie » par rapport au projet initial. Sentiment jubilatoire que suscite cette formule.
Cependant, la Vérité ne peut être réduite à la démonstrabilité ;
Une démonstration ne crée rien : elle transporte la vérité de ses prémisses vers une conclusion. La démonstration n’est nullement créatrice : n’est fécond que l’acte intuitif de l’intelligence et non le mouvement discursif de l’intellect.
L’intelligence est plus large que l’intellect (le déductif, l’étroitement rationnel).
Le Langage
« C’est une belle folie : parler. Avec cela, l’homme danse sur et par-dessus toute chose »
Nietzsche
I. Définition du langage
Il y a, pour la notion de langage, une différence à faire entre sens étroit et sens large.
Au sens large, le langage signifie tout code, c’est-à-dire tout système de signes utilisé pour établir une communication.
Cela inclut : le langage informatique, mathématique, le langage gestuel, le langage symbolique (ex : rouge pour l’amour ou la révolution), les langages animaux.
Au sens restreint, le langage désigne l’ensemble de la langue et de la parole
LANGAGE = LANGUE + PAROLE
La langue, c’est le code linguistique : un système conventionnel abstrait qui vaut pour une communauté donnée → grammaire, syntaxe
La parole, c’est l’utilisation individuelle de ce code : la réalisation de la langue par les sujets parlants → usage
A travers les termes : langage/langue/parole, on peut retrouver la distinction entre
Universel/Particulier/Singulier (repères p 463)
Ainsi, ce qui est universel, c’est le langage comme fonction de s’exprimer à travers des signes verbaux : aptitude à symboliser, à produire et à transmettre du sens : c’est la faculté symbolique.
L’enfant finit par maîtriser sa langue maternelle sans qu’on la lui ait apprise systématiquement. Il deviendra capable de former, dans cette langue, des tas de phrases bien formées qu’il n’a jamais entendues (il ne les répète pas, il crée dans sa langue : il parle…ce que ne fera jamais le perroquet). La meilleure explication possible de ce phénomène semble être que les êtres humains sont équipés de capacités linguistiques innées, qui leur permettent de reconstruire leur langue en entier, à partir des informations très pauvres qu’ils reçoivent.
La langue est la particularisation de cette fonction dans une communauté donnée.
Dans cette première partie du cours, on se consacrera au sens restreint : le langage comme langage humain.
- Quelles sont les caractéristiques du langage humain ?
- La (double) articulation: 1) unités de sons (phonèmes) : ex : phi/lo/so/phi/que
2) unités de sens (morphèmes) : ex : pré/historique
Le langage est un système très élaboré qui, à l’aide d’un minimum de phonèmes (une trentaine) produit une infinité de significations. Les langues sont régies par un principe d’économie : avec le minimum de matériau (ex : 26 lettres/autant de phonèmes), on produit tout un monde de significations : on peut tout dire. Tout est basé sur le principe de la combinaison : on combine les lettres en phonèmes, les phonèmes en mots, les mots en phrases (les phrases en paragraphes, les paragraphes en discours …)
Cette double articulation distingue les langues humaines des autres systèmes de communication (ex : gestuel ; animal) : plus complexe, son système est aussi beaucoup plus riche.
Le Petit Robert contient 60 000 mots. Nous en utilisons couramment entre 2 000 (quelqu’un d’assez frustre) et 20 000 (les lettrés).
- Historicité du langage humain :
N.B : la reconnaissance de la nature historique du langage ne s’est faite qu’assez tard ; c’est parce que le langage a longtemps été présenté comme étant d’origine divine.
Ainsi, la Bible affirme plutôt l’anhistoricité du langage : La Genèse, chapitre 11 : les hommes parlaient tous un seul langage : celui que Dieu leur avait donné. Mais, au fur et à mesure que les hommes, orgueilleux par nature, se sont sentis devenir plus puissants, ils ont voulu rentrer dans une sorte de compétition avec leur créateur : ils ont entrepris de construire une tour (la tour de Babel), la plus haute possible. C’est alors que Dieu, pour les punir de leur orgueil, leur a envoyé une malédiction : la pluralité des langues
A l’arrière-fond du « mythe de Babel », on trouve l’idéal d’une langue unique (la plus originelle, la plus parfaite) : une langue qui soit débarrassée de l’ambivalence de toute langue : à la fois
- instrument qui permet aux hommes de se comprendre entre eux
- un moyen de ne pas se faire comprendre : d’exclure certains des auditeurs de la compréhension (le sous-entendu, l’implicite, le jargon, l’allusion : le sens ne s’offre qu’à une partie du public).
Le langage joue ces deux fonctions contradictoires.
Aujourd’hui, on sait que les différentes langues s’originent dans un petit nombre de familles de langues originaires (ex : les langues indo-européennes), qu’elles dérivent les unes des autres, qu’elles empruntent les unes aux autres.
- Caractère changeant du langage (c’est le corrélat logique de son historicité)
Ainsi, indépendamment des nouveaux mots qui apparaissent constamment dans les différentes langues (ex : le verbe « kiffer », inexistant il y a 10 ans ; aujourd’hui : « se faire zlataner », Zlatan : joueur de foot du PSG, « on s’enjaille », le twerk : façon de danser, une TSOUIN), la signification des mots est variable suivant les époques
Ex : « terrible » signifie au XVIIIème siècle : qui provoque la terreur // étonnement, qui vient du tonnerre.
Au XXème siècle : sensationnel, génial
De manière générale, on peut dire que les mots s’usent en fonction de leur utilisation : parce que le sens s’affadit, des superlatifs sont ajoutés / parce que les superlatifs se dévaluent, il faut en ajouter toujours plus si l’on veut rendre le même sens.
Un dialecte ( = patois), c’est le résultat de la fixation de la langue à une époque donnée : plus il y a de locuteurs, plus la langue change : l’Acadien (aujourd’hui parlé dans une petite partie du Canada) présente de grandes similitudes avec le français du XVIème siècle !
- Diversité des langues humaines : le langage se particularise en différentes langues, qui sont le propre des hommes unis en une « communauté linguistique ». Aujourd’hui, on recense entre 4 500 et 6 000 langues dans le monde (environ 200 rien qu’en Europe). Parmi celles-ci, 86 langues officielles. Cet usage commun est signe d’une histoire commune, d’une culture commune : c’est pour cela qu’il est un enjeu de pouvoir : il y a une dimension politique des langues.
S’approprier un territoire, c’est très souvent obliger la population à adopter la langue du vainqueur.
- Alsace/Lorraine : unification du territoire – début XXème=abandon des patois locaux au profit de la langue nationale : passage constant du français à l’allemand !
- Enjeu culturel autant que politique pour les indépendantistes (ex: basques) : garder leur langue particulière
- Suite à la conquête de l’indépendance algérienne, imposition de l’arabe (classique/courant) à la place du français (y compris comme langue universitaire)
- Canada : rivalité linguistique (culturelle, politique…) entre anglophones et francophones (Québec)
- En Belgique, conflits séculaires entre Flamands et Wallons
- C’est un langage qui existe sous la forme de l’écrit: c’est important dans la mesure où cela permet (de manière illimitée) le stockage de l’information (de manière beaucoup plus fiable que les traditions orales)
Enjeux : l’éducation ; la perfectibilité ; le progrès de nos connaissances : cf Rousseau : contrairement à l’état de nature, qui est un état de perpétuelle enfance de l’humanité (puisque « la découverte périt avec l’inventeur »), l’écrit permet un accroissement du savoir humain. Un patrimoine culturel se constitue et se transmet : les générations ne repartent pas de zéro (cependant, au niveau individuel : tâche écrasante qui consiste à ingérer ce patrimoine). L’homme est le seul être vivant à avoir un héritage (culturel) et non pas seulement une hérédité (naturelle) (cf.la « mise hors cortex » de nos acquis)
N.B : Platon contre l’écrit : Le Phèdre (Hatier 1 p 283) (41) (19): l’émergence de l’écrit permet-il d’accroître la science et la mémoire ou bien crée-t-elle de faux savants et de vrais ignorants ?
1ère écriture humaine connue : le sumérien (écriture cunéiforme, 3600 avant JC)
- Caractère conventionnel du langage humain :
Même remarque que pour le caractère historique de la langue : le caractère arbitraire du langage humain n’a pas toujours été reconnu : bien des philosophes de l’Antiquité (Platon le premier) ont fait des tentatives pour prouver l’existence d’un « lien naturel » entre le mot et la chose représentée: leur argument est alors celle d’une ressemblance entre eux, un certain rapport de similitude.
On peut citer comme représentatif de cet effort le Cratyle de Platon, dialogue qui oppose Socrate à Hermogène.
L’hypothèse est la suivante (= antithèse) : le langage dérive du cri (la stridence pour l’urgence//la grosse voix pour la menace etc) : il est donc imitatif par essence. Par modulations successives, le cri se perfectionne pour parvenir à plus de différenciation des sons, puis, à leur articulation : de plus en plus, les sons sont séparés distinctement.
A l’appui de cette thèse, on constate un certain mimétisme de certains mots (en allemand, « rutschen » pour glisser ; en anglais, « the crash of a plane » ; en français : murmurer, chuchoter, roucouler ou miauler, un tiGRRe !)Dans ces différents cas, le signe entre dans un rapport de ressemblance avec ce qu’il signifie.
Deux arguments pour réfuter cette thèse :
- Ces mots sont marginaux dans une langue donnée
- Même les mots les plus imitatifs : les onomatopées, sont différents d’une langue à une autre : ils sont donc conventionnels (exemple du cri du coq)
A l’origine était le cri : on veut bien ; mais il faut s’empresser de dire que, du cri au langage, il n’y a pas continuité : il y a un saut. Ce saut, c’est le saut dans la culture.
Le naturel, l’inné, l’universel ≠ le culturel, l’acquis, la particularité
La convention = la diversité
Ainsi, la diversité des langues est une autre preuve de leur caractère conventionnel.
Texte de Benveniste : Hatier : texte 8 p 112 : le caractère arbitraire du langage
Le langage est arbitraire dans la mesure où il est arbitraire que TEL signe (et non tel autre) soit appliqué à TEL élément de la réalité (il y a de la contingence là-dedans). Cependant, pour le sujet parlant, « il y a entre la langue et la réalité adéquation complète »
Texte de Saussure : Hatier : texte 7 p 111 : ce qu’il faut entendre par « arbitraire » ( = choisi sans raison particulière)/ autre texte : Russ p 413 (ex p 443) : arbitraire = immotivé
Thèse : à la différence du symbole, le signe ne ressemble en rien à ce qu’il signifie
On tient les langues pour être des conventions d’usage : on veut dire par là qu’elles se sont établies peu à peu (≠ « au début était le dictionnaire ») : non définies au préalable, elles sont changeantes et non pas rigides : elles méritent pleinement d’être appelées langues vivantes.
- Marque d’une commune humanité: La faculté d’acquisition du langage articulé distingue l’homme des autres espèces animales.
C’est cette intuition que le langage est la caractéristique première de l’homme qui explique que les hommes aient souvent rejeté comme non-humains ceux qui ne parlaient pas leur langue : c’est l’étymologie de « barbare » : injure désignant les étrangers (à la Grèce) comme ceux qu’on ne comprend pas, ceux qui ne parlent pas le grec mais dont les sons sont assimilés aux « BA-BA-BA » des oiseaux( !)
De même, de nombreux groupes humains primitifs se donnent des noms qui signifient : « Nous, les humains », rejetant les membres des autres groupes hors de l’humanité.
Le propre de l’humain, c’est la faculté symbolique : aptitude à produire du sens grâce à des signes, aptitude à symboliser, à entrer dans le monde du sens (que partagent les sourds-muets : ils ont accès au symbolique cf. la scène de « l’enfant sauvage » où ils se racontent des histoires le soir : l’élocution n’est pas primordiale).
Pensons aussi au cas spectaculaire d’Helen Keller : sourde, muette et aveugle depuis l’âge de 19 mois (séquelles d’une maladie), elle a réussi à mettre au point avec sa gouvernante, Anne Sullivan, un système de communication sur la base du toucher (bel exploit). Plus tard, Anne Sullivan lui apprend le braille. Elle devient la première diplômée du supérieur handicapée des Etats-Unis. Elle devint écrivaine et militante. Voir : L’Histoire d’Helen Keller, livre de Lorena A.Hickok, et aussi le film Miracle en Alabama, d’Arthur Penn, en 1962.
On pense aussi au cas de Jean-Dominique Bauby, journaliste de « Elle » terrassé à 44 ans (en 1995) par un A.V.C et rendu invalide (atteint du « locked-in syndrom ») et qui a réussi à écrire un livre : Le Scaphandre et le papillon, écrit avec des simples clignements de sa paupière gauche). Voir aussi le cas de Stephen Hawking, grand mathématicien et physicien américain, atteint de paralysie latérale progressive.
A contrario, il existe des enfants handicapés dont les problèmes psychomoteurs sont si graves que jamais ils n’accèdent au langage.
Conclusion :
Les mots humanisent le réel ; ils humanisent même la mort
Patrick Declerk, Les Naufragés, livre sur les clochards de Paris : à propos de l’enterrement de certains de ces clochards, l’auteur explique que l’inhumanité de leur sépulture ne consiste pas dans la fosse commune ; elle est inhumaine parce que le corps est jeté, sans un mot, dans cette fosse. C’est cela qui est insoutenable : l’absence de mot (et d’abord, du nom propre du mort) pour donner du sens.
Même s’il n’y a pas de Dieu, il faut qu’il y ait une sorte de prière : que quelqu’un dise quelque chose du disparu, de sa disparition : des mots, adressés à d’autres hommes, dont chacun recèle dans sa mémoire une petite part de vie)
D’ailleurs, la « vraie » mort, c’est quand plus personne ne parle de vous. Ainsi, les « exploits », cette machine à faire parler de soi à l’infini, sont un effort vers l’immortalité (« tu as encore fait parler de toi ! »…faire parler de soi, c’est exister)
Texte de Benvéniste (Russ 1 p 472, ex p 513) (20): Le langage est-il un instrument ?
Non, car ce n’est pas l’homme qui fabrique le langage : c’est le langage qui fabrique l’homme. La subjectivité se construit dans le langage (« Est ego qui dit ego »). Les mots constituent le sujet humain. Ne pas savoir parler = ne pas avoir accès à soi-même (c’est très loin d’être seulement un « problème de communication »).
2) Notions élémentaires de linguistique
- Vocabulaire
Précisons la différence entre signifiant, signifié, référent et concept.
Le signifiant, c’est l’aspect matériel du signe linguistique : c’est le mot dans sa matérialité : soit son qui frappe nos oreilles soit trace écrite qui comporte un certain nombre de lettres
Le signifié, c’est l’image que je me fais de la chose (le concept + la connotation que je lui attache)
Le référent, c’est la chose elle-même
Le concept, c’est l’idée générale qui correspond au référent.
Ex : je crie : « Sale chien, va-t-en ! »
Le référent = cet animal-là qui me suit depuis 10 mn en aboyant
Le concept = la notion de mammifère omnivore à 4 pattes, souvent domestique
Le signifiant = le son « chien », crié (ou : le mot de cinq lettres, à l’écrit)
Le signifié = un composé du concept de chien, auquel se rajoute l’image que je me fais du chien (ici : nuisance, hostilité…)
- Ferdinand de Saussure
La linguistique nait au XIXème siècle avec Ferdinand de Saussure :
Avant lui, on considérait une langue comme un vaste système de nomenclature : on réduisait ainsi le langage à ce que fait le dictionnaire : assigner un mot à une chose.
C’est la fonction de désignation (la première, peut-être, qu’utilise le petit enfant)
Saussure dit tout autre chose : le langage est formé de signes linguistiques : les mots
Ces signes linguistiques ne sont pas des signes naturels (ce qu’est la fumée pour le feu), mais des signes conventionnels.
Cela ne veut pas dire que tout signe conventionnel soit un mot (ex : un feu rouge est un signe conventionnel). Simplement, parmi les signes conventionnels, on trouve les signes linguistiques : les mots.
MOT = SIGNIFIE U SIGNIFIANT
Le signifiant, c’est la partie matérielle : le moyen de le dire (son entendu ou trace écrite)
Le signifié, c’est la partie abstraite du langage : ce que l’on veut dire
Mais il faut encore dire que le signifié renvoie à deux réalités différentes (duplicité du signifié):
1) le concept : l’idée générale abstraite (ex : concept de chien)
2) l’image acoustique : la représentation mentale : l’image qui se forme dans ma tête quand j’entends le mot chien
N.B : La plupart du temps, le rapport qui unit le signe (mot) au signifié est totalement arbitraire (Intelligence conceptuelle)
Mais parfois, le rapport du signe à la chose est fondé sur une ressemblance, une analogie : le signe est alors un symbole (Intelligence représentative)
Un symbole est une chose qui en représente une autre en vertu d’une analogie.
Ex : représentation de la Justice par une balance : détour par l’image.
Enjeu de la révolution saussurienne
L’enjeu, c’est que l’idée classique d’une correspondance entre les mots et les choses s’écroule. Il n’y a plus croyance en une correspondance directe entre
Le domaine des choses → Le domaine des mots
Le référent réel (la chose même) n’est plus directement impliqué par le langage : la référence directe aux choses est perdue. On est dans le monde de la représentation (union d’un signifiant concret à un signifié abstrait).
Avec Saussure (avec la linguistique moderne), on considère désormais que le langage unit deux réalités psychiques : le concept et l’image acoustique.
Le langage est coupé du réel : dès lors, quelle garantie avons-nous que le langage rende bien compte du réel ? Quel espoir avons-nous de nous comprendre ? (puisque, quand je parle, c’est en définitive plus de moi que du réel que je parle !)
« Le discours, qu’il soit récit, poésie ou prière, fait un autre monde, de choses, de bêtes et d’hommes, et de tout ce qu’on peut nommer, un monde qui n’apparait jamais »
Alain
Que nous dit dont le langage sur l’homme ? Sur le réel ? Sur la condition humaine ?
Une donnée essentielle est la séparation : séparation de l’homme avec le monde et aussi séparation de l’homme avec l’homme.
C’est le cas tout spécialement des langues qui sont des langues alphabétiques (par opposition aux langues qui reposent sur des idéogrammes, qui incluent une représentation du signifié par le signe) : l’écriture ne représente pas le signifié : elle se contente de renvoyer aux signes phonétiques dont elle est constituée.
Ainsi, comme l’analyse Michel Foucault, on est deux fois éloigné du réel : le signe écrit renvoie au son et le son au signifié.
Qu’un pareil système de signes existe nous dévoile une vérité essentielle de la condition humaine :
- il n’y a pas de relation naturelle (immédiate, directe) entre l’homme et le monde
- il n’y a pas de relation immédiate entre l’homme et l’homme : nous ne sommes jamais sûrs de parler des mêmes choses. Passée une période privilégiée de symbiose organique entre la mère et l’enfant, le petit humain devient un individu (séparé, divisé).
De là, le constat souvent fait de la difficulté des relations intersubjectives.
II . Communication animale et langage humain
- Existe-t-il un langage animal ?
Ce qu’on ne peut nier, c’est que les animaux communiquent au moyen de systèmes de signes : chez les corbeaux, il y a quelques 15 cris différenciés, qui correspondent à des situations différentes
Chez les singes, on dénombre à peu près 70 cris
Penchons-nous sur un système de communication animale très élaborée : le langage des abeilles, étudié par le zoologiste Von Frisch : certaines abeilles effectuent une sorte de danse en forme de 8 dans le plan vertical de la ruche. Alors, les abeilles voisines accourent et collent leurs antennes sur l’abdomen de la « danseuse ».
Von Frisch découvrent que les abeilles communiquent de cette manière quatre types d’informations à leurs congénères :
- La présence d’un butin
- L’espèce des fleurs concernées (communication tactile par l’intermédiaire de l’eau sucrée présente sur les poils de l’abdomen)
- La distance du butin par rapport à la ruche (distance inversement proportionnelle à la vitesse avec laquelle l’abeille décrit le 8)
- La direction du butin : l’angle que décrit le 8 par rapport au soleil et à la ruche indique la direction où se trouvent les fleurs (pourtant, elles ignorent tout du calcul de vecteur !)
Si on définit le langage au sens large (système de signes destinés à obtenir une communication), on est obligé de reconnaître un langage à l’animal.
- Quelles sont les limites du langage animal ?
Le cri animal sert à :
- Avertir d’un danger/ Assurer la protection du territoire : le cri de la marmotte
- Renseigner sur une source de nourriture
- Remplir un rôle d’appel lors de la période de reproduction
- Ce langage est limité dans la mesure où il n’a qu’une fonction : la transmission d’informations, la communication d’un message : c’est le rôle informatif du langage
- De plus, il n’y a là aucune place pour l’affirmation d’une singularité individuelle: le langage est l’expression d’une certaine situation : il dit quelque chose du réel (des circonstances) ; il ne dit rien de l’individu. Une abeille, par exemple, ne peut pas ne pas transmettre une information dont elle dispose (ou falsifier cette information : le mensonge est impossible…ce qui n’est pas le cas chez les chimpanzés) : absence de liberté
Preuve de l’intelligence des singes : les éthologues ont découvert des « conduites de mensonge » chez les singes : deux guenons, plus habiles que les autres dans la recherche de nourriture, sont suivies de près et régulièrement évincées par deux jeunes mâles qui s’emparent de la nourriture : elles ont modifié leur comportement : elles en viennent à faire semblant d’avoir trouvé à manger, et, quand les mâles s’affairent autour de la fausse cachette, elles se hâtent en direction de la bonne (repérée auparavant plus discrètement)
Ceci prouve l’intelligence des singes (femelles…)
Mais c’est une « conduite de mensonge » qui échappe au langage. Quand on enferme une des deux femelles dans une cage, elle tente d’expliquer à l’autre où est la nourriture…mais elle n’y arrive pas)
- C’est un langage sans dialogue: le message transmis ne se communique que dans un sens (pas de « message retour ») : la réponse au message n’est pas un autre message mais une réaction : on sort tout de suite du langage pour l’action (butiner, copuler, fuir…)
- Ce langage répond à un certain nombre de situations pour lesquelles la nature semble l’avoir prévu : il s’apparente à un instinct (pas d’apprentissage)
C’est un langage sans histoire : seulement un code inné, qui relève de l’hérédité biologique (la Nature : domaine de l’universel : le même pour l’abeille turque, polonaise ou japonaise/ la langue : un héritage culturel : particularité ; diversité : pluralité)
N.B : Ne pas considérer pour autant qu’il n’y a aucun acquis de l’animal : chez l’antilope, la peur devant l’homme armé se transmet à ses petits : si cette situation (exceptionnelle) se présente, les petits ressentent la peur de leur mère et s’en souviendront. Mais, en l’absence de cette situation, cet apprentissage ne se fera pas : l’antilope ne possède pas de langage : elle n’a donc pas le pouvoir de dire, en l’absence de l’expérience vécue, ce qu’il faudrait faire dans cette situation. A contrario, seul le langage humain peut transmettre une réalité qui « existe sur le mode du ne-pas-exister » : sur le mode du passé ou bien sur celui de l’imagination.
Ce qui leur manque : les « Si… », les irréels.
- C’est ce qui explique que seul l’être humain peut profiter de la totalité de l’expérience des générations précédentes: l’information animale est toujours ponctuelle et n’existe que dans l’instant / les humains peuvent stocker (à l’infini !) l’information (notion en rapport avec cela : notion de progrès) : possibilité d’un enseignement, d’une transmission du savoir.
CONCLUSION :
Par commodité, on préfèrera parler de communication animale et réserver le terme de langage à l’humain.
Toute communication n’est pas langage.
Toute transmission d’information n’est pas parole.
Une autre question se pose donc à nous : quand on dit que la danse, que la musique, est un langage, est-ce une simple métaphore ?
Y a-t-il un langage du corps ?
Ceci nous met sur la piste d’un autre critère du langage humain : l’intentionnalité. Dans la mesure où l’érection ne peut pas ne pas dire le désir, où la rougeur de mon visage ne peut pas ne pas dire ma colère, est-on encore vraiment dans le langage ?
Le langage suppose la capacité d’adresser intentionnellement des signes intelligibles.
Par rapport aux modes d’expression artistique, il convient de dire autre chose : l’ambiguïté du message est telle qu’on sort presque des limites du langage : sans le titre qui l’accompagne (« Symphonie du Nouveau monde », « Quatre saisons » : comment savoir quel est l’objet auquel la pensée du compositeur se rapporte ?)
Ainsi, sans liberté, pas de langage à proprement parler. Mais si la liberté est absolue, les conditions d’un vrai échange de sens ne sont pas remplies non plus.
- Langage et pouvoir (approche sociologique du langage)
Avec le problème de l’articulation, on envisageait le langage sous son aspect structural (combinaisons). On veut maintenant envisager le langage dans sa fonction sociale : on adopte alors une approche sociologique du langage.
Le langage est d’emblée un phénomène social : apprendre une langue, c’est assimiler une culture
Texte de Benvéniste (photocopie : (21) (42)): « En posant l’homme dans sa relation avec la nature ou dans sa relation avec l’homme… »
- Choisissez trois phrases (correspondant à trois idées importantes)
- Relevez une définition de la Culture
Le langage = les normes, les valeurs
Entretien entre Claude Lévi-Strauss et Georges Charbonnier (43): Produisez un résumé du texte
Le langage est le medium par lequel toutes les règles sociales se transmettent, la convention originaire, d’où procèdent toutes les conventions : l’entrée dans le monde de la règle.
D’où, peut-être, les prises de liberté des surréalistes par rapport au langage pour subvertir la règle : la révolte s’exprime par le cri ou par le refus de parler (à ne pas confondre avec l’aphasie : se rappeler qu’elle est maladie plus que geste « politique »)
Le langage comme révélateur d’une appartenance sociale
Le langage permet d’identifier un individu par rapport au groupe auquel il appartient.
Comment ?
Sa nationalité (langue) ; sa région (accent) ; son niveau socioculturel (nombre de mots à sa disposition, registre du vocabulaire) ; son âge (grâce toujours au registre de son vocabulaire…mais avec une marge d’erreur assez grande)
- Langage et domination : le langage comme instrument du pouvoir
Le langage est une technique, plus ou moins bien maîtrisée. Or, nous
sommes notoirement inégaux par rapport au langage : alors que les uns jouissent d’une remarquable « facilité d’expression », les autres seront toujours stigmatisés lors de chacune de leurs prises de parole…à moins qu’ils ne se résignent à en laisser d’autres parler à leur place.
Or, cette « facilité d’expression » est la conséquence directe d’une communion à un patrimoine culturel : c’est la société – par l’intermédiaire de notre milieu éducatif- qui nous a appris à penser en nous donnant les mots.
Comme l’indique Bourdieu, si, en théorie, le langage est un instrument au service de tous, en pratique, il y a un accès discriminé aux techniques du langage (il suffit d’écouter un micro-trottoir pour le constater). Parler : une technique (comme toutes les autres, elle requiert un certain savoir-faire)
L’oral:
Les classes dominantes ont « le verbe haut » ; ce sont aussi plus souvent leurs membres qui peuvent avoir recours au pouvoir excluant du langage technique (le jargon).
Les dominés se voient souvent confisquer la parole. Quand ce n’est pas le cas, ils constatent leurs difficultés à exprimer ce qu’ils pensent.
Longtemps, des joutes oratoires- les « disputatio »- faisaient pleinement partie de l’éducation des classes dominantes : la disputatio confronte deux adversaires dans une sorte de joute verbale qui a ses propres règles (cf. le film Ridicule, Patrice Leconte, 1996)
Ce qu’il en reste aujourd’hui : le débat politique télévisé, aves son si strict minutage du temps de parole : quelle meilleure reconnaissance du pouvoir des mots !
La philosophie de la Renaissance est largement héritière de cette tradition de discours polémiques selon les règles de la rhétorique.
Rhétorique : science du discours dont le but est de con/vaincre (vocabulaire du combat)
Dans l’Antiquité grecque, ce sont les Sophistes qui sont les maîtres de la rhétorique.
Ils sont en bute aux attaques de Platon : celui qui use bien des mots se rend facilement maître des hommes (qui use bien des mots peut abuser les hommes/des hommes)
Dans Le Gorgias, Platon se scandalise de la supériorité du « beau-parleur » sur celui qui possède la compétence : les Sophistes ridiculiseront le chef de l’armée sur les questions militaires ; l’agriculteur en ce qui concerne les choses de la terre ; le médecin en ce qui concerne la médecine.
Or, il s’agit d’une supériorité usurpée, mensongère (une illusion de compétence) : persuader l’autre que vous avez raison est beaucoup plus utile que d’avoir réellement raison ! L’apparence prend le pas sur la vérité.
Ainsi, les Sophistes apprennent à leurs élèves à ne pas apprendre : à quoi bon le savoir quand l’ignorance peut s’en donner le masque (pour les élèves, cela représente un gain de temps prodigieux : c’est pourquoi ils sont prêts à payer si cher les leçons des Sophistes !). Nous sommes dans le mode de l’apparence ; or, cette apparence permet de conquérir un pouvoir bien réel.
Platon propose donc de cultiver une saine méfiance à l’égard du langage (et des beaux-parleurs cf. Don Juan).
N.B : la philosophie est bien l’héritière de cette méfiance à l’égard du langage : c’est d’elle que procède l’invention d’une langue philosophique plus pure, plus précise, que la langue courante. Une langue non pas séductrice mais austère, non pas ensorceleuse mais précise.
Le philosophe est celui qui refuse de ne pas maîtriser pleinement ce qu’il dit : d’où l’entreprise d’analyser les outils de la pensée (les mots, notions, concepts) cf ; Initiations et méthodes p 25.
L’écrit :
Longtemps, c’est l’écrit qui était le facteur discriminant : au Moyen-âge, posséder l’écriture est le privilège de quelques-uns : les savants, les « clercs » : il y un monopole du pouvoir culturel.
Ainsi, l’écrit a représenté un enjeu culturel pour ceux qui en étaient initialement exclus (les classes populaires, les femmes).
Illustration ethnologique :
Récit de Claude Lévi-Strauss (22): le mimétisme de l’écriture et de la lecture chez les Nambikwara, indiens nomades d’Amazonie (Brésil):
« On se doute que les Nambikwara ne savent pas écrire : mais ils ne dessinent pas davantage, à l’exception de quelques pointillés ou zigzag sur leurs calebasses. Je distribuai pourtant des feuilles de papier et des crayons dont ils ne firent rien au début ; puis un jour, je les vis tous occupés à tracer sur le papier des lignes horizontales ondulées. Que voulaient-ils donc faire ? Je dus me rendre à l’évidence : ils écrivaient ou, plus exactement, cherchaient à faire de leur crayon le même usage que moi, le seul qu’ils pussent alors concevoir, car je n’avais pas encore essayé de les distraire par mes dessins. Pour la plupart, l’effort s’arrêtait là ; mais le chef de la bande voyait plus loin. Seul, sans doute, il avait compris la fonction de l’écriture. Aussi m’a-t-il réclamé un bloc-notes et nous sommes pareillement équipés quand nous travaillons ensemble. Il ne me communique pas verbalement les informations que je lui demande, mais trace sur son papier des lignes sinueuses et me les présente, comme si je devais lire sa réponse. Lui-même est à moitié dupe de sa comédie ; chaque fois que sa main achève une ligne, il l’examine soigneusement comme si la signification devait en jaillir, et la même désillusion se peint sur son visage. Mais il n’en convient pas ; et il est tacitement entendu entre nous que son grimoire possède un sens que je feins de déchiffrer ; le commentaire verbal suit presque aussitôt et me dispense de réclamer les éclaircissements nécessaires. »
C.Lévi-Strauss Tristes Tropiques (Plon p 339)
Seul le chef a compris que la finalité de l’écriture est plus politique que théorique : elle établit une connivence-une égalité- entre le chef de l’expédition blanche et le chef de la tribu. C’est une fonction élective : elle accroît le prestige et l’autorité du chef.
Roland Barthes : « Le langage est une législation, la langue en est le code. Nous ne voyons pas le pouvoir qui est dans la langue parce que nous oublions que toute langue est un classement et que tout classement est oppressif. Parler, et à plus forte raison discourir, ce n’est pas communiquer, comme on le répète trop souvent, c’est assujettir ».
C) Le pouvoir des mots
1) Nommer est un pouvoir
Dans le récit de la Genèse, Dieu institue l’homme maître des choses et des bêtes en lui donnant le pouvoir de les nommer :
Nommer les choses = acquérir un certain pouvoir sur elles
Dans cet acte de nommer, il y a une prise de possession symbolique, comme si le langage avait la faculté de « capturer la réalité »
C’est que, par les mots, il y a en effet la création d’une sorte de monde intérieur, de duplication mentale des choses : une fonction d’appropriation du monde
Et, en même temps, il y a une sorte de dépossession :
Je donne un exemple : ce que je croyais être absolument singulier (certaine pratique solitaire) est quelque chose de commun : l’enfant est par là rassuré (je ne suis pas isolé dans ma singularité) et déçu (c’est banal).
Quand on veut brider la pensée des gens, on bride leur langage :
EXERCICE : George Orwell, 1984 : invention d’une NOVLANGUE: Grain de Philo #4 : 15’19
Depuis vendredi 15 décembre 2017, 7 termes sont bannis des documents d’un organisme américain dépendant du ministère de la Santé : « fœtus », « transgenre », « vulnérable », « diversité », « fondé sur la science », « fondé sur des faits » et « droits ».
Décision révélée par le quotidien Washington Post
2) Utilisations spécifiques du langage
A-t-on tort de considérer le langage et la violence comme des contraires ?
Y a-t-il bien une alternative entre le langage et la violence ou bien les mots sont-ils l’instrument d’une autre sorte de violence ?
Le chantage (langage comme moyen de pression)
Le secret (« ce qui se dit tout bas et deux par deux » : la raison d’être d’un secret est d’être dit + d’établir le caractère sacré de ce « dire »)
L’intimidation (quand un adulte tonne de sa grosse voix aux oreilles d’un enfant : la puissance de la voix comme signal de la puissance physique)
L’injure, les paroles blessantes : la parole peut être l’instrument qui sert à exprimer le mépris.
(On peut ainsi tenir qu’une bonne partie du racisme tient dans le langage : il y a toute une catégorie de gens bien incapables d’aller brûler des foyers d’immigrés mais qui ne se privent pas de tenir des propos racistes).
A-t-on donc tort de considérer langage et violence comme des contraires ?
Il y a des silences respectueux et des silences méprisants ; il y a des paroles aboyeuses, des paroles qui accaparent. Il y a des usages violents du langage et aussi un rapport évident entre langage et domination.
Et pourtant, nous continuons à penser que le langage et la violence sont antithétiques. Car choisir le langage, c’est souvent avoir exclu le recours à la contrainte.
Il y a un enjeu démocratique du langage : si vous prenez la peine (le temps) de convaincre quelqu’un, c’est que vous avez exclu le recours à la contrainte.
De plus, prendre la peine d’essayer de convaincre autrui, c’est s’en remettre à sa raison, ce qui implique déjà qu’on le considère comme un égal.
Les mots efficaces : les performatifs
Il existe une catégorie particulière de mots, mis à jour par le philosophe anglais John Langshaw Austin (XXème siècle ; Quand dire c’est faire : How to do things with words, 1962) : les performatifs (de l’anglais « to perform »= accomplir).
DIRE = FAIRE
Ex : « je vous radie de l’université » ; « je te lègue ma montre » ; « je vous baptise »
Le langage est alors moyen d’agir sur les autres et sur le monde : il est en même temps énonciation et action (≠ langage purement descriptif : « je mange », « je meurs »)
D) Une langue : une certaine vision du monde
L’étude d’une langue peut nous renseigner sur ce qui caractérise une culture par rapport à une autre : une langue, c’est toujours un certain rapport au réel.
Ainsi, on peut proposer l’interprétation suivante :
- L’Anglais est la langue du temps, une langue qui a une conscience aigüe du temps (cet intérêt est lisible dans les verbes : présent progressif : action longue/ présent perfect : action courte)
- L’Allemand, la langue de l’espace : il y a une attention particulière donnée à l’espace grâce aux préfixes et aux suffixes qui indiquent s’il y a mouvement, direction ou provenance (aus, nach, vorher, vorhin).
Ce genre de constat porte sur ce qu’on peut appeler l’esprit de la langue : chaque langue a son « génie » propre. A chaque langue correspond une vision particulière du monde, un certain mode de pensée (quelle chance ont les bilingues, qui « circulent » dans deux univers !)
Le langage = ce qui structure inconsciemment notre façon de penser : il nous donne les catégories qui modélisent notre façon de voir le monde.
Chaque langue est une « mise en forme » du monde.
Le langage conditionne la pensée : à la fois merveilleux outil et facteur qui limite
Autre critère : le nombre de signifiants disponibles pour un seul signifié
Erreur : il y a autant de signifiés différents qu’il y a de mots différents : il y a une vision infiniment plus précise de certains aspects du monde)
Il y a, parait-il, chez les Lapons, 60 mots pour dire « la neige » (Khodoss T1 p 288)
Il y a, chez les Inuits (dont la langue est l’Inuktitut) 16 façons de dire « blanc »
PERCEPTION DES COULEURS : Chez les Berinmos, chasseurs cueilleurs de Papouasie Nouvelle Guinée, il y a un mot (le NOL) pour nommer ce que nous européen distinguons comme deux couleurs (BLEU/VERT). L’influence du langage st prépondérante dans la catégorisation des couleurs.
Le vocabulaire disponible pour dire les couleurs aiguise notre sensibilité . Ex : rouge grenat, rouge carmin, rouge bordeaux, rouge sang, rouge vermillon, rouge basque, etc
Autre critère : les mots qui n’existent pas :
Autre exemple : to glare : « lancer un regard furieux »
La création de mots n’est pas quelque chose d’anodin : il y a aujourd’hui en France un problème qui concerne la féminisation des titres et des professions :
On dit une directrice d’Ecole mais Madame le P.D.G
Une maîtresse d’Ecole mais un(e) Maître de Conférences
On dit une caissière mais moins facilement une vétérinaire
On dit une logeuse mais un Proviseur-femme
On dit un sculpteur pour une sculpteuse
On devrait dire, mais on ne dit pas souvent, une juge, une pharmacienne
Il arrive que la création de mots soit très importante du point de vue de la chose nommée
Chose nommée = chose reconnue = chose consacrée
La nomination est toujours comme un acte sacré, une sorte de baptême
Ex : la création par Marx du mot « prolétariat » = de la notion de prolétariat : elle a posé l’existence de la classe ouvrière comme une entité à part entière
Les ouvriers / le prolétariat : des individus dispersés / une unité, une solidarité suggérée : la création du mot prolétariat a contribué à donner aux ouvriers conscience d’eux-mêmes comme une classe.
Les mots ne sont pas innocents.
Ex : « femme de ménage » : pas un simple métier c’est comme si toute ma nature – tout mon être- était résumé dans cette fonction : faire le ménage)
Mélenchon a récemment répliqué à un journaliste, sur RFM, qu’il fallait parler d’ « épuisement professionnel » et non de « burn out », non seulement parce que ce dernier terme est incompréhensible d’une masse de travailleurs, mais parce que le mot français renvoie clairement au TRAVAIL et pose ainsi la question de la responsabilité PATRONALE.
Les mots ont un pouvoir : à travers eux se structure la perception du monde dans lequel nous vivons.
Wittgenstein : « Les limites de mon langage signifient les limites de mon propre monde »
« La philosophie est une lutte contre la manière dont le langage ensorcelle notre intelligence » (Tractatus logico philosophicus)
IV. Langage et subjectivité
- Quand le rôle suggestif l’emporte sur le rôle informatif
Enoncé = désignation + connotation
C’est la fonction suggestive du langage : il n’y a jamais de neutralité : parler, c’est prendre position.
Soient deux énoncés :
- X n’a pas lu tous les romans de Balzac
- Y a lu quelques romans de Balzac
A qui vous adressez-vous ?
L’impression laissée par l’énoncé a) est plutôt négative / par b), plutôt positive
Pourtant, l’information est la même !
De même :
- Elle fume peu (bravo !)
- Elle fume un peu (elle ferait mieux de ne pas le faire)
Cf. Texte de Brecht : (44)
Aujourd’hui, à propos des camps d’extermination, les historiens voudraient que le public parle plutôt de centres de mise à mort ou de centres d’assassinats.
Autre exemple (dans le même contexte historique) : les nazis appelaient « la mort miséricordieuse » le meurtre de tous les malades mentaux et autres individus inaptes au travail (ce sont les 1ers à avoir été exterminés).
Actualité brûlante : aujourd’hui, en Pologne, des lois punissent d’emprisonnement toute personne qui mentionne « les camps de la mort » polonais : négation d’une collaboration avec les nazis.
A l’inverse, il y a de multiples euphémisations dans la langue : les mal voyants, les mal entendants, les personnes à mobilité réduite etc.
Ici, le rôle suggestif du discours prend le pas sur le rôle informatif.
Explicitons la fonction expressive du langage.
Rappel : le langage = quelque chose qui appartient à tous les hommes (la faculté symbolique)
La parole = ce en quoi je fais mien le langage ; je m’en sers pour exprimer ce que j’ai de plus singulier
Je quitte la passivité de l’impression (par quoi le monde laisse sa trace sur moi) pour accéder à l’intentionnalité de l’expression (libération, extériorisation bénéfique de moi-même).
Quand je dis que « je m’exprime », il y a là l’idée d’un passage de ce qu’il y a en moi de plus intérieur, intime, à l’extérieur de moi (il faut penser au fruit qui exprime son jus…mais un fruit qui le ferait de lui-même)
2) le langage : de la généralité à la singularité ?
Préparation sur le texte de Bergson (45) (23) :
Valorisation de la parole : individualisation du langage (utilisation par une personne singulière) ; son incarnation : principe de pluralité : deux personnes ayant à leur disposition la même langue, les mêmes mots, ne s’exprimeront pas de la même manière.
C’est cette possibilité d’originalité, d’utilisation différenciée, qui permet qu’il y ait quelque chose comme la littérature : c’est elle qui rend compte du fait qu’on puisse préférer au fait de dire « je suis triste » celui d’entamer un poème : « il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville… » (Verlaine Ariettes oubliées )
Ce qui fait la puissance poétique d’un texte, c’est que le sens est moins à chercher dans les mots (sens du dictionnaire, univocité, limitation) qu’à travers les mots.
Entre les mots, il y a à lire, à comprendre, à sentir bien des choses (parmi lesquelles, l’état d’esprit de celui qui s’exprime.
Ma parole est l’expression de ma façon d’être au monde.
Dans l’utilisation poétique du langage, on n’oublie pas que les mots peuvent prendre un sens qui dépasse leur seule signification
Signification : mise en rapport du signifiant et du signifié codifiée par le dictionnaire
On reconnaît ainsi une double fonction du langage :
- signifier : produire, par l’usage du signe, une signification
- suggérer : le langage est alors utilisé pour faire appel à l’expérience d’autrui, à la matière même de sa vie.
Pour la fonction signifiante du langage, le mot, la phrase, sont des substituts d’images, des signes d’une réalité extérieure.
Pour la fonction suggestive du langage, le mot est comme un « excitateur de pensées », d’émotions… : le point de départ d’une création de la part du lecteur et de l’auditeur
Texte de Léopardi : le mot /le terme (46)
3) Langues naturelles et langues formelles
Les premières sont les langues vivantes, dont on a déjà parlé. En ce qui les concerne, à un seul signe peuvent correspondre plusieurs sens (existence d’homonymes : ex : sens direction / sens signification).
De là résultent des difficultés de compréhension.
De là aussi le recours à l’interprétation : elle est symptôme d’un problème (une difficulté à comprendre : obligation de prendre en compte non seulement le texte mais aussi le contexte). Mais elle est aussi une chance, une liberté qui nous est donnée.
D’où la richesse d’un texte littéraire : à la fois multiplicité de ses interprétations possibles, qui permettent à la subjectivité, à la sensibilité, de rentrer en jeu.
Les langues formelles (ex : les langues mathématiques) sont au contraire dénuées de toute ambiguïté : à un signe correspond un sens et un seul.
Mais sans ambiguïté, pas non plus de souplesse, pas non plus de richesse (pas d’initiative laissée au lecteur, à l’auditeur). Les mathématiques nous offrent l’exemple d’un langage parfaitement univoque (parfaite adéquation du sens au signe) mais ce langage parfait est aussi insignifiant qu’in est clair : c’est la platitude de la tautologie.
Son contraire : le langage poétique, où la combinaison toujours improbable des termes produit une certaine inadéquation du signe au sens qui produit une impression de profondeur (on n’en reste pas à la surface du signe).
Cependant, n’y a-t-il pas un « reste » du langage ? Quelque chose qui refuse de passer par les « filtres » du langage ?
4) L’ineffable : quelles sont ses sources ?
- L’irrationnel ; par exemple : le divin : dans la religion juive, de même qu’il n’y a aucune représentation de Dieu, la religion l’interdisant, le tétragramme YHWH renvoie à Yahvé mais comme à un nom tabou parce que sacré: imprononçable. A d’autres occasions, Dieu est désigné par des périphrases : « le Très Haut », le « Fils de l’Homme ». On parle quelquefois de « théologie négative » : on peut dire ce que Dieu n’est pas, non pas ce qu’il est. Autre exemple d’irrationnel : l’expérience de l’extase, de tous les « états seconds »
- L’originalité (la singularité) : pauvreté du « je t’aime » par rapport à ce qu’on voudrait exprimer ; tous les moments de votre vie où vous regrettez de n’avoir à votre disposition que les mots de tout le monde quand vous voudriez exprimer quelque chose d’unique, d’incomparable.
- La subjectivité : ce qu’il y a en nous de plus intime, il est très difficile de l’exprimer. On pense à la psychanalyse, qui place au cœur de la personne le secret : noyau inconscient et indicible de la personnalité. Penser également aux émotions : une douleur appartient souvent à l’indicible. La seule façon possible d’exprimer cela : l’ART.
- Il existe, dans le bouddhisme, le mot « tathata » qui signifie : « le fait d’être ainsi ». C’est sans doute un mot issu des premiers efforts de parole du petit enfant, quand il tente de désigner les choses existantes en les montrant du doigt et en s’exclamant « Ta ! » ou « ça ! ». Ainsi, le « tathata »= le domaine de l’expérience non verbale, la réalité telle que nous la percevons directement : nous voyons et sentons plutôt que nous ne disons et pensons. Le yoga bouddhiste consiste à atténuer l’action discriminatoire (classifiante) de l’esprit, de manière que le monde puisse être perçu sous sa forme authentique, inclassifiée.
Le « tathata » = le monde tel qu’il est, non falsifié et non divisé par les symboles et les définitions de la pensée.
V. Le langage et la pensée
texte de Hegel (24) :
Y a-t-il antériorité de la pensée sur le langage ?
C’est facile de partir du constat de l’inadéquation du langage à nos sentiments, du constat que le langage est tout autant un obstacle à l’expression que son moyen. Cela nous fait plaisir au sens où cela nous donne l’idée que la pensée est infiniment plus riche que le langage : le langage n’est alors qu’un véhicule – tout à fait imparfait- de la pensée.
On retrouve ici l’idée banale que le langage sclérose la pensée, la fige, la mutile (puisqu’avec des mots communs, il nous faut dire des choses personnelles, uniques, singulière : on pense au texte de Bergson)
Pourtant, est-il possible de dissocier ainsi pensée et langage ? Est-ce que cela a un sens de chercher l’antériorité de l’une sur l’autre ?
Cette conception ne résiste pas à l’examen ; car sans le langage, la pensée ne peut pas se développer et, à la limite, elle ne peut pas du tout émerger (cf Victor, « l’enfant sauvage » de l’Aveyron)
N.B : le langage appartient à deux registres : AUTRUI (extériorité) or, dans ce texte, rien sur la communication. MOI (intériorité)
Ainsi, il faut envisager la pensée comme un monologue intérieur. Elle est, comme le dit Platon dans le Théétète, « un discours que l’âme se tient à elle-même ».
Essayez donc de trouver en vous une pensée qui ne soit pas verbale : qu’est-ce ? (un sentiment ; une émotion ; une image…).
La pensée et le langage sont complémentaires, indissociables et simultanés.
L’expression « pensée discursive » dit bien que la pensée est déjà un discours.
Il n’y a pas de préexistence de la pensée par rapport à la parole ; la pensée ne préexiste pas à son expression verbale.
« Les pensées naissent tout habillées » Oscar Wilde
Le langage n’est pas le signal, le rappel de notre pensée (conception intellectualiste) : il est déjà lui-même pensée. Le langage n’est pas seulement la transmission de la pensée mais sa réalisation. La parole ne traduit pas une pensée déjà faite ; elle l’accomplit.
Etude du texte de Claude Pariente (« Robert a acheté le Figaro ») (cours sur l’interprétation) : (49)
Qu’est-ce qu’être « mûr pour la linguistique » ?
- se rendre compte que la structure de la phrase induit des effets de pensée (= des interprétations)
- écouter une phrase, c’est « travailler dur » : retenir les hypothèses les plus plausibles en fonction du contexte (nos éléments de connaissance, la situation)
Conclusion : les différentes fonctions du langage
- Fonction informative : Emetteur → Destinataire (la flèche véhicule le message)
- Fonction expressive : le langage me sert à exprimer ma pensée : le mouvement va de l’intériorité vers l’extériorité. Quelquefois, le langage permet le passage d’une conviction subjective à une connaissance objective. C’est cette fonction qui donne le plus lieu à une insatisfaction par rapport au langage (« ce n’est pas ce que je voulais dire ») : il y a quelquefois échec de l’intention d’expression. Cet échec fait signe vers une autre fonction du langage : le dialogue, où l’autre m’aide à me comprendre moi-même
- Fonction relationnelle (la communication): le seul critère de la parole, c’est la relation inter subjective. La communication réalisée, c’est la conscience d’avoir, de part et d’autre, donné et reçu. De là une fonction essentielle du langage : se sentir épaulé par les autres, écouté, compris par eux (cf. les standards téléphoniques pour humains en détresse)
Dans les groupes de singes, beaucoup de temps est passé à l’épouillage (pratique sociale de pacification plus que souci d’hygiène corporelle). L’hypothèse est que le langage (chez l’humain ou parce que le groupe devient trop grand) remplit la même fonction.
- Fonction psychosociologique : parler sert à trouver sa place dans le groupe (le boute-en-train et l’intello du groupe n’y ont pas la même parole). Ici, on pourrait aussi parler d’une fonction politique: convaincre, persuader, dominer, se font à l’intérieur du langage.
- Fonction suggestive : c’est celle ou le dire importe autant et même plus que le dit
- Fonction psychanalytique : le langage est l’instrument de la catharsis (libération de pensées inconscientes). L’être humain trouve dans le langage une sorte d’équivalent de l’acte (injurier pour frapper, calomnier pour venger…).
Le travail et la technique

La technique comme le travail sont des inventions humaines (qqch d’artificiel) : l’homme fait surgir quelque chose qui n’existe pas dans la nature. Ce sont des déploiements d’une activité humaine rationnelle, finalisée, qui a pour but de transformer la nature, de l’utiliser.
L’ensemble des activités humaines par lesquelles nous modifions volontairement notre environnement.
Un ensemble de moyens artificiels qui ont pour but une amélioration des conditions de vie de l’homme et pour effet de transformer la nature.
L’homme est-il le rival de la nature ou bien est-il lui même un animal?
Physiologie ? (Mammifère omnivore, primate, 23 paires de chromosomes ; longévité de 70 ans, gestation de 9 mois)
Alimentation ?
Reproduction ? ( très loin de la fécondité naturelle)
Milieu de vie ? ( un pourcentage énorme d’humains vivent en ville //même la campagne n’est pas la nature)
« L’homme est l’animal qui dit non » Eric Weil (voir cours sur la culture), qui tourne le dos à son animalité : qui crée la technique, la culture, pour ne pas en rester au donné naturel : l’artifice (l’artefact, tout ce qui est inventé par l’homme) est pour lui une seconde nature.
Parler de la technique, c’est situer l’homme entre ce qui est en-deçà de lui (l’animal, qui utilise des techniques mais ne crée pas d’univers technique ; ne travaille pas) et ce qui est au-delà: la divinité, qui n’a pas besoin de laborieuses médiations (quand Dieu conçoit la chose, il l’accomplit dans son acte de volonté).
On s’en réfère à Pascal, qui parle de l’homme comme une sorte de « milieu entre rien et tout » ; entre « l’ange et la bête ».
Ainsi, parler de la technique et du travail, c’est parler de la condition humaine. Il y a là un enjeu anthropologique évident.
I. Technique, travail et condition humaine
- A) Les dieux travaillent-ils ?
On est dans la représentation (le travail est-il valorisé ou dévalorisé ?)
Dans l’Antiquité, oui : dans la mythologie grecque, les dieux sont les possesseurs initiaux de la technique ; ils la gardent même jalousement, comme leur privilège.
Ainsi, Hésiode (Les travaux et les jours) indique-t-il que dieu (Zeus) fabrique, assemble, produit (l’orage, la pluie, la grêle)
De même, dans Le Timée, Platon dit que dieu construit le monde à partir d’éléments premiers : éléments pré-existants de tous ordres qu’il « assemble, mélange, transforme, ajuste » les uns aux autres, à la lumière de son savoir.
Les grecs conçoivent donc des dieux bricoleurs, le dieu-technicien par excellence étant Héphaïstos, le dieu-forgeron.
Le feu est le grand symbole de la technique : pourquoi ?
Dans la préhistoire, la conquête du feu est une étape déterminante de la conquête, par l’homme, de son humanité (aliments cuits : disponibilité…pour la pensée ?/ protection contre les bêtes féroces : sécurité / métallurgie : véritable âge de le technique)
Nouveauté dans le monde judéo-chrétien : Dieu n’est pas un fabricateur mais un créateur. Notion de création « ex-nihilo » : une fabrication qui n’en est pas une : pas de matière, pas de temps de réalisation (en rupture complète avec l’anthropomorphisme grec : création impensable pour nous humains : même la création artistique est mise en œuvre de matériaux, de temps, d’une « technique »)
Séparation tout à fait nette entre l’ordre des choses divines / l’ordre des choses humaines.
Le divin = l’immédiat (Dieu : son Vouloir = un Pouvoir = un Faire !) : pas de séparation entre l’ordre de la pensée (le vouloir) et l’ordre de l’action (la réalisation)
L’humain = le domaine de la médiation (LA grande catégorie philosophique pertinente pour penser la technique)
La technè grecque signifie un SAVOIR en même temps qu’un FAIRE (les deux ne sont pas distingués, encore moins hiérarchisés). Elle est le domaine de la mise en œuvre de matière ; de moyens (articulés les uns aux autres) ; de temps.
Ceci projette donc une image plutôt dévalorisée de la technique : nous sommes condamnés à l’action technique parce que nous ne sommes pas tout-puissants.
Mais c’est plus complexe que cela, car, dans le monde grec, le travail est dévolu aux esclaves : seules les activités intellectuelles sont considérées comme dignes d’un homme libre. A contrario, dans le monde chrétien, le travail est présenté comme formateur : il est demandé aux moines de travailler, à l’image de Dieu. De même pour la religion juive, tous les grands rabbins exerçaient en même temps un métier artisanal.
Le pape Benoît XVI, dans son discours aux Bernardins (2008) affirme même qu’il y a dans le monde gréco-romain une différence essentielle entre Dieu et le démiurge : le « sale boulot » de la fabrication du monde échoit au démiurge. Par opposition, le Dieu de la Bible est un dieu qui travaille.
La technique débouche généralement sur la création d’un réseau d’objets spécifiques…mais pas toujours :
- elle est la réalisation d’un objet
- elle est la réalisation d’une action (traverser la rivière) : un savoir-faire physique
- elle est la réalisation d’une opération mentale (résoudre une équation, rédiger une introduction) : un savoir-faire mental
B) Le mythe de Prométhée et Epiméthée
Epiméthée et Prométhée sont des Titans ; ils sont frères.
Platon : Protagoras (Hatier p 166) : récit de la distribution par Epiméthée (par délégation de Zeus) des qualités essentielles à tous les êtres vivants. L’homme, tard venu, est « le moins bien partagé des animaux » : Prométhée veut secourir sa vulnérabilité : rapt du feu ( = l’intelligence = la technique)
Eschyle : Prométhée enchaîné : « Tous les arts aux mortels viennent de Prométhée »
Une définition de la technique comme « art manuel » ; habileté, dextérité à faire quelque chose.
En même temps, Prométhée a été cruellement puni pour ce vol : il n’ y a pas eu « cadeau » des dieux : il y a conquête, illicite, de Prométhée, qui devient, sur le plan du mythe, une sorte de « premier homme »
Aristote : Des parties des animaux ; §10 (Roussel 2001 p 73/ (56) (25): la main, « outil de tous les outils »
Anaxagore (philosophe présocratique) : C’est parce qu’il a des mains que l’homme est le plus intelligent
Aristote : C’est parce qu’il est le plus intelligent des animaux que l’homme a des mains (finalisme : c’est la fin qui explique le phénomène) (N.B : la science actuelle est plutôt du côté d’Anaxagore)
C) Pourquoi les animaux ne travaillent pas
Marx : « l’abeille et l’architecte » (Hatier p 162) (57) :
La supériorité de l’architecte le plus maladroit sur l’abeille la plus experte est que l’idée de ce qui va être réalisé préexiste, dans le cas de l’humain, à sa réalisation (idem pour les castors : construction de barrages ≠ véritable invention technique)
Dominique Lestel ( Hatier p 164) (58): pourquoi les chimpanzés ne travaillent pas
– pas d’outils gardés (pas de projection dans le temps)
– pas d’objets composés de joints et d’articulations (des lithes ex : tabouret/ pas des polylithes ; ex : une échelle articulée, une montre)
– pas de langage, pas de division du travail, pas de coopération technique : activité individuelle mais non pas activité sociale.
D) La pré-histoire et l’invention de l’outil
Homo habilis, homo faber : l’invention technique et (avec les pratiques mortuaires) ce par quoi certains grands primates se sont fait reconnaître comme les premiers humains (restes humains, découverts en Chine, datant d’il y a deux millions d’années). Ce qui sert de donnée de base à la paléontologie, ce sont des reliquats techniques : morceaux d’outils, de poterie. Retracer l’histoire de l’intelligence humaine = retracer l’histoire de l’évolution technique (préhistoire scandée par l’acquisition des techniques : âge de la pierre taillée ; âge de la pierre polie ; âge des métaux)
L’ homme = celui qui se caractérise par la possession d’instruments, l’utilisation d’outils
La technique rentre dans la définition de l’homme : elle est une dimension humaine essentielle.
La technique fait partie de la nature humaine.
(L’histoire des techniques serait peut-être une approche de l’histoire humaine plus pertinente que l’histoire des batailles : l’invention de l’aiguille à chas, il y a une vingtaine de milliers d’années : une des plus importantes de l’histoire de l’humanité)
D’après Darwin, tous les êtres vivants ne continuent à exister que par l’effort d’adaptation au milieu qui est le leur ; c’est sans doute ce qui s’est passé pour l’homme :
La technique = l’épanouissement, chez un être intelligent, de l’effort d’adaptation au milieu qui est celui de tous les êtres vivants (les tiges des roses se couvrent d’épines pour que les rosiers ne soient pas mangés par les chèvres // l’homme se dote de la technique pour survivre)
Face à la nécessité de s’adapter au froid, trois options :
- la pousse des poils
- l’hibernation
- l’invention du vêtement / du chauffage
L’homme, à partir d’un certain stade de son développement, a mis le changement « hors cortex » : ce n’est plus son corps (ou même son cerveau) qui porte l’effort d’adaptation : elle passe par l’invention de prothèses (outil vu comme la prolongation de l’organe)
A.Espinas : « l’outil est la continuation, la projection au-dehors, de l’organe »
D’ailleurs, dans le mythe de Prométhée (selon Eschyle), les humains sont appelés « les éphémères » et encore « la race mortelle » ; ce n’est qu’une fois en possession du feu qu’ils seront appelés humains.
Même chose chez Sophocle (Antigone), avec une forte connotation enthousiaste (et même lyrique) : l’homme est appelé « la merveille d’entre toutes les merveilles » ; le « génie que rien – excepté Hadès- ne peut prendre au dépourvu » en tant qu’il est un « inventeur de stratagèmes »
Quels sont les premiers « stratagèmes » inventés par l’homme ? Des armes (techniques de chasse, techniques de pêche) et des outils agricoles
Ainsi, nous ne vivons pas dans le même monde que les animaux, nous vivons dans un monde auquel nous avons donné un sens et une forme humaine.
La technique et le travail = des éléments de la constitution du monde en tant que monde humain (en parallèle avec le langage)
Leroi-Gourhan : chronologiquement, concordance de trois grands facteurs d’évolution :
- la station debout : homo erectus
- le langage articulé
- le développement de la main comme outil
La technique est invention et utilisation d’instruments, d’outils. Toutefois, tout objet artificiel n’est pas un instrument.
Aristote Les politiques, livre 1 chapitre 4 (Hatier p 170) (60): quelle est la différence entre une navette et un habit ou un lit ? La différence entre objet (artificiel) et instrument
« De la navette, on tire autre chose que son propre usage, alors que de l’habit et du lit, on ne tire que leur propre usage »
Un instrument = un objet dont on tire plus que son propre usage
Un objet technique (= un instrument) sert soit à produire d’autres objets techniques soit à produire des objets d’usage.
On est toujours dans le concept de médiation : l’outil, c’est ce qui existe pour un usage auquel il est rapporté : celui qui sert à autre chose.
C’est aussi une façon de dire que la technique et le travail sont très étroitement liés : l’objet technique est celui qui sert à travailler.
II. La technique et la science
Comment définit-on habituellement la technique par rapport à la science ?
La technique = l’application de la science ; la mise en œuvre d’un savoir scientifique
= un savoir appliqué
1) La technique = un savoir appliqué ?
Ce qui est ainsi révélé, c’est que la science se pense comme désintéressée.
Le savant ne sait pas – et n’a pas à savoir – à quoi va servir sa découverte.
Ainsi le rayon laser a-t-il commencé dans la chirurgie (opération de la rétine) pour finir dans l’industrie du C.D, et, plus trivialement encore, l’agroalimentaire (découpe de l’ouverture des cannettes de soda)
Cependant, à l’heure des « techno-sciences » (expression de Habermas), la distinction entre science et technique apparait comme totalement périmée : il y a une imbrication totale de la science et de la technique : aucune science ne peut exister sans quantité d’objets techniques très perfectionnés qui la rendent possible.
De plus, séparer la science et la technique revient fatalement à dissocier la pensée (théorie) et la pratique (technique) ; et dont à hiérarchiser les deux, au détriment de la technique ;
Il serait plus intéressant (plus juste) de considérer la technique comme une pensée, comme un mode de pensée. Mais une pensée différente, très pragmatique, empirique, qui procède « par essais et erreurs » et se contente souvent de tirer les conclusions des résultats obtenus sur le terrain, sans accéder à l’intelligibilité (au pourquoi) des phénomènes.
Alain « De la technique » in Les sciences et les âges ( Roussel 2001 p 75) (61): qui dit technique dit outils, instruments, machines c’est-à-dire « méthodes solidifiées »
Proposons tout de même le schéma suivant : il y a, dans la technique, deux composantes et une résultante :
- un VOULOIR (désirs, aspirations) : ex : l’irrationnel désir de voler
- un SAVOIR (la science : les lois des phénomènes) les lois de la pesanteur, de la résistance des matériaux, de l’aérologie
- un POUVOIR (l’objet technique) : le deltaplane
Autre façon de le dire : une volonté (dominer la nature ; avoir une vie plus confortable, quelquefois tout simplement survivre), s’incarne dans un pouvoir (technique : ex : chirurgie) par l’intermédiaire d’un savoir (scientifique : médecine).
La technique part d’une relation établie par la science : le rapport entre la CAUSE et l’EFFET (rapport théorique) en un rapport (pratique) de MOYEN à FIN
C’est en cela qu’elle est « savoir appliqué » : la technique nous donne la possibilité de transformer le réel en fonction de nos aspirations, nos désirs.
Il s’agit de soumettre la nature aux exigences du vouloir humain. Mais ce vouloir doit passer par l’intermédiaire d’un savoir pour devenir pouvoir réel d’action.
Bacon (XVIIème): « On ne peut vaincre la nature qu’en lui obéissant »
Moyennent quoi, le Rhin est vu uniquement tel qu’il est utilisé : une gigantesque machine à produire de l’électricité. La technique permet à l’homme l’utilisation à son profit des forces de la Nature. Ainsi, un moulin à vent est un instrument permettant la transformation de l’énergie éolienne en un mouvement de rotation (qui sert à moudre du blé).
Vision technicienne de la nature
Descartes Discours de la méthode ; VIème partie (Hatier p 322/ Russ : 24 p 192 / Roussel p 86) : « comme maîtres et possesseurs de la nature »
Pour Descartes, la nature est certes créée par Dieu, mais elle n’est que matière (= connaissable par les lois de la physique). L’homme ne doit plus se contenter de la connaître : il a le droit de l’employer à des fins utiles pour lui.
La notion de « maître » revoie à celle de maîtrise (ex : utiliser l’énergie potentielle d’un fleuve pour produire de l’électricité) ; domestiquer toutes les espèces animales possibles.
Toutefois, nuance apportée par le « comme » :
– le vrai maître, c’est Dieu
– certaines forces naturelles nous échappent encore (ex : cataclysmes)
– nous nous considérons comme les légitimes propriétaires de la nature : c’est oublier que la notion juridique de propriété suppose un accord entre deux ou plusieurs parties. Or, l’homme « civilisé » s’est plutôt approprié la nature (notion complètement étrangère aux peuples primitifs).
« La science a fait de nous des dieux avant même que nous méritions d’être des hommes » Jean Rostand
2) Science et technique : quelle antériorité ?
Quand on parle de savoir appliqué, on présuppose que la science précède la technique (que d’abord on connaît le rapport théorique entre cause et effet pour pouvoir l’appliquer dans une relation de moyen à fin).
Problème : dans l’histoire de l’humanité, les techniques ont précédé (de beaucoup !) les savoirs scientifiques. Voilà l’enfance de la technique : un ensemble de routines qui réussissent mais dont la rationalité est inconnue.
Grossièrement, on peut considérer que les sciences ont trois siècles alors que les techniques en ont plusieurs dizaines.
On a su faire du feu des dizaines de siècles avant de comprendre les lois de la combustion
Idem pour la médecine : il existe une « médecine des simples » qui est un savoir-faire de guérison (ex : les plantes à saveur amère guérissent les maux d’estomac) quand on ignore tout des principes rationnels de ces guérisons
Autre illustration médicale : en tant que réussite technique aveugle, on soignait les goitres par des éponges calcinées et des cendres de varech (thérapie prescrite depuis le XIIème siècle)
Il a fallu attendre 1800 pour qu’un salpêtrier parle à deux chimistes de son « problème technique » : la corrosion de ses instruments de travail par un produit résiduel (issu de l’extraction de la soude à partir des cendres de varech). Et c’est ainsi que les deux chimistes identifièrent une substance nouvelle : l’iode
Du savoir-faire empirique au savoir théorique, il y a loin : l’utilisation (du levier) ne présuppose pas la modélisation (calcul des forces en présence)
Idem : vers 1700, invention de la machine à vapeur par des techniciens (Denis Papin, un français, invente une sorte d’autocuiseur ; 10 ans plus tard, Thomas Newcomen, un anglais, se sert des travaux de Papin pour mettre au point un moteur à vapeur qui sera utilisé dans les mines ; vers 1770, Watt améliore le moteur de Newcomen par des pistons).
En 1824 (plus de 100 ans plus tard !) : les hommes de science « inventent » la thermodynamique.
La technique procède par tâtonnements successifs (méthode « par essais et erreurs ») et découvre ainsi des procédés dont on ignore encore la rationalité (efficacité sans rationalité)
Va-et-vient constant entre la science et la technique : c’est quand la technique bute sur un obstacle qu’il y a un effort de prise de recul (une théorisation), avec, parfois, une découverte scientifique et un « effet retour » sur la technique.
Ceci veut dire que les sciences n’ont jamais été aussi désintéressées qu’on les présente : à l’origine de toutes les sciences, on trouve des préoccupations pratiques.
C’est peu à peu que le savoir s’est détaché de l’action et qu’existent des « recherches fondamentales ».
Un exemple : au XVIIème siècle, les fontainiers de Florence rencontraient un problème technique : leurs pompes aspirantes n’arrivaient pas à élever l’eau jusque dans les palais (en général sur les collines) : ils font appel à Galilée. Galilée formule le problème de manière théorique et le résout : c’est ainsi que Galilée, Torricelli et Pascal ont découvert la pression atmosphérique
L’avantage de la science sur la technique, c’est que la science permet de garder le résultat sous une forme fixe et neutre (une loi ; la propriété d’une substance) : le savoir est ainsi disponible pour être réinvesti dans d’autres objets, d’autres domaines.
Canguilhem : « Ce qui manque à la technique, ce n’est pas de savoir découvrir la solution de ses problèmes ; c’est de savoir généraliser ces solutions »
Sans la science, la technique est stationnaire.
Avec la science, gagnant en abstraction, elle gagne aussi en extension. Une fois que la rationalité scientifique a été dégagée du savoir-faire technique, l’application délibérée d’un savoir acquis est possible.
Mais on peut dire aussi que la science est peu de choses sans la technique : en 1912, l’action thérapeutique de la pénicilline avait été découverte par un médecin français. Mais on ne savait ni la produire ni la conserver (défaut de moyens techniques) ; d’ où son abandon. (cf Ellul in Roussel p 74)
III. La technique et le travail
- A) De l’outil à la machine
Depuis le début, les instruments de la technique étaient des outils de travail (agricole, invention du joug par exemple)
Néanmoins, il faut dire l’importance du passage d’une société qui produit quelques objets techniques simples (des outils) à une société technicienne où prolifèrent les machines.
On passe ainsi d’un milieu naturel (où, certes, sont utilisés des outils) à un milieu technique.
Quand on est dans une société dominée par l’outil, on a en tête le modèle de l’indigène, qui fabrique lui-même son outil (son arme), à la mesure de son corps et en fonction de ses savoir-faire corporels (fronde ou filet ou arc).
Alors, le concepteur = le réalisateur = l’utilisateur
L’objet technique est parfaitement adapté au corps de l’homme, parfaitement maîtrisé (plénitude de la maîtrise et de la satisfaction)
On retrouve encore un peu cela aujourd’hui dans les techniques considérées comme féminines : tricoter un pull, faire un gâteau.
En cela, on est dans le loisir plus que dans le travail.
Il en va tout autrement quand l’objet technique de référence est la machine ;
Quelle différence fondamentale entre outil et machine ?
Hannah Arendt La Condition de l’homme moderne (texte 8 p 371 : Kh L, Hatier ) : (62)
Les outils sont des artifices directement reliés à un pouvoir humain et sous maîtrise directe de l’homme (ex : marteau)
Les machines sont des artifices qui représentent un pouvoir non-humain mais sous maîtrise directe de l’homme (ex : marteau-piqueur)
Les automates sont des artifices qui représentent un pouvoir non-humain et sans maîtrise directe de l’homme (ex : composteur RATP)
3 étapes :
1/ La machine-outil reste chétive tant que l’homme est son moteur.
2/ On en vient à employer les forces motrices traditionnelles (animal, vent, eau) : forces naturelles
3/ Le saut s’opère quand on parvient à utiliser la vapeur : on fait alors fabriquer des machines par les machines.
Plus on s’éloigne du modèle de l’outil, plus c’est l’homme qui doit s’adapter à l’objet technique : son corps n’étant plus le moteur de la technique, c’est lui qui doit s’adapter à son rythme.
Officiellement, la machine est, bien sûr, toujours au service de l’homme
≠ ponctuellement, son intervention apparaît de plus en plus comme subie (pensez à la séance de gavage de Charlie Chaplin au sein de son usine dans « Les Temps modernes »)
Voyez aussi, à l’occasion, le film de Fritz Lang (en 1927) : Metropolis .
Marx explique que, dans la manufacture et le métier, l’ouvrier se sert de son outil (c’est l’ouvrier qui imprime son mouvement à l’outil) / dans la fabrique, c’est l’ouvrier qui sert la machine (l’homme ne fait que suivre le rythme d’un mécanisme autonome)
Les détracteurs de la technique diront que l’outil humanise la nature mais que la machine fait courir le risque de déshumaniser l’homme.
Heidegger (XXème): in Essais et conférences, article « La question de la technique » : de la différence entre un pont de bois et une centrale hydraulique sur le Rhin : idée que ce n’est pas le même rapport avec le monde et la nature qui est en jeu : le pont de bois est un objet certes artificiel mais qui s’inscrit dans la nature, qui n’empêche pas un accès direct de l’homme à la nature (l’homme traverse le pont et embrasse le paysage) : les formes anciennes de la technique n’empêchent pas d’habiter la terre en poète / la technologie moderne (le machinisme) est une provocation de la nature, sommée de livrer toutes ses ressources. Le Rhin est emmuré dans la centrale, utilisé pour livrer une certaine quantité d’énergie : le fleuve lui-même devient un objet technique et meurt en tant que chose naturelle. Heidegger pense donc que l’essence de la technique est un arraisonnement du monde : une « mise à la raison », autoritaire (tout est réduit au rationnel, à l’efficace). La technique est l’exploitation de nos connaissances scientifiques pour mettre le réel à notre disposition. L’être humain est censé être le bénéficiaire de ce processus (il est du côté des fins : il décide de la fin de la technique). Illusion…car l’homme lui-même n’est plus qu’un maillon de la chaîne : appartenant pleinement à la nature, il ne peut pas faire comme s’il était extérieur au fond qu’il arraisonne. Au bout du développement de la technique, il y a l’exploitation de l’homme.
Autre changement radical: la question de la compétence de l’utilisateur : les techniques des temps passés faisaient une large part à un savoir-faire de l’utilisateur (je pense au « tour de main » du potier/ je pense à l’écriture comme à une technique : les pleins et les déliés, la calligraphie…)
Dans le monde technicien qui est celui des Occidentaux aujourd’hui, l’utilisateur peut ne rien comprendre à la technique qu’il utilise : son rôle se réduisant quelquefois à appuyer sur un bouton. Nous vivons dans un monde où le capital technique accumulé est colossal. Et, en même temps, nous sommes beaucoup plus que nos ancêtres dispensés de tout savoir-faire technique.
Il y a eu extériorisation des savoir-faire : la machine-outil incorpore dans une matière extérieure les savoir-faire originellement manuels (ou intellectuels : ex : calculatrice en lieu et place du calcul mental)
Ainsi, la délégation à la machine d’un savoir-faire constitue une perte.
Un sentiment de dépossession, de vulnérabilité par rapport à la technique peut naître de cela (c’est cette peur qu’illustrent beaucoup des poncifs de la science-fiction : un grand nombre de dystopies sont de véritables charges contre la technique).
Cette utilisation « pauvre » de la technique, cette absence possible de compétences, ont profondément modifié la réalité du travail humain
B) La taylorisation du travail
Perrault, un contemporain de Diderot, affirme : « Quand on voit tricoter des bas, on admire la souplesse et la dextérité des mains de l’ouvrier, quoiqu’il ne fasse qu’une seule maille à la fois ; qu’est-ce donc quand on voit une machine qui forme des centaines de mailles à la fois, c’est-à-dire qui fait en un moment les divers mouvements que les mains ne font qu’en plusieurs heures ». « Elle forme des centaines de mailles à la fois sans que l’ouvrier qui remue la machine y comprenne rien, en sache rien, et même y songe seulement ».
L’exécution des tâches est confiée au mécanisme ;
Auto-matique : opérations jadis manuelles (délibérées, volontaires) désormais exécutées mécaniquement.
La machine est alors le substitut non de l’individu mais de l’équipe : un super-individu.
Efficacité sans faille d’une opération entièrement adéquate à sa finalité.
Au tout début du XXème siècle, Taylor invente de nouvelles modalités de travail dans l’industrie américaine : chaque poste de travail correspond à un geste précis. Le travail à la chaîne émerge. Répétitif, peu qualifié, il correspond au principe même du travail : la division des tâches, mais poussé ici à son extrême.
Taylor (aux ouvriers) : « On ne vous demande pas de penser »
Chaque ouvrier n’est plus tenu que pour une infime partie du « travailleur collectif ». Le travailleur éprouve un sentiment de dépossession car il ne maîtrise plus la signification de son travail (il a du mal à se situer dans l’ensemble du processus de production).
Trois caractéristiques : La spécialisation (conception/réalisation)
La hiérarchie (ouvriers qualifiés/O.S)
La parcellisation des tâches (au sein de la réalisation : un seul geste)
Georges Friedmann, sociologue français, écrit en 1956 Le travail en miettes. Dans une France en pleine reconstruction, il jette un regard critique sur le travail à la chaîne. Les conséquences de l’O.S.T sont : des tâches parcellaires (perte du sens) + des cadences soutenues (fatigue)+ perte de savoir-faire (absentéisme, important turn-over). Il y a un sentiment de mutilation que peut ressentir le travailleur, interchangeable, qui se voit réduit lui-même à un statut d’instrument et dont une infime partie des capacités (physiques, intellectuelles) sont utilisées. La parcellisation des tâches entraîne une disparition d’une partie des capacités humaines.
Marx Le Capital : « Un certain rabougrissement de corps et d’esprit est inséparable de la division du travail dans la société »
C) Travail et division du travail
La valeur commune au travail comme à la technique, c’est l’efficacité, la productivité (une vision technique du monde est celle qui réduit tout à son utilité : qui regarde la vache comme une vivante machine à produire du lait, le cochon comme un certain nombre de kilos de côtelettes « sur pattes »).
Or, cette efficacité suppose une spécialisation.
Adam Smith et l’exemple de la manufacture d’épingles (63): là où un ouvrier acharné mettrait un an à produire de A à Z une épingle, une manufacture mécanisée d’épingles (où travaillent plusieurs dizaines d’ouvriers spécialisés) produit plusieurs milliers d’épingles par jour.
D’ où un gain de temps : de productivité
A.Smith : « l’opulence naît de la division du travail »
Le principe même du travail, c’est la division du travail. On peut penser que la toute première partition connue dans les sociétés humaines fut celle du travail masculin et du travail féminin.
Deuxième grand principe de division : travail manuel / travail intellectuel
Il y a ici négation de la polyvalence initiale des êtres humains : trop longtemps ignorée, cette polyvalence en vient à disparaître.
Dans l’Idéologie allemande, Marx promet ceci : « Dans la société communiste, personne n’est enfermé dans un cercle exclusif d’activités, et chacun peut se former dans n’importe quelle branche de son choix (…) faire aujourd’hui telle chose et demain telle autre, chasser le matin, pêcher l’après-midi, s’occuper d’élevage le soir et s’adonner à la critique après le repas sans jamais devenir chasseur, pêcheur, berger ou critique ».Parlons d’un autre aspect des choses : cette fois, il s’agit d’un aspect positif du travail : De façon générale, le travail permet aux hommes de faire société : plutôt que les rivaux vivant en autarcie qu’ils ont pu être à l’origine, le travail tempère leur « hostilité primaire » (Freud) en les rendant solidaires : solidaires parce que dépendants les uns des autres.
Le travail nous inscrit dans un vaste réseau d’échanges et fait gagner beaucoup de temps à l’individu (qui n’est pas obligé d’avoir les compétences de maçon, de menuisier, de pédagogue, d’éleveur, de médecin, d’informaticien etc).
Travailler, c’est trouver sa place à l’intérieur d’un vaste organisme social où la production de chacun suppose la production de tous (car une industrie isolée est une chose impossible)
IV. Travail et technique : humanisants ou déshumanisants ?
La fonction spéculaire du travail
Poussé par le monde matériel, pour échapper à ce monde matériel, l’homme le transforme. Ce faisant : il se transforme.
Le travailleur se réalise dans son travail : l’objet façonné, ouvragé, fabriqué = le miroir de l’homme
L’homme injecte un sens dans une matière amorphe : il lui donne une forme qui vient de sa conscience (une forme utile à sa vie)
Mais, en même temps que l’homme agit sur la nature extérieure et la modifie, il modifie sa propre nature : il développe les facultés qui sommeillaient en lui
Mounier : « Tout travail travaille à faire un homme en même temps qu’une chose »
N.B : l’homme n’a pas de nature donnée une fois pour toutes : il se fait en transformant la nature. Les rapports de l’homme au monde ne sont pas d’abord des rapports de connaissance mais des rapports d’interaction (rapports réciproques).
Pouvoir formateur du travail, qui révèle l’homme à lui-même.
Hegel : « Ce qu’il trouve ainsi dans son œuvre, c’est lui-même »
Dans le meilleur des cas, l’homme peut même dépasser ces nécessités matérielles en réalisant une œuvre personnelle, dans laquelle il se donne une forme objective : contemplant le produit de son travail, il se contemple lui-même.
Il y a, dans le travail, à la fois un enjeu de maîtrise de soi (la discipline et le « désir réfréné » que représente la période de travail) et un enjeu de prise de conscience de soi.
« Le travail, au contraire, est désir réfréné, disparition retardée: le travail forme. Le rapport négatif à l’objet devient forme de cet objet même, il devient quelque chose de permanent, puisque justement, à l’égard du travailleur l’objet a une indépendance » Hegel.
Cf Marx Manuscrits de 1844 : « L’homme se dresse librement face à son produit » : « il se contemple lui-même dans un monde de sa création » (photocopie : texte N°1) : (66)
Reconnaître une fonction spéculaire au travail, c’est constater que le travail humain humanise la nature mais aussi transforme l’homme (le forme, le déforme) : le travail est ce par quoi l’homme se fait en faisant une chose.
Marx reconnaît une valeur essentielle au travail : par lui, la nature humaine se réalise dans l’appropriation du monde
Pouvoir qu’a l’homme d’humaniser l’univers et de se réaliser pleinement lui-même.
Exploitation et aliénation du travailleur
1) Proudhon et la dénonciation du capital
Proudhon est un contemporain de Marx (XIXème), un français, que Marx classe parmi les « socialistes utopiques ». C’est un anarchiste.
Il observe que, quand les hommes se mettent ensemble, il résulte de l’union de leurs forces un « surcroît de puissance effective ».
C’est ainsi que 200 militaires ont soulevé, en une heure, un obélisque de sa base alors qu’un seul homme, non pas seulement en 200 heures, mais même en 200 jours, n’y serait jamais arrivé.
Donc, quand le capitaliste paye autant de fois une journée de travail qu’il a employé d’ouvriers par jour, il permet à la force de travail de se reconstituer (les ouvriers vont pouvoir manger et dormir) mais il n’a pas encore rémunéré cette force collective immense qui a résulté de l’harmonie des forces des travailleurs.
C’est cette part non rémunérée qui donne naissance au profit, et aussi au capital (achat des instruments de la production)
On comprend donc la phrase la plus célèbre de Proudhon : « La propriété, c’est le vol »
(= le capitalisme est illégitime)
« Tout capital accumulé étant une propriété sociale, nul ne peut en avoir la propriété exclusive »
2) Marx : valeur marchande contre valeur d’usage (le pouvoir pervers de l’argent)
Un travail utile est un travail qui se réalise en valeur d’usage c’est-à-dire : le produit en tant qu’il sera consommé.
L’autre type de valeur, c’est la valeur marchande : quelle somme d’argent je vais obtenir si je vends un objet (que j’ai fabriqué).
La situation « normale « (= saine) est la situation où la valeur d’usage prime sur la valeur marchande : si les objets sont produits, c’est bien qu’ils répondent à des besoins !
L’argent n’est qu’un moyen, un intermédiaire entre deux marchandises recherchées pour leur usage : on pense à un système de troc, médiatisé par l’argent (Monsieur K voudrait qu’on lui mitonne des petits plats le lundi soir/ je donne des cours de philo aux enfants de Mme S/ Mme S mitonne des petits plats pour monsieur K / Monsieur K refait ma charpente). Pour Aristote, l’argent est un « équivalent universel ».
Mais la perversion qui survient à cause du capitalisme, c’est que la valeur marchande prend le pas sur la valeur d’usage : désormais, l’argent n’est plus un moyen mais une fin : il n’est plus un intermédiaire entre deux marchandises, c’est la marchandise qui est l’intermédiaire entre deux sommes d’argent !
L’argent est la seule fin. La marchandise n’est plus pensée que comme nécessaire à faire augmenter la somme d’argent de départ.
L’argent lui-même crée les besoins en marchandise (fonction de la publicité).
Ex : immobilisation d’un paquebot en fonction du cours du riz (marchandise revendue des dizaines de fois avant d’être distribuée) ; achat d’un « immeuble de rapport ».
D’où la répartition que fait Marx de l’humanité en deux groupes :
*les ouvriers, qui sans cesse vendent leur activité vitale pour assurer leur subsistance
*les possesseurs du capital qui achètent continuellement pour réaliser du profit
(Le capitaliste = l’acheteur de la force de travail + celui qui possède les outils de production)
Ainsi, la force de travail devient une marchandise, ni plus ni moins que le sucre (l’un se mesure avec une balance ; l’autre avec une montre)
3) De l’exploitation (Ricardo : loi d’airain) à l’aliénation
- l’exploitation
L’idée, c’est que les travailleurs sont lésés, qu’ils sont perdants
L’idée d’exploitation a été théorisée par Ricardo (économiste du XIXème) dans ce qu’il appelle la loi d’airain :
« Le prix normal du travail est celui qui est nécessaire pour permettre aux travailleurs de subsister et de perpétuer leur race sans que leur nombre augmente ou diminue »
(Si l’attrait du gain les motivait, leur nombre augmenterait / s’ils étaient si pauvres qu’ils soient décimés par les maladies, leur nombre diminuerait)
Selon Marx, le maximum de profit connait deux limites : le minimum physiologique du travail (les moyens de la subsistance du travailleur) et le maximum physiologique de la journée de travail.
Même à supposer qu’il n’y ait aucun frein d’ordre « humanitaire » (compassion, sentiment d’équité…) qui vienne tempérer l’exploitation, il y aurait encore (seulement !) ces deux limites objectives.
Je rappelle la réalité historique que connait Marx ( mi-XIXème) : des journées de travail de 12 à 13 heures, avec 20 min pour manger, 6 jours par semaine, avec pratiquement pas de vacances ; la fréquente mise au travail d’enfants de moins de 13 ans : l’exploitation y relève presque de l’esclavage.
Pénibilité extrême ; travail servile.
L’exploitation est basée sur l’idée d’un excès imposé de travail : un sur-travail : quand l’achat par le patron d’une demi-journée de travail suffirait, il achète la journée de travail
- l’aliénation
L’idée est, cette fois, que l’action du travail sur le travailleur altère le travailleur, le rend autre, le dégrade.
Aliénation [alien= autre ] : le fait, pour l’homme, de se perdre dans une réalité étrangère ; d’être alors dessaisi de sa propre essence.
Marx : Textes des Manuscrits de 1844 : texte 2 : (68) (15)
Dans le travail, je ne suis pas moi-même (je ne maîtrise pas les cadences ; je ne fais pas preuve d’initiatives ; je subis des contraintes horaires très fortes) / je ne suis pas non plus moi-même après le travail (alcoolisme ouvrier au XIXème siècle : compensation quasi obligatoire)
A l’abrutissement dans le travail correspond un abrutissement après le travail (ex : abrutissement télévisuel)
Manuscrits de 1844 : texte 3 : (69)(16)
L’homme se réalise dans l’objet qu’il fabrique (en vendant ma force de travail, je vends mon corps, mon énergie, mon temps, dans les cas les meilleurs mon imagination…c’est-à-dire ma vie). En passant sa vie à autre chose que lui-même, l’homme s’aliène = se rend autre : sa vie, c’est l’objet qu’il a fait OR cet objet lui échappe (il n’a aucun contrôle sur ce qu’il devient, comment il est vendu) :
La perte par l’homme de son objet → la perte de l’homme en son objet
(dépossession) (aliénation)
Il y a un transfert de valeur qui se fait au détriment des hommes :
Monde des hommes Monde des objets
( dépossession, transfert de valeur)
Ainsi, le monde des hommes connait une évolution vers l’impuissance et la pauvreté alors que le monde des objets croît en richesse et en puissance.
Texte d’Hannah Arendt La condition de l’homme moderne (1958): Hatier 12 p 172 (70) : Justifiez cette affirmation centrale du texte : l’époque moderne a transformé la société toute entière en une « société de travailleurs sans travail »
Le travail, c’est l’asservissement à la nécessité. Pendant des siècles, c’était le fait des privilégiés que d’être libéré du travail. Aujourd’hui, la technique nous donne les moyens de nous délivrer, au moins partiellement du travail (la mécanisation prend en charge ce qu’il y a de moins humain dans le travail…mais en même temps, l’époque moderne glorifie le travail : « c’est une société de travailleurs qu’on va délivrer des chaînes du travail ». Terrifiante perspective d’une « société de travailleurs sans travail »
L’art

A l’origine, le mot art désigne un domaine : celui des productions de l’homme par opposition aux productions de la nature :
Choses naturelles / Choses artificielles (de l’écrou à La Joconde)
L’artiste = un producteur d’artifices
Au sens large du mot, la notion d’art regroupe trois types de productions :
- Les techniques
- L’artisanat
- Les beaux-arts
Au sens étroit, l’art désigne l’ensemble des « beaux-arts » : la peinture, la sculpture, l’architecture, la musique, la danse, la littérature, le cinéma (« 7ème art… »)
Progressivement, on entend de plus en plus le mot art comme un synonyme de « bel-art »
C’est aussi à ce sens qu’on fait référence dans ce cours de philosophie.
La partie de la philosophie qui s’intéresse à l’art s’appelle l’esthétique ; mot dérivé du mot grec « aisthèsis » (αἴσθησις) qui signifie sensation : c’est donc la sensation éprouvée par celui qui jouit de l’art (l’amateur d’art) qui est le critère majeur de l’art.
Qu’est-ce qui distingue l’art de l’artisanat ? de la technique ?
(Cherchez les caractéristiques de l’art)
- Dans l’art, la production est avant tout une création: investissement d’une forte part de subjectivité de la part de l’artiste
- Travail de l’imagination (de l’artiste + de l’amateur)
- Rapport au Beau (avec un double bémol : 1) certaines productions de l’artisanat méritent leur admission au titre d’œuvre d’art ; 2) certaines œuvres ne visent pas le Beau)
Trois modes de production d’objets artificiels :
1) La technique → objets standardisés
2) L’artisanat → chaque objet produit diffère des autres par quelques détails
3) L’art → chaque œuvre est unique (même s’il y a souvent des ressemblances entre les œuvres d’un même artiste)
Ainsi, de la technique à l’art en passant par l’artisanat, on a un rapport de plus en plus distendu aux règles de production
Est-ce à dire qu’il n’y a pas de règles dans l’art ? Bien sûr que si : l’art utilise des techniques (s’il était pure spontanéité, il ne ferait pas l’objet d’un apprentissage OR cours de dessin ; Ecole des Beaux-arts, Conservatoire de musique ; existence de « techniques picturales » ex : la perspective)
Ces règles et ces techniques évoluent selon les époques : la production artistique est soumise à l’histoire.
Mais, pour exister, ces règles sont loin de suffire à définir l’art : ce sont des conditions nécessaires mais non suffisantes : indispensables à l’art, elles ne rentrent pas malgré cela dans sa définition : l’art n’est pas dans les techniques qu’il utilise : tous les arts obéissent à des règles / l’artiste de génie, c’est celui qui va s’écarter des règles, les transgresser, inventer une nouvelle façon de faire, de nouvelles formes (ex : impressionisme ; fauvisme).
C’est même cette liberté qu’il prend par rapport aux conventions de son art qui est tenu pour la preuve de son génie (cf : le sonnet dont le nombre de quatrains est insuffisant ; le poème où la rime est rompue)
La frontière est floue entre ce qui est de l’art et ce qui n’en est pas :
Acceptez-vous pour des arts la photographie ? La B.D ? La cuisine ?
Considérez-vous la Tour Eiffel comme une œuvre d’art ?
Et même, à l’intérieur d’un art reconnu, la question se repose sans cesse : ex : ce n’est pas parce que la littérature est un art que tous les livres sont des œuvres d’art : quels critères ?
Une œuvre « de circonstance » écrite par un homme politique n’en est pas ; un livre de cuisine non plus…
(ex : Frédéric Dard : « San Antonio » = production de 5 livres par an ; à sa mort, son fils, Patrice Dard, reprend « l’entreprise paternelle »)
De même, quel film est une œuvre ? Quel film ne l’est pas ? (est-ce seulement un critère quantitatif : le nombre d’entrées que fait le film ?)
Cinéma commercial (le cinéma comme industrie)/ Cinéma d’Art et d’essai : pas de « recette » ; plus d’originalité
Faites-vous la différence entre la musique qui fait « vibrer les tripes » et celle qui incite à tout un voyage mental ?
En art, pas de rapport à l’utilité (cf : livre de cuisine)
- Tout n’est pas dans les règles de production (l’art ne se réduit pas à un savoir-faire)
- Unicité de l’œuvre (NB : c’est assez récemment –fin XIX- que c’est vraiment devenu une valeur : tant que l’œuvre était VRAIMENT unique… elle était inconnue, sauf de son propriétaire/ à partir du moment où elle est photographiée, l’original est encensé)
- Un créateur individualisé avec lequel l’œuvre entretient un rapport intime : sans les frères Lumière, nous aurions sans doute eu quand même le cinéma ; mais sans Godard, jamais A bout de souffle , sans Takeshi Kitano, jamais Hana-Bi (film japonais de 1997), sans Imamura, jamais La ballade de Narayama (1983, japonais).
- Rapport avec le temps : l’œuvre d’art a une durée de vie très longue (souvent bien supérieure à celle de son créateur)

- Qu’est-ce qu’ être vrai pour l’Art ?
C’est regrettable, mais il faut commencer par le constat d’un malentendu, d’une incompréhension entre la philosophie et l’art.
La philosophie à ses débuts (Platon), ne connait qu’une seule valeur : le vrai (elle inscrit tout dans un système binaire : vrai/ faux)
A propos de l’art, Platon se pose donc la question de sa vérité, ce qui est une « mauvaise question » : question intellectuelle et non pas question esthétique.
Cela débouche sur un véritable acte d’accusation de l’art.
- A) PLATON : l’Art comme travestissement du vrai
République. Livre X : L’artiste est accusé d’œuvrer à l’écart de l’Idée. Il n’a pas directement affaire à l’eidos ; il en copie la copie. Et cette structure mimétique de l’art (l’art toujours pensé comme mimésis) dit son éloignement par rapport à la vérité. Les arts sont des procédures imitatives.
Double corrélat: 1) ils sont à distance du vrai (rapport étroit avec l’illusio)
2) dangerosité politique. L’art est alors pensé en fonction de l’enfance et de l’éducation; la crainte étant que la poésie n’imprègne profondément l’expérience d’un certain goût du faux.
La conséquence de cette dangerosité sera la relégation des artistes aux portes de la cité. (Dans les Lois, on assiste à la tentative de régenter leurs productions).
Dans les Lois (817 a-c) c’est le législateur qui œuvre dans le vrai ? Cf. l’Athénien, en réponse aux artistes qui demandent accès à la cité: « notre organisation politique toute entière consiste en une imitation de la vie la plus belle et la plus excellente, et c’est justement là ce que nous affirmons, nous, être une tragédie, la tragédie la plus belle et la plus authentique ! Dans ces conditions, si vous êtes poètes, nous aussi »
Etrange rivalité mimétique entre l’homme politique et l’artiste: tous deux sont poètes, tous deux composent des tragédies, tous deux proposent des imitations. Mais les uns opèrent dans le domaine de la fable au lieu que les autres instituent des lois.
L’imitation de l’eidos ne peut être que perverse et dégradée. Aucune théorie de l’œuvre, aucun examen du goût chez Platon. Normal, vu que l’image existe sur un plan ontologiquement inférieur.
République. Livres II et III:
Théorie des Idées (non pas majuscule comme signe de tendance paranoïaque mais pour indiquer qu’il s’agit de réalités transcendantes, qui nous dépassent : nous avons des idées mais nous contemplons les Idées)
Application à l’art : le lit reproduit par le peintre (on pense à la chambre à coucher de Van Gogh) est déjà la copie du lit fabriqué par l’artisan, qui lui-même, est la copie de l’Idée de lit.
| Monde intelligible | Monde sensible | Monde de la représentation |
| Idée du lit
Le cercle (immuable) |
Lit concret
Le rond (dans l’eau, de fumée : périssable) |
Lit peint |
On a ici un ordre de vérité décroissante
Les arts sont des procédures imitatives
Chez Platon, les productions de l’art sont installées dans le presque non-être des entités dérivées. Et toujours pensées en fonction de l’eidos. Il est fondamentalement travestissement de vrai.
Au mieux, l’artiste est un ignorant ; au pire (mais le pire est probable), un menteur, un illusionniste.
L’art est falsificateur
Gorgias : division fondamentale des « pratiques du charme » (sophistique, cosmétique, peinture…) et de la philosophie
Platon veut seulement interroger les configurations artistiques en fonction de leur teneur en vérité. C’est ce qui fait que le platonisme est radicalement étranger à l’esthétique L’opération platonicienne consiste à rapporter la forme artistique aux Formes et à la questionner au moyen des critères réglant le statut du discours (vrai ou faux). Méconnaissance de la spécificité des questions artistiques (elles ne sont jamais considérées pour elles-mêmes).
Son problème est de détruire la puissance des fables et des images au profit d’une logique de vérité (par où l’on voit qu’il ne mésestime pas la puissance de l’art)
Platon lie toujours 3 thèmes: art, vérité, cité.
Cette problématique nous apparaît cruellement dépassée. Mais, à y réfléchir un peu, l’hétérogénéité de ces termes n’est-elle pas une de nos croyances d’esthètes ?
Cette analyse platonicienne commande toute la conception antique et classique de l’art : dans l’Antiquité, il est admis que l’art doit imiter la Nature
Dialogue Socrate/Glaucon dans le Livre X de la République : A quoi Homère sert-il ?(705 à 710)
I. L’art doit-il imiter le réel ?
ARISTOTE
Là où Platon ne voit l’art que comme imitation (et illusion), Aristote le voit comme représentation.
Il a l’idée que cette représentation, éclairante, aide à l’éducation comme à la conquête du savoir. Aristote fait l’hypothèse anthropologique d’un plaisir visuel fondamental: depuis l’enfance, nous aurions le double goût de voir (connaissance) et d‘imiter (art).
Poétique ( 1448b 4-18): « Dès l’enfance les hommes ont, inscrites dans leur nature, à la fois une tendance à représenter (…) et une tendance à trouver plaisir aux représentations. Nous en avons une preuve dans l’expérience pratique: nous avons plaisir à regarder les images les plus soignées des choses dont la vue nous est pénible dans la réalité, par exemple les formes d’animaux parfaitement ignobles ou de cadavres; la raison en est qu’apprendre est un plaisir (..); en effet si l’on aime à voir des images, c’est qu’en les regardant on apprend à connaître et on conclut ce qu’est chaque chose comme lorsqu’on dit: celui-là, c’est lui » : accès privilégié que l’art nous donne à la structure des choses.
Le plan n’est plus celui de l’apparence et du non-être, moins encore celui du fantasme ou du simulacre ou du faux-semblant; c’est celui de la clarté.
La mimésis est l’opération qui nous donne accès aux Formes.
L’art détient une puissance d’intelligibilité.
Par l’œuvre s’effectue une reconnaissance qui est passage de l’inconnu au connu. C’est comme voir les choses « en vrai » nous renseignait moins sur leur vérité (ce qu’elles sont vraiment) que les voir peintes sculptées, représentées.
L’expérience de la représentation est une conversion de l’ignorance en connaissance (on est aux antipodes de la dissociation kantienne entre connaissance et goût).
L’art est devenu une région du savoir.
Il reste que, pour Aristote, l’Art emprunte ses formes à la Nature : l’art est la reproduction, la plus parfaite possible = la plus conforme possible aux choses de la Nature
On connaît l’intérêt des peintres de la Renaissance pour l’anatomie : à partir du XVIème siècle, les autorités (d’abord dans le sud de l’Italie) commencent à autoriser la pratique des dissections humaines. Très vite, les peintres tentent de se faire admettre lors de ces expériences. Cf le tableau de Rembrandt intitulé « La leçon d’anatomie du Docteur Nicolaes Tulp »1632 . On parle ainsi de la « manie myologique » de Michel-Ange, sa tendance à représenter tous les muscles, à baser son art sur des connaissances anatomiques (toutes récentes).
Léonard de Vinci : « l’Homme de Vitruve »: Travail sur les écrits de Vitruve, architecte romain (1er après JC) : le corps masculin est inscrit dans deux formes géométriques tenues pour parfaites (le cercle et le carré) étude très précise des proportions du corps humain. Exemple : le corps doit représenter 8x les dimensions de la tête (codification de la beauté)
Ex : Le « tableau parfait », longtemps proposé comme modèle (cf Histoire naturelle de Pline, XXXV.36, cité par Hegel dans l’introduction à son Cours d’Esthétique): le modèle du trompe-l’œil : un mythe de l’histoire de l’art (Grèce : Vème avant J.C) : un duel pictural oppose Zeuxis à Parrhasius d’Ephèse. Zeuxis fait une nature morte, avec des raisins et des poires. Au moment où le jury va se prononcer sur le tableau, un oiseau vivantfonce sur le tableau …et tombe à ses pieds (la Nature fascinée par l’Art) ; on demande alors à Parrhasius d’écarter le rideau de son propre tableau…le rideau constitue le tableau !
Mais l’art a-t-il vraiment pour vocation de produire l’illusion du réel ?
De produire des illusions tout court ?
Cette vocation de l’art à imiter tombe sous le coup de plusieurs critiques :
- la critique ironique de Pascal : « Quelle vanité que la peinture qui attire l’admiration pour la ressemblance des choses dont on n’admire point les originaux !» Pensées (critique du divertissement : tout ce qui nous détourne de la quête de Dieu (jansénisme)). La peinture est absurde et inutile. Nous détournant des « activités sérieuses et profondes », elle est une activité nuisible (retour à Platon : l’artiste comme un dangereux charlatan, un marchand d’illusions…)
- même aux époques où l’art ne se donnait pas d’autre idéal que d’imiter la Nature, l’art ne se limite pas à une simple copie mais exige un peu d’invention : pour bien imiter la Nature, il faut la transformer (marche ; statue « grandeur nature »…à 4 m de haut)
Texte de Diderot : « Paradoxe sur le comédien » (Roussel p 42 / Hatier texte 6 p 138) (1)
- Si l’art ne faisait qu’imiter, créer étant plus valorisé qu’imiter, les plus modestes productions de la technique (le clou) seraient supérieures aux œuvres les plus éminentes. En effet, la technique est invention et non simple reproduction. Or CREER ≥ IMITER
Cf . Hegel (L’Esthétique) : Texte (2)
L’art est obligé de se présenter sous une forme naturelle (portrait, paysage : art représentatif) mais cela ne doit pas faire oublier que l’art est spirituel par essence. Or, ce qui est spirituel est toujours supérieur à ce qui est naturel (une mauvaise idée est plus élevée que n’importe quel produit naturel). Ainsi, le Beau artistique est forcément supérieur au Beau dans la Nature : parce qu’il est deux fois né de l’esprit (l’esprit du créateur + l’esprit du spectateur)
Le réel ≠ le beau : est-ce que l’art cherche le réel ? le Beau ? Ce n’est pas forcément compatible !
Hegel : en faisant du réel le but de l’art, on fait disparaître le beau lui-même : la représentation exacte éclipse la représentation belle
A cette critique, Kant avait déjà répondu :
Kant : « L’art n’est pas la représentation d’une belle chose mais la belle représentation d’une chose »
Faire du beau à partir du laid : Rembrandt, Le bœuf écorché
La beauté du modèle ne conditionne pas la beauté artistique : la beauté artistique est indépendante de la beauté naturelle
Cf l’enfer peint par Jérôme Bosch ou bien « las Viejas » de Goy
Un autre mythe de l’histoire de la peinture raconte que Zeuxis, désireux de peindre une Vénus la plus belle possible s’inspira pour la peindre des traits empruntés à cinq très belles jeunes filles.
Au XXème siècle, l’artiste Orlan tourne en dérision cette conception de la beauté en effectuant une série d’opérations sur son visage dans le but de s’attribuer : le front de Mona Lisa, le menton de la Vénus de Botticelli etc.
Texte de Grimaldi (3) :
- on est tenté d’expliquer la beauté par la fonctionnalité : les choses les plus belles sont aussi celles qui sont le plus conformes à leur usage (le plus beau cheval = celui qui court le plus vite ; le plus bel avion = le plus aérodynamique ; la plus belle fleur = celle qui attire le plus d’insectes). Vitruve : les trois piliers de l’architecture sont : « Utilitas, firmitas, venustas » : utilité, solidité, beauté.
Dans cette optique, le beau = la perfection du concept
Mais c’est oublier (antithèse) qu’il n’y a pas, dans la nature, de « beaux cadavres, de beaux cul-de-jatte ni de beaux fous hagards » (Cf. Michel-Ange « L’âme damnée »)
La beauté esthétique est irréductible à la beauté naturelle.
Dans la conception imitative de l’art, les seuls problèmes qui se poseraient à l’artiste seraient des problèmes techniques : la difficulté de l’exécution (il est extrêmement difficile de « rendre » le moiré d’un tissu, le velouté d’une peau d’enfant, un reflet dans l’eau). Mais alors, ce n’est plus la beauté qu’on admire : c’est la virtuosité (représenter si bien des pans de velours qu’on ait envie d’y plonger les doigts !).
Alors, notre critère pour juger de l’art devient un critère technique.
La qualité d’une œuvre d’art renvoie seulement à l’habileté de l’artiste. Cette habileté suscite notre grande admiration. Mais, si grande qu’elle soit, elle ne suffit pas à expliquer la fascination qu’une œuvre peut exercer sur nous.
Or, parler de l’art, c’est essayer de comprendre son pouvoir sur nous = tâcher d’expliquer notre fascination, notre « sidération » (= ce qui nous laisse sans voix ; bouche bée).
L’art exerce un impact sur notre sensibilité : il soulève l’enthousiasme, la passion, la fascination. L’art est le lieu de l’émotion ; l’émotion échappe aux discours.
Braque : « L’art est fait pour troubler, la science rassure » (cf : Mathiew Barney « sculpteur » : artiste-athlète américain, né en 1965. Sa première exposition, en 1991 : il perce plafond et murs de la galerie de peinture de harnais et s’y suspend, presque nu, se mouvant dans l’espace (Transexualis)
Ce n’est pas que l’œuvre d’art n’ait pas besoin d’être expliquée, c’est que toute tentative d’explication parallèle à l’œuvre (explication souvent verbale) est réductrice, manque l’essentiel (…vanité des baratins de France musique). Il y a un décalage choquant entre nos sens émus et le discours érudit.
Braque : « Il n’est en art qu’une chose qui vaille : celle qu’on ne peut expliquer »
La beauté ne se prouve pas, elle s’éprouve : elle est affaire de sensibilité, pas d’intelligence (dans les copies, ne pas dire « l’artiste veut nous dire que… » : L’artiste donne à voir…à penser aussi, c’est tout ; c’est beaucoup).
Conclusion : il a fallu cesser de voir l’artiste comme au service de la Nature : c’est plutôt la Nature qui est au service de l’artiste (elle fournit les matériaux, les motifs…). Dès lors, l’enjeu de l’art devient plus important : non plus la fidélité de la reproduction mais l’originalité de la création. Non plus l’imitation mais la fécondité de l’imaginaire.
On s’intéresse alors non plus exclusivement aux arts « naturellement figuratifs » : peinture, sculpture mais aussi à la poésie, l’architecture, la musique.
Musique : on peut dire que Vivaldi « restitue » un petit quelque chose des quatre saisons… mais on ne le dit qu’en connaissant le titre des symphonies. Faites écouter la symphonie de Dworjack à quelqu’un qui ne le connait pas en lui demandant de deviner son titre, on verra qui trouve « la Symphonie du Nouveau Monde » !!
(= pour montrer les limites de la conception imitative de l’art, pensez que l’art ne se réduit pas à la peinture)
Rimsky-Korsakov http://www.youtube.com/watch?v=n2LTWFAC8zQ
- Copier la Nature (simple représentation) : imitation
- S’exprimer à travers la Nature (utiliser la Nature pour dire une Vérité sur soi) : la pluie est ce qu’on en fait de « Singing in the rain » dansé par Gene Kelly dans « Un Américain à Paris » au poème de Verlaine : « Ariettes oubliées » : « il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville… » : subjectivité.
- Autre exemple : Artemisia Gentileschi, peintre, contemporaine du Caravage (XVIIème), dans son tableau « Judith décapitant Holopherne » représente ses traits en Judith tandis qu’Holopherne ressemble à son précepteur Agostino Tassi. Or, on sait qu’ Agostino Tassi avait violé la jeune fille quand elle avait 19 ans

Faire du beau avec du laid : d’un viol, faire un tableau magnifique.
Autre exemple : le film sud coréen Poetry (2010, de Lee Chang-dong), que j’admire infiniment. L’héroïne s’est donné pour défi d’écrire un premier poème. Son professeur d’écriture insiste sur les beautés de la nature / elle finira par trouver l’inspiration dans un fait tragique (qui la touche de près) et par écrire l’éloge funèbre d’un toute jeune suicidée.
Une autre façon de transfigurer la nature : la magnifier, la parfaire, l’exagérer.
« Chez Balzac, même les concierges ont du génie », disait Charles Baudelaire (Balzac – « la Comédie humaine » = 95 romans – un des initiateurs du réalisme en littérature)
- Exprimer la Nature (dire à son propos une vérité visible mais que tous ne voient pas).
Balzac : « La mission de l’art n’est pas de copier la Nature mais de l’exprimer »
- Nietzsche : « Aucun artiste ne tolère le réel »
A.Malraux , Les Voix du silence : « Les grands artistes ne sont pas les transcripteurs du monde, ils en sont les rivaux. »
Paul Klee : « L’art ne reproduit pas le visible ; il rend visible. »
Transition : Parcours « flèche » de l’Histoire de l’Art :
Historiquement, on peut distinguer peut-être trois étapes, trois statuts de l’œuvre, de l’art:
1/ l’art s’adresse à l’âme
(L’interprétation la plus sérieuse qui est retenue aujourd’hui pour l’occurrence de l’art la plus ancienne que l’on connaisse -Lascaux, entre -30 000 et -15 000 avant notre ère -est celle de peintures magico-religieuses, cachées à tous les regards)
André Malraux Les Voix du silence : « Un crucifix roman n’était pas d’abord une sculpture, la « Madone » de Cimabue n’était pas d’abord un tableau, même la « Pallas Athénée » de Phidias n’était pas d’abord une statue » Ils furent en premier lieu sinon le Christ, la Vierge et Athéna eux-mêmes, du moins des signes du divin, de sa présence. Ils en furent les représentants, les délégués ».
Des sortes de medias entre nous et la divinité (cf : ce qu’est une icône pour les orthodoxes)
Musique comme support de la prière
2/ l’art s’adresse aux sens (XVIème, XVIIème)
(cf. la réorientation de la peinture hollandaise : rendre le mieux possible les textures et les matières du monde: étoffes, grain des nourritures, fruits et gibiers, transparence du verre…). Rembrandt ; Vermeer ; Dürer…

3/ l’art s’adresse au jugement et à l’intelligence (XXème, XXIème)
On a dit tout à l’heure que l’art s’adressait à la sensibilité et non à l’intelligence : ce n’est plus si vrai à partir du XXème
Enigme de l’art contemporain : ne recherche plus le beau (« les demoiselles d’Avignon » de Picasso ni même l’humain : difficile de s’émouvoir devant un Vasarely)
Esthétisme : raffinement dans les règles ; s’adresse à un public restreint (« averti ») possédant beaucoup de références culturelles.
Non plus jouissance sensuelle (musique sérielle, Schönberg, Pierre Boulez : Le Soleil des eaux) mais plaisir intellectuel.
Exemple : le cubisme, qui cherche non pas la figuration du monde mais qui dit comment nous l’explorons : plusieurs plans à la fois // les divers points de vue successifs.
Pablo Picasso, « Les demoiselles d’Avignon », 1907 (actuellement au MoMa , New York)
Hugo Pernet (1983) : Œuvre de 2009 : Rouge, jaune, bleu: http://www.youtube.com/watch?v=OTJ07V1QcZ4
Œuvre volontairement déceptive : il n’y a (presque) rien à voir, mais un rendez-vous est donné sur youtube : le spectateur doit être assez motivé pour aller chercher plus tard la vidéo en question. Elle montre un ‘crash test’ réalisé par des scientifiques dans les années 70. Les couleurs dominantes dans les fumées résultant de l’explosion sont le rouge, le bleu et le jaune. Ce n’est pas encore une clef suffisante. Il faut encore savoir que Pernet admire B.Newman, auteur d’une série nommée « Qui a peur du rouge, du jaune et du bleu ? », couleurs primaires, très prisées par Mondrian, artiste de référence pour Newman comme pour Pernet. On a ainsi tout un jeu de renvois qui s’adresse à un spectateur assez actif dans sa démarche pour faire le parcours…plaisir de l’intelligence.
II. La révolution contemporaine
- La reproduction tue-t-elle l’émotion ? (de la banalisation de l’art)
(cf.W.Benjamin : L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité tehnique.1936)
http://e-cours-arts-plastiques.com/vocabulaire-illustre-images-multiples-serie-sequence/
Comment éprouver une émotion authentique devant des œuvres qu’on a vues mille et mille fois sur des cartes postales, des cendriers, des boîtes d’allumettes ? Et c’est ainsi qu’on n’éprouve plus que lassitude devant La Laitière de Vermeer, Les glaneuses ou L’Angélus de Millet.
Il y a eu perte du sentiment religieux qui était celui de l’émotion esthétique depuis des siècles (et jusqu’au XVIIème)
Ainsi, l’industrie culturelle perturbe notre expérience.
Avant le XVIIIème, la rencontre œuvre/spectateur était rare, c’était un évènement véritable.
Aujourd’hui, la distance est presque totalement abolie. Et avec cette abolition de la distance, s’est perdu le sentiment d’étrangeté.
L’œuvre se rapproche toujours des biens de consommation (c’est ce que disent les « séries » de Warhol)
Aujourd’hui, un autre phénomène apparaît : les « multiples » : certains artistes créent une série limitée d’objets d’art absolument identiques (ex : moulage, photo) destinés à la vente.
Acteurs de ce rapprochement: l’essor du musée, le détournement publicitaire, la reproduction sérigraphiée, la réduction de certains tableaux au format du timbre-poste, l’industrie du CD, les « grands airs » de la musique classique massacrés par nos sonneries de portables.
Toutes ces techniques contribuent à la banalisation de l’art.
(Attention, je ne suis pas en train de regretter le temps béni où seuls les nantis avaient accès à l’art; juste en train d’attirer votre attention sur le fait qu’une telle banalisation veut forcément dire un rapport complètement différent à l’œuvre, une modification profonde de sa perception même)
Pensez à la musique. Pendant des siècles, elle impliquait nécessairement la présence physique des musiciens, parfois de tout un orchestre.
Paul Valéry parle alors de la toute nouvelle (il s’agit d’un texte de 1928) ubiquité des arts, de leur conquête de l’ubiquité.
Selon André Malraux, le musée imaginaire (titre d’un livre de Malraux) a remplacé le musée réel et tout se passe désormais comme si nous avions accès aux œuvres en leur absence (effet de l’imprimerie). Ainsi, la banalisation des œuvres se double de leur virtualisation (analyse ô combien confirmée depuis qu’existe « google image » !)
2) De l’art représentatif à l’art conceptuel
- a) Maurice Denis (peintre français, fin XIXème)
« Un tableau, avant d’être une bataille, une femme ou un cheval, n’est qu’un ensemble de couleurs en un certain ordre assemblées »
- Denis signe la fin de l’illustration et le début du règne de la « peinture pure»
L’art est libéré de la représentation du monde.
Stéphane Mallarmé : « Nommer un objet, c’est supprimer les trois-quarts de la jouissance du poème ; le suggérer, voilà le rêve »
b) Kasimir Malevitch
Peintre de l’avant-garde russe, d’origine ukrainienne, peintre-phare du XXème siècle. Il a commencé par des œuvres dans le style du « primitivisme russe » : essai de simplification du visible (des formes volontairement grossières : « Baigneur », 1911, p 12). Puis il fut marqué par l’impressionnisme « à la française » (et aussi Gauguin et Cézanne) puis par le cubisme (Picasso et Fernand Léger) : « Portrait perfectionné d’Ivan Vassiliévitch Kiliounkov » (1913 p 24). Vient alors la période où il invente son propre courant : le suprématisme. Des œuvres de plus en plus dépouillées jusqu’à ses trois dernières œuvres-icônes : « Carré noir sur fond blanc » ,1913 (p 48) ; « Carré rouge sur fond blanc », 1915 ; « Carré blanc sur fond blanc), 1918.

Le « Carré noir sur fond blanc » devient emblématique de Malevitch lui-même puisqu’il signera des œuvres postérieures d’un petit « carré noir » (ex : c’est ainsi qu’il paraphe un de ses derniers portraits : « Travailleuse », 1933, p 87). Il est aussi présent/absent dans son autoportrait de 1933 (p 88).
Ces « carrés » sont peints par petites touches impressionnistes et non pas au tire-ligne ni avec une couleur parfaitement unie : il a voulu qu’on sente le travail de sa main jusque dans le tremblé, et la déformation des bords du « quadrangle ». Beaucoup d’humour aussi chez Malevitch : celui qu’on appelle familièrement le « carré rouge » porte pour titre « Réalisme pictural d’une paysanne à deux dimensions ».
Il écrira : « Un visage peint sur un tableau donne une parodie pitoyable de la vie ».
Malevitch encore : « Quand disparaîtra l’habitude (…) de voir dans les tableaux la représentation de petits coins de nature, de madones ou de Vénus impudiques, alors seulement nous verrons l’œuvre picturale… ». (Tract « Zéro-Dix »).
Jeune encore (40 ans) à l’époque de « Carré blanc », il s’arrête (momentanément) de peindre, s’intéresse passionnément à l’architecture l’élaboration de sa théorie picturale : le suprématisme (plus tard, il effectuera ce qu’il appelle son « retour à la peinture » : le « post-suprématisme » ; des personnages identifiables, colorés, statiques…avec quelques allusions au suprématisme exemple : « Tête de paysan », vers 1930, p 74. On dirait des icônes.)
Avec le suprématisme, la peinture abandonne le domaine du sensible et veut s’adresser à la pensée. Il écrit vouloir « aller de plus en plus loin dans le vide des déserts, car ce n’est qu’à cet endroit qu’est la transfiguration. Sur mon carré, vous ne verrez jamais dormir le sourire d’une mignonne Psyché ! Il ne sera jamais le matelas de l’amour ! ».
La peinture rivalise avec la philosophie : comme le philosophe, l’artiste veut donner à penser, étonner (rôle de l’insolite). La représentation s’efface devant la réflexion : l’image veut prendre la place du concept (Suprématisme : contestation de la suprématie intellectuelle du langage). Pour rivaliser avec le concept, l’œuvre doit se dépouiller de tout ce qu’elle a d’anecdotique (motif), de trop particulier, de représentatif, de coloré, d’inessentiel. Se hausser à l’universalité de l’IDEE (abstraite, générale).Que reste-t-il ? : Carré blanc sur fond blanc !
Pour que l’art totalement abstrait existe, il faudrait qu’il soit invisible : que le cadre soit vide. Le peintre veut donner la sensation de l’évanouissement des formes dans l’espace, de leur extinction.
Ceci a peut-être quelque chose à voir avec Léonard de Vinci quand il place ses élèves devant un mur lépreux et qu’il les encourage à y découvrir une formidable bataille.
Ces trois carrés sont surtout une espèce de « table rase » : un aboutissement à partir duquel tout peut être repris, repensé.
N.B : Si Malevitch est tenu pour un très grand peintre, c’est moins pour sa peinture que pour son œuvre de théoricien. Disparition de l’art comme activité autonome (si vous n’avez pas le discours théorique indispensable pour faire-valoir votre peinture, vous n’avez pas de légitimité artistique : on vous prend pour un imposteur et personne n’ira exposer votre œuvre)
La reconnaissance de l’artiste comme un « Grand » a toujours posé problème : aujourd’hui, les impressionnistes sont les peintres les plus appréciés par le grand public. Pourtant, à l’époque dont ils sont contemporains (fin XIXème), ils sont loin d’être reconnus. Pour preuve, l’histoire du « Legs de Caillebotte » : Quand Caillebotte décède, en 1894), il veut léguer à l’Etat sa collection, soit 67 tableaux des plus grands peintres impressionnistes (Degas, Cézanne, Monet, Manet, Renoir). L’Etat n’accepte que 38 des 67 œuvres…(refusant, pas exemple, les huit Degas).
c) Marcel Duchamp

Révolution dans la définition de l’œuvre ouverte en 1917 par Marcel Duchamp, dadaïste. Son geste inaugural (il est alors un peintre connu et reconnu): exposer comme œuvre un urinoir à peine modifié (signé du pseudo « R.Mutt », peut-être une subversion de R.Mott, le fabricant de ces urinoirs). C’était aux Etats-Unis, lors d’une exposition dont il présidait le jury : d’où la nécessité du pseudonyme. Devant le scandale provoqué par son œuvre chez les autres membres du jury, il démissionne.
Revirement du jury ; mais il maintient sa position.
Avec cette pratique du « ready-made » (c’est Duchamp qui a inventé le terme, comme une abréviation de « already made »= déjà fait), Duchamp cesse de peindre.
Son raisonnement est le suivant : les tubes de peinture sont déjà un produit issu de l’industrie : pourquoi ne pas se servir des produits issus de l’industrie ? Autre illustration : un porte-bouteille, acheté au BHV, auquel il donne un titre et qu’il accroche dans son atelier.
Autre œuvre provocatrice de Duchamp : au moment où, après une longue disparition parce qu’elle avait été volée, la Joconde reprend sa place au Louvre, et que des dizaines de milliers de reproductions sur tous supports en sont faits, Duchamp l’affuble d’une moustache et de ce titre : « LHOOQ »

L’art n’est plus référé à une longue tradition des métiers, à un savoir-faire technique qui atteint à la virtuosité. Il devient une pratique indéfinie. Après Duchamp, il n’y a plus d’artistes peintres; mais des artistes tout court.
Un des reproches les plus courants face à l’œuvre contemporaine, c’est son absence de virtuosité technique, sa platitude technique (« tout le monde pourrait le faire »). Est-ce que l’œuvre contemporaine demande encore du travail ?
La réponse de Duchamp : oui, mais c’est un travail de l’esprit, et non plus des mains.
Si on prend un artiste comme l’américain Jeff Koons, il conçoit ses œuvres mais le montage est effectué par ses assistants (il ne touche à rien : son travail est exclusivement un travail intellectuel).
Duchamp: « Ramener l’idée de la considération esthétique à un choix mental et non pas à la capacité ou à l’intelligence de la main ».
Ce qui fait l’art, c’est la pensée pure, la pure désignation : c’est parce que M. Duchamp proclame cet objet « œuvre » qu’il le devient; c’est parce qu’il lui donne un titre (« Fontaine ») et la signe; c’est parce qu’ il l’installe arbitrairement dans l’espace du regard esthétique: la galerie d’art.
L’œuvre relève alors de la réflexion et de la persuasion, non plus de l’œil ou de la main. Il s’agit surtout de déclencher le mécanisme du scandale défiant et de la crédibilité satisfaite: il s’agit qu’un large public s’offusque (un urinoir!) et qu’un petit public admire le coup de force, le reconnaisse comme origine et se définisse du même coup comme autant d’initiés.
(Pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin : http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Duchamp/ENS-duchamp.htm)
Dès lors, l’espace et le temps de l’exposition décideraient seuls du caractère artistique de l’objet (ou pire: le prix). Désormais, l’art serait devenu évènement (happening) et non plus œuvre.
Exemple de « happening » : En 1965, dans un musée de Düsseldorf, Joseph Beuys, le visage peint de miel et d’or, expliquait les œuvres du musée à un cadavre de lièvre qu’il portait sur le bras.
Au XXème, l’appartenance d’un objet à l’art pose problème (on a envie de dire: est affaire d’idéologie, de croyance). Parce que son statut est devenu ambigu, l’œuvre fait question avant de se donner aux sens et aux émotions.
Devant une œuvre : « c’est de l’art, ça ? » Qu’est-ce que l’art ? = l’artiste a « posé son sujet de philosophie » !
Duchamp disait vouloir produire le sentiment d’une « beauté d’indifférence ». Il voulait défaire l’expérience de l’art de l’exercice du goût.
L’œuvre ne nous affecte plus, elle nous interroge.
donner à sentir → faire penser
 Art conceptuel: Joseph Kosuth : « One and three chairs » (C.Millet « Domino” p 87)
Art conceptuel: Joseph Kosuth : « One and three chairs » (C.Millet « Domino” p 87)
Autre changement: en un sens, c’est le spectateur qui fait l’œuvre puisqu’il est contraint soit à nier qu’elle en soit une, soit à avouer qu’elle en est une.
Donnons pour exemple l’œuvre de Picasso nommée « Tête de Taureau » (1924) :
Picasso adopte le procédé de souder des éléments ; il assemble sa tête de taureau avec des éléments pris d’une bicyclette : le guidon pour les cornes, la selle pour représenter la tête. On est sur le chemin du ready-made.
Le ready-made confère au public une responsabilité énorme : c’est le public qui décide s’il accepte ou non qu’une roue de bicyclette montée à l’envers sur un tabouret soit une œuvre d’art.
Marcel Duchamp, « roue de bicyclette » 1913/1964
Le spectateur…ou le musée : c’est la présence de l’objet dans ce lieu qui dicte au spectateur son attitude (regarder et non uriner), la qualité de son regard.
3) Le spectateur et le musée
On peut dire que, dans l’histoire de l’art, l’œuvre a vraiment changé de statut quand ont été créés les musées. Auparavant, les œuvres étaient dans des églises ou dans des palais, où elles remplissaient une fonction de représentation. Au musée (XIXème siècle), elles sont uniquement proposées à l’adoration du spectateur. Elles sont alors sacralisées. A la fin du XXème siècle, Le musée tend à être contesté comme un instrument de sacralisation de l’œuvre ; quelque chose qui la fige :
*plaisir pervers que prend l’artiste à salir le musée avec du charbon, de la margarine, des matériaux bruts et souvent non nobles (« arte povera »)
*plaisir pervers que prend l’artiste à proposer des œuvres inadaptées à un espace d’exposition traditionnel (ex : sphère rouge de 3m de diamètre et deux tonnes) : aménagement de locaux spécialement adaptés ; CAPC de Bordeaux.
…enfants gâtés de l’institution (paradoxe)
*artistes obsédés par l’idée que l’art doit « sortir du tableau » et l’œuvre…sortir du musée : ex : en 1986, le directeur du musée de Gand invite les spectateurs à parcourir la ville pour une expo intitulée « Chambres d’amis » (œuvres chez des particuliers).
*ambiguïté de la tâche (du rôle) du « Conservateur » : que signifie être conservateur d’un art en train de se faire ? (provocation : œuvre dont le centre est une laitue toujours fraîche…)
On peut distinguer deux formes artistiques : traditionnelles (peintures, sculptures : installations fixes) et expérimentales : « performances » ou « happening ». Cette seconde forme donne beaucoup d’importance au spectateur : il n’y a plus un objet qui est là de toute façon mais il est important d’être là et de participer à ce qui se passe :
Action painting = le tableau est une arène. C’est moins le résultat qui compte que ce qui se passe lors de son exécution, toujours publique
Ex : le « dripping » de Pollock (Art-spectacle et non plus pratique solitaire)
Plus : le spectateur est sommé d’entrer dans l’œuvre :
En 1977, Orlan propose le « Baiser de l’artiste » au Grand Palais (exposition de la FIAC : Foire Internationale de l’Art Contemporain) pour 5 francs.
http://www.ina.fr/fresques/elles…/orlan-le–baiser-de-l-artiste-archive.html
Entre 1960 et 1970, un courant artistique est à signaler, avec un certain rapport avec ce que fait ici Orlan : l’actionnisme viennois. Les artistes qui font partie de ce mouvement sont les auteurs de performances le plus souvent centrées sur le corps (le leur comme celui de leurs modèles), souvent utilisé de façon violente et/ou outrageante.
Ex : Pont-Neuf empaqueté en 1985 par Christo et Jeanne-Claude : ceux qui l’ont traversé éprouvent beaucoup plus que ceux qui ont seulement vu les photos : ils ont l’impression, voyant la place de l’événement dans les Annales de l’Histoire de l’Art, d’être les dépositaires de l’œuvre (eux disparus, quelque chose d’essentiel de l’œuvre sera perdu).
Umberto Eco (L’Oeuvre ouverte) : le destinataire de l’œuvre la parachève.
Efforts pour décevoir la rétine : élever le spectateur au rang de participant.
M.Duchamp : « La signification d’une œuvre réside non pas dans son origine mais dans sa destination. Le spectateur doit naître aux dépends du peintre. »
Braco Dimitrijevic (yougoslave) : comme il l’a vu faire à Sarajevo dans son enfance avec des portraits de Tito, affiche des photos immensément agrandies sur des façades d’immeubles, des monuments publics (culte de la personnalité / anonymes arrêtés dans la rue (cf. C.Millet p 78)
Philippe Thomas (peintre mort en 1995): quand quelqu’un se porte acquéreur d’un de ses tableaux, il en devient le signataire : c’est le nom des différents collectionneurs qui se trouve dans les revues d’art et non celui de P. Thomas ! Nom de l’agence créée par P.Thomas : « Les ready-made appartiennent à tout le monde ».
Dans ses expositions, à chaque instant le visiteur est invité à se substituer au créateur.
Un pas de plus : le corps de ceux qui viennent assister au Happening peut aussi servir de matériau (body art) : subvertir toutes les positions, les statuts.
Ainsi, Klein demande à ses modèles (jeunes femmes nues) de badigeonner leur corps de couleurs et de l’appliquer sur la toile, y laissant leur empreinte (modèles et « pinceaux » !)
Cette invitation faite au spectateur à participer se double d’un refus du désir d’immortalité de l’artiste : les artistes du XXème s’inscrivent dans l’éphémère :
Exposition de Robert Morris à la Tate Gallery en 1971 : constructions faites pour qu’on les escalade : le public joue si bien le jeu qu’en peu de jours, l’œuvre est détruite et l’exposition est fermée.
CONCLUSION :
Art qui cherche à abolir la frontière entre l’art et la vie
Art qui cherche à subvertir toutes les règles
Art qui cherche à désacraliser l’œuvre d’art : faire descendre les œuvres de leur piédestal (ex : Andy Warhol : Marilyn Monroe : anti élitistes + abolir la distance entre œuvre d’art et produit de l’industrie)
Utilisation constante de la provocation : difficile de vénérer un urinoir
L’œuvre d’art n’accepte pas de se prêter au fétichisme… jusqu’à l’abolition de l’objet d’art : dématérialisation des œuvres d’art. Matériaux tels qu’une fois l’exposition terminée, ils atterrissent à la décharge.
…Paradoxe : échec de cette désacralisation : le milieu de l’art y a suppléé par son narcissisme (sacralisation malgré tout !)
Interprétation possible : Moralisateurs, les contemporains ont dénoncé le fait que l’œuvre d’art était un mensonge (// Platon ?). Les avant-gardistes ont voulu dire la vérité du tableau (« on ne veut pas de supercherie »).
Tableau désarticulé au point d’être réduit à ses composants matériels.
De même, il s’agit de dire la vérité sur le contexte dans lequel s’inscrit l’œuvre : déportation de l’attention vers le musée ou vers le regardeur. Exemple : miroir inclus symboliquement dans l’œuvre ; ou encore : une exposition au musée de Clermont-Ferrand où les œuvres sont suspendues au centre de la pièce (on peut faire le tour de tous les tableaux // on ne vous cache rien de l’envers du décor)
Polémique 2018 :
Jeff Koons projette d’installer son bouquet de tulipes (ici devant le musée Guggenheim de Bilbao) en mémoire aux victimes des attentats parisiens du 13 novembre 2015 : art mémoriel (une main, tenant ce bouquet)
Œuvre monumentale : 38 tonnes, une dizaine de mètres
Signataires d’un pétition contre cette installation : Koons est « devenu l’emblème d’un art industriel, spectaculaire et spéculatif». Production de l’œuvre, évaluée à trois millions d’euros, financée par le mécénat privé. L’emplacement envisagé est devant le Musée d’art moderne et le Palais de Tokyo : lieu symbolique, déconnecté du lieu des événements.
III . Les oeuvres d’art nous enseignent-elles quelque chose ?
Précisons tout de suite que nous voulons parler ici des œuvres dans leur dimension esthétique(ce qui entre en rapport avec nos sensations de spectateurs) : l’utilisation de l’œuvre comme document (sur l’auteur ou sur une époque, une tendance), nous l’excluons d’emblée.
Une œuvre d’art, c’est toujours une rencontre. Rencontre entre un objet (sculpture, mélodie, ballet, tableau, poème etc.) et un amateur. Est-ce que cette rencontre, qui a été voulue par le créateur de l’œuvre, a pour seule fin une émotion, une sensation (un éventuel plaisir) du spectateur ? Est-ce que l’intention de l’artiste est plus didactique : faire passer un message, apprendre au spectateur quelque chose sur le réel ou sur lui même ? Est-ce qu’une œuvre d’art nous enseigne quelque chose ? De quel ordre est alors ce « quelque chose »? Il y a, dans la notion d’enseignement, l’idée d’un processus volontaire et conscient : on suppose alors que l’artiste VEUT transmettre un savoir à l’amateur, qu’il SAIT quel est le contenu de l’œuvre (ce qui va être effectivement reçu dans le contact avec l’œuvre). Il y a aussi l’idée d’une certaine unilatéralité, la relation se faisant uniquement dans le sens œuvre > amateur. Doit-on alors penser que la vocation de l’art soit de faire passer un contenu précis de l’artiste à l’amateur ou bien le concept d’enseignement est-il mal adapté pour rendre compte du contact de qui aime l’art avec les œuvres ? L’exploration de cette question devrait nous renseigner sur la vocation profonde de l’art, et même sur son essence.
- Il arrive que l’artiste ait l’intention de faire passer un message précis, avec un effet précis sur le spectateur.
Art et politique : l’art engagé (« Massacre en Corée » de Picasso ; « El tres de mayo » de Goya ; le poème « Melancholia » de Victor Hugo dans les Contemplations)
Art et morale : l’art comme édifiant ; l’effet moralisateur de l’art (Molière : je tends an spectateur un miroir ; La Fontaine : l’artiste//moraliste) + le dicton « la musique adoucit les mœurs ». Thèse de l’incompatibilité entre la Beauté et la Méchanceté (antithèse : certains des dignitaires nazis les plus inhumains étaient des gens très raffinés, amateurs de grande musique…)
Ressort du film « Orange mécanique » (Kubrick) : la contraste entre la musique et la cruauté de l’action.
Cependant, une œuvre peut être mauvaise à force d’être trop didactique (« Le Destin », de Youssef Chahine, réalisateur égyptien)
- On ne peut réduire les œuvres à un message univoque, à un contenu précis, à une leçon
L’œuvre d’art puissante est celle qui « me bouge » (me meut // m’émeut) : Je donne l’exemple d’une toile de Klein : un grand aplat bleu profond. Ce tableau peut faire impact sur ma sensibilité, m’entraîner dans une certaine qualité d’émotion.
En ce qui concerne les œuvres les plus fortes, il y a quelque chose comme un avant et un après…ce qui ne veut pas dire que je puisse les réduire à un « message ». Les œuvres trop claires, trop univoques, ne laissent pas assez d’espace interprétatif au spectateur.
Il est à noter que les artistes sont quelquefois « dépassés » par leur œuvre : ils n’en maîtrisent que partiellement le sens (dimension inconsciente de l’œuvre)
Baudelaire : théorie de la lacune. Un poème est riche parce qu’il y a une lacune dans son sens. C’est de ce manque qu’il est riche : chacun peut alors l’investir de son interprétation : c’est parce qu’ils en disent PAS ASSEZ et non TROP que les arts nous parlent (mais, du coup, l’œuvre ne diffuse pas une vérité accessible à tous : tout le monde n’accède pas à l’idée incluse dans l’œuvre, alors que dans le cinéma commercial, il est difficile de rater le message qui est simpliste + asséné + répété à l’envie)
Antonin Artaud : l’art est « une fente, ouverte sur l’infini » : ça fait peur : le réflexe de 9 personnes sur 10 est de refermer bien vite la fente. Or, vouloir comprendre, c’est refermer la fente. Pour Artaud, l’œuvre d’art n’est pas faite pour être comprise.
Idéal moderne de l’Art : « l’art pour l’art » : gratuité de l’art : il ne sert à rien = il est sa propre fin. Il est autotélique.
- L’art est désintéressé par essence : il est par conséquent irréductible à un but précis aussi bien qu’à un effet précis.
Peut-être le but de l’art est-il de nous rendre plus humains, plus libres, plus « nous-mêmes ». L’effet qu’a sur nous un « chef d’œuvre », c’est de nous donner envie de vivre mieux, plus intensément : peut-on réduire cela à un « enseignement » ? Il y a quelque chose de très étroit, de très réducteur, dans le schéma : « enseignant/enseigné/message ». Ne dépasse-t-on pas alors un prétendu « plaisir de comprendre » vers un « plaisir de ne pas comprendre ». N’est-ce pas ce plaisir-là que l’art peut nous apprendre ?
Kant prétend que, dans la connaissance, l’imagination est au service de l’entendement alors que dans l’art, au contraire, l’entendement est au service de l’imagination.
En 1962, l’écrivain Umberto Eco publie L’Oeuvre ouverte. Il y développe la thèse que l’œuvre d’art est un message fondamentalement ambigu (1 signifiant/ une multitude de signifiés). Il y a donc une collaboration nécessaire à l’œuvre : des interprète(s) (musique, danse) + de l’amateur (littérature, peinture)
Aussi la contemplation esthétique dépasse-t-elle toujours de beaucoup la « leçon à en tirer ». Une idée (intellectuelle) est toujours plus univoque (c’est-à-dire plus pauvre) qu’une œuvre d’art. De plus, l’art (surtout contemporain) vise à abolir toute idée de hiérarchie entre le créateur et l’amateur, rendant sans pertinence l’idée d’un enseignement. Mais on peut dire que la rencontre de l’art est une expérience fondamentale.
L’art nous touche parce que, comme le dit Térence : « Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m’est étranger ».
Alain, dans Propos sur les pouvoirs, à propos des grands artistes : « Je leur sais gré de leur être. Et, par ce chemin, j’essaie de savoir gré à tout homme de son propre être ».
A l’exposition Dada de 1920, André Breton se présenta en Homme-cible, arborant une « peinture » de Francis Picabia avec ce texte :

De manière assez semblable, à un critique qui lui reprochait de faire des œuvres incompréhensibles, Picasso répondit : « Aimez-vous le chant des oiseaux ? Le comprenez-vous ? ». Jouir ne passe pas forcément par comprendre.
IV La théorie kantienne de l’art
A) Le beau est l’objet d’une satisfaction désintéressée (Kant Critique de la faculté de juger. « Analytique du beau »)
Prenons un arbre, je peux m’y intéresser de différentes manières: en charpentier (combien de planches? pour quel usage?)
en ornithologue (quels oiseaux viennent y nicher?)
en peintre (définition par défaut) : l’arbre n’a aucune utilité pour moi : je ne me demande pas ce que je vais faire de l’arbre.
Prenons un cheval. Qu’est-ce que le regard désintéressé sur ce cheval ? Ni celui de l’acheteur ni celui du parieur.
N.B : Distinguons ici point de vue des créateurs et point de vue des amateurs :
Point de vue des créateurs : Le créateur a une intention esthétique: ni l’intention de transmettre un concept (leçon de tolérance cf. Le Destin de Y.Chahine), ni l’intention de remplir une fonction (cafetière design).
Cependant, la plupart des œuvres relèvent aussi d’une fonction ou d’une autre (ex: les petits billets de Mallarmé pour ses rendez-vous, les portraits avant la photographie…)
La ligne de démarcation entre objets pratiques et objets artistiques dépend de l’intention des créateurs.
Point de vue des amateurs : spécificité du jugement esthétique (= jugement de goût)
Percevoir esthétiquement, c’est s’abandonner simplement et tout entier à l’objet de sa perception : sans visée, sans intention (moi non plus, je ne me demande pas ce que je vais faire de l’œuvre) : contemplation.
On est tout entier dans l’aisthésis = la sensation
Remarque : c’est aussi le cas dans un bain moussant ! : lien entre le corps et l’intellect
C’est Kant qui soutient cette thèse: l’art est désintéressé par essence.
Ce qu’il veut dire, c’est que l’œuvre me délivre du désir sensible. La satisfaction désintéressée, cela veut dire que les relations de l’homme à l’œuvre ne sont pas de l’ordre du désir.
Pour formuler un jugement de goût, il faut n’avoir aucun intérêt pour l’existence de la chose, mais seulement pour sa représentation. L’être de la chose ≠ son apparence
Etude du texte du « beau palais » (CFJ. Analytique du beau) Roussel p 53 (5)
Le beau suscite une satisfaction dégagée de tout intérêt.
OR, le « jugement de goût » :
- ne détermine pas une connaissance (l’œuvre n’est pas prise comme document) / regard historique sur une œuvre : aller regarder un tableau de Bruegel Le Vieux pour voir comment les hommes du Moyen-âge étaient habillés. Valeur de témoignage. Non plaisir esthétique mais recherche d’une connaissance). L’iconographie : on se SERT d’un tableau, mais on est très éloigné du « jugement de goût »
- ne suscite pas une action / si je suis maladivement gourmande et qu’à la question : qu’y a-t-il de beau à Paris, je réponde : les vitrines des pâtisseries, je n’ai pas pris le beau dans un sens esthétique /même l’art engagé n’est pas fait pour que je coure chercher ma carte du parti
- ne suscite pas un désir de l’objet représenté / crûment : les statues de femmes nues ne sont pas faites pour faire bander les passants (sinon : rapport pathologique à l’art) : pathologie car je ramène l’image à mon corps alors que (pour Kant), l’art ne s’adresse pas au corps mais à l’esprit (par l’intermédiaire du corps).
Une satisfaction intéressée = une satisfaction qui coïncide avec le plaisir sensible : regarder « l’Olympia » de Manet avec un regard concupiscent : voir, dans le tableau de Manet non pas un nu de la peinture mais une « femme à poil »)…le mateur aurait alors remplacé l’amateur.
Pour Kant, un jugement sur la beauté où se mêle le plus léger intérêt est partial (= n’est pas un jugement de goût). Le mari n’est pas le mieux placé pour juger le portrait de sa femme (la ressemblance, oui / la valeur esthétique, non).
L’antithèse nous est fournie par Voltaire :
« Le beau pour le crapaud, c’est sa crapaude »
Relativisation brutale : le beau est toujours intéressé : bien sûr qu’il ne s’agit pas de faire l’amour avec des statues mais si la Femme n’était pas objet de désir pour l’Homme, elle ne serait pas non plus l’incarnation privilégiée du beau !
Il se trouve qu’une écrasante majorité des peintres sont des hommes / il se trouve que les trois quarts des « sujets » représentés sont des femmes : ce n’est sans doute pas l’effet du hasard !
Seul son puritanisme empêche Kant de voir que le plaisir esthétique s’origine dans le plaisir érotique.
Une des tendances humaines : l’éphèbisme (le beau naturel, la beauté du modèle : ce qu’il y a de plus propre à être représenté)
Une des expériences les plus fondamentales de la beauté : cette cérémonie où la femme belle et l’homme beau se présentent aux yeux de tous, avec tout l’éclat de leur jeunesse, leurs ornements, bijoux, tatouages.
L’expérience artistique est expliquée par les théoriciens indiens à l’aide de la notion de « rasa » :
Le rasa est un état subjectif (du lecteur, spectateur, auditeur) par lequel les émotions dormantes qu’il est en état d’éprouver sont réveillées au contact de l’œuvre d’art et lui donnent alors l’impression d’un plaisir, d’une volupté.
Revenons néanmoins chez Kant :
Désintéressé = sans aucun rapport avec la faculté de désirer + sans aucun rapport avec l’existence de l’objet.
Le jugement de goût est contemplatif (désintéressé) c’est-à-dire qu’il n’est pas lié à la faculté de désirer.
On trouve la même idée chez Hegel: Consommation = destruction
Contemplation = Liberté laissée à l’objet (respect)
Texte de Victor Basch (6)
RQ : Il ne peut jamais vraiment y avoir appropriation de l’objet d’art (exemple de « L’Origine du monde » de Courbet, possédé par un psychanalyste célèbre –Lacan- exposé dans un petit boudoir capitonné, recouvert par un autre tableau, une fois Lacan mort, le tableau (re)devient disponible pour tous) : conséquence de ceci : l’acheteur n’a pas tous les droits sur son œuvre (pas celui de la détruire)
N.B : Désintéressé ne veut pas dire inessentiel : l’art ne sert à rien mais il est essentiel : il répond à un besoin fondamental. Il y aurait un « besoin d’art » inhérent à l’humanité :
Objets artistiques découverts par les paléontologues, grotte de Lascaux.
Chaque tribu primitive valorise certains instruments utilitaires en les décorant à outrance (bêches qui servent dans les rizières ; chasse-mouches…)
Hypothèse : le superflu, l’inutile, nous serait essentiel ( ?)
Ernst Dwinger Journal de Sibérie (cité par Camus dans l’Homme révolté) : lieutenant allemand, prisonnier pendant des années dans un camp où règnent le froid et la faim : s’est construit, avec de petits morceaux de bois, un piano silencieux où il joue tous les jours une musique qu’il est seul à entendre.
Deuxième exemple littéraire : William Styron est l’auteur d’un livre sur la dépression : Face aux ténèbres. Le protagoniste, au moment de se suicider, est sauvé par la « Rhapsodie pour contralto » de Brahms, qu’il entend par hasard au moment de passer à l’acte.
B) Le beau est ce qui plaît universellement sans concept
Remarque préalable : Kant admet que l’Art = le Beau (on est au XVIIIème)
Jusque là, il est admis qu’il y a deux sortes de jugements :
- les jugements objectifs et donc universels (jugements de connaissance, jugement logiques)
- les jugements subjectifs et donc particuliers (« je trouve beau l’orangé de ton écharpe »)
Kant voudrait faire admettre ici un troisième genre de jugements : subjectifs mais universels.
Le jugement de goût est bien subjectif : je dis que je ressens un plaisir à regarder ce tableau ; je ne dis pas que la porte est fermée (constat objectif = indiscutable)
Ce que prétend Kant, c’est que quand je dis « c’est beau » devant un tableau, il y a une espèce de nécessité de quiconque le regarde à le trouver beau. Cette « nécessité » n’est pas un constat (même la Joconde ne fait pas l’unanimité) mais un postulat.
Le beau est universel en droit (en théorie) mais non pas en fait (distinction quelquefois utile dans les dissertations)
« universellement » : la Raison = l’universel ≠ nos intérêts sont particuliers.
A partir du moment où ma satisfaction est désintéressée, elle ne repose pas sur un penchant qui m’est propre : elle n’est pas purement subjective : elle peut donc être universelle : je postule que chacun doit pouvoir éprouver comme moi une telle satisfaction (l’intérêt est ce qui particularise cf Descartes et les filles qui louchent)
Prétention exorbitante du jugement de goût à s’arroger une validité universelle et nécessaire : le plaisir esthétique est jugé nécessairement et universellement partageable dès lors que l’objet est déclaré beau.
N’étant lié à aucune inclination personnelle singulière, le plaisir esthétique est nécessairement celui de tout un chacun. La satisfaction étant basée sur quelque chose qui ne lui appartient pas en propre mais peut être supposée en tous, le sujet qui juge fait comme si la beauté était une qualité de l’objet, et comme si son jugement était de nature logique.
(le caractère interchangeable des sujets qui trouvent « beau »)
« sans concept » : absence d’une définition abstraite du beau qui vaudrait pour tous (on ne peut pas dire : « c’est quand le tableau est équilibré qu’il est beau » ni « quand les couleurs respectent une harmonie » : le beau n’est pas une qualité de l’objet en lui-même (pas de substantialisme).
Cette universalité n’a pas son fondement dans les objets eux-mêmes ; elle ne peut être fondée que subjectivement
Dans quoi alors ? Dans le sujet qui perçoit : universalité subjective
Distinguons la discussion (conflit d’opinions sans issue) de la dispute (conflit de pensées où la preuve est possible) : pour tout un chacun, l’art ne peut donner lieu qu’à discussions / d’après Kant, on peut en disputer.
En fait, je voudrais me servir de Kant pour me permettre d’être un peu intolérant(e) en matière de goût : ne pas trop vite me débarrasser d’autrui en disant « les goûts et les couleurs… ». Quand vraiment je suis convaincu(e) d’être devant un chef d’œuvre (le Stabat Mater de Pergolese) et que je me trouve confronté(e) à quelqu’un qui ne l’apprécie pas, j’oscille entre le rejet (c’est un abruti !) ou la condescendance (le pauvre ! il n’a pas appris à aimer cette musique-là !).
C) Le beau n’est pas l’agréable
QU’EST-CE QUE LA BEAUTE ?
L’expérience de la beauté est celle d’une perception qui est accompagnée de plaisir.
O.K : mais quand je mange aussi.
Alors ?!
La différence entre le plaisir esthétique et un autre type de plaisir (alimentaire ou sexuel), c’est qu’il n’est pas connecté à l’idée de consommation (qu’elle soit réelle ou, dans le désir, anticipée). Le plaisir esthétique n’est pas aussi spécialisé (relié à un organe: appareil digestif, sexe); il ne débouche pas sur la satiété (à la fois maximum et incapacité à jouir davantage). Moins déterminé, il est moins limité.
Parce que les organes de la perception ne sont pas ceux de la jouissance (c’est seulement métaphoriquement qu’on parle de « plaisir de l’œil, de l’oreille »), il faut postuler dans l’expérience esthétique une activité intellectuelle, qui elle-même ramène à la perception de l’objet. La sphère du corporel et celle du spirituel sont ainsi liées.
(On pense ici à Hegel : l’art est un pont entre l’âme et le corps, l’Homme et le monde, l’intérieur et l’extérieur)
De plus, le jugement esthétique est quelque chose de bien spécifique: on ne juge pas une chose belle de la même façon qu’on la juge colorée ou non, petite ou grande; de même, ce n’est pas le même sentiment qu’on éprouve quand on juge beau et quand on juge agréable.
Le jugement de goût est subjectif (il ne se rapporte pas à l’objet mais au plaisir éprouvé par le sujet); mais il n’est pas pour autant relatif (aléatoire : laissé à la libre appréciation de chacun, à la particularité des goûts)
« C’est beau ! » / « C’est agréable ! »= cela m’est agréable
accord (potentiel) de tous / « A chacun ses goût et ses dégoûts ! »
« les goûts et les couleurs ne se discutent pas »
je trouve beau ; relativité du goût individuel : rapporté
à mon habitude : canapés fermes ou moelleux….) : jugement qui n’engage que moi (relativisme)
Dans l’ « agréable », je suis affecté par l’objet : je suis intéressé par son existence : toutefois, l’agréable est un sentiment, pas une sensation : il n’est pas question d’une perception objective des sens (l’odeur de la rose : « snif ») mais d’un effet subjectif (le bien-être que cette odeur provoque : « humm !») : il ne s’agit pas d’un jugement qui dit ce que sont les choses mais d’une approbation de l’objet par le moi.
Cependant, le sentiment jugé suppose une sensation. Dans la satisfaction « agréable » ; je me dis affecté(e) par un objet c’est-à-dire concerné(e) par l’existence de cet objet (= intérêt)
Kant opère une dissociation entre l’agréable et le beau et par là, entre l’expérience esthétique et l’expérience personnelle.
AUTRUI
Introduction : MOI ET L’AUTRE : qui appelle-t-on « autrui » ?
Ce que les philosophes appellent ainsi, c’est tout humain autre que moi (nom singulier).
Ce faux singulier me place tout de suite sur le lieu d’un problème : c’est comme si Moi et Autrui pesaient la même chose dans la balance (façon : Paris/ province) : le Moi ne partage pas sa position hégémonique.
On part cependant d’un constat : l’homme n’est pas fait pour vivre seul (résonnances bibliques : Genèse : « Faisons-lui donc une compagne à son image »).
Restons sur cette proposition de la Femme comme 1er « Autrui » : qu’en dites-vous ?
- le référent indétrônable, c’est l’Homme : pas d’égalité entre ego = vir et alter = femina. En théorie, réversibilité des positions Homme/Femme ; en pratique, hégémonie du masculin cf : neutre = masculin)
- en tant qu’ « autre » de l’Homme, on peut dire deux vérités diamétralement opposées de la femme : elle lui ressemble (même espèce, pas un animal différent) / elle en diffère. En cela, elle est bien représentative de la double structure qui caractérise autrui : LE MEME ET L’AUTRE.
Marx Œuvres complètes : « Le rapport immédiat, naturel, nécessaire, de l’homme à l’homme est le rapport de l’homme à la femme »
(ne pas oublier la moitié de l’humanité)+(la non-mixité est un artifice= toujours non naturel et parfois déplaisant)
I. CONNAITRE AUTRUI
- Tension entre altérité et ressemblance (le Même et l’Autre)
Autrui est toujours à la fois, mon semblable (un autre moi) et quelqu’un de différent de moi (un autre que moi)
Autre moi : mon prochain, mon congénère, mon comparse, mon collègue, mon coreligionnaire, mon contemporain, mon concitoyen, mon consort (condition humaine), « Bro ».
Importance sociale des mythes qui nous donnent un ascendant commun (Adam) // dans les sociétés laïques, importance de l’histoire qui assure la cohésion du groupe.
(N.B : peu importe que l’identité commune relève de la croyance ; les peuples ont besoin de mythes fondateurs : les sociétés qui s’en passent sont atomisées.)
Autre que moi : la qualité principale de l’autre, c’est son altérité, que rien ne peut combler. C’est ce que Merleau-Ponty appelle la « transcendance d’autrui » (cf Fabius parlant de Mitterand : « lui, c’est lui et moi, c’est moi »). Une distance que même l’amour le plus fou ne peut combler.
Difficulté à penser l’autre : le penser comme ni autre que moi, ni identique à moi. Equilibre instable entre les deux : c’est l’idée exprimée par l’expression latine :
mon alter ego : dans ALTER EGO sont maintenues les deux dimensions :
la proximité + la distance / la familiarité + l’étrangeté
Emile Durkheim distingue deux sortes de solidarités : celle qu’il appelle la solidarité mécanique : on est solidaire entre personnes qui se perçoivent comme semblables (ex : manif de profs). A côté de cela, existe la solidarité organique : on peut être solidaire de personnes différentes de soi (manif en faveur des Kurdes).
2. Peut-on connaitre autrui ?
Double sens du « peut-on ? » :
- possibilité réelle (« est-il possible de… ? » débouche sur un problème de méthode)
- possibilité morale (« a-t-on le droit de… ? » débouche sur un problème de légitimité)
Commençons par le problème de méthode : Les pensées d’autrui, sa conscience, me sont impénétrables ; dès lors, comment faire pour connaître autrui ?
Je suis tenté(e) de plaquer sur autrui ce que je sais de moi : méthode par analogie.
On fait l’hypothèse de la similitude d’autrui (on procède par sym/pathie, on com/patit) mais souffrir-avec n’est jamais souffrir-comme + on ne peut jamais être sûr que cette hypothèse est bien-fondée.
Etymologie : Empathie, du grec « en/pathos » = dedans/ce que l’on ressent
Sympathie, de « sum/patheia »= ensemble/ce que l’on ressent
Empathie : faculté intuitive permettant de comprendre autrui en se mettant à sa place (syndrôme de Stockholm : empathie que les otages ressentent à l’égard de leurs ravisseurs)
Sympathie : proximité affective basée sur des affinités
Texte de Merleau-Ponty : « Je perçois autrui comme comportement… » (KH L, Hatier, p 84) : (18) (13) Les limites de l’empathie.
Je perçois autrui comme comportement; par exemple je perçois le deuil ou la colère d’autrui dans sa conduite, sur son visage et sur ses mains, sans aucun emprunt à une expérience « interne » de la souffrance ou de la colère et parce que deuil et colère sont des variations de l’être au monde, indivises entre le corps et la conscience, et qui se posent aussi bien sur la conduite d’autrui, visible dans son corps phénoménal, que sur ma propre conduite telle qu’elle s’offre à moi. Mais enfin le comportement d’autrui et même les paroles d’autrui ne sont pas autrui. Le deuil d’autrui et sa colère n’ont jamais exactement le même sens pour lui et pour moi. Pour lui, ce sont des situations vécues, pour moi ce sont des situations apprésentées. Ou si je peux, par un mouvement d’amitié, participer à ce deuil et à cette colère, ils restent le deuil et la colère de mon ami Paul: Paul souffre parce qu’il a perdu sa femme ou il est en colère parce qu’on lui a volé sa montre, je souffre parce que Paul a de la peine, je suis en colère parce qu’il est en colère, les situations ne sont pas superposables. Et si enfin nous faisons quelque projet en commun, ce projet commun n’est pas un seul projet, et il ne s’offre pas sous les mêmes aspects pour moi et pour Paul, nous n’y tenons pas autant l’un que l’autre, ni en tout cas de la même façon, du seul fait que Paul est Paul et que je suis moi. Nos consciences ont beau, à travers nos situations propres, construire une situation commune dans laquelle elles communiquent, c’est du fond de sa subjectivité que chacun projette ce monde « unique ».
- Merleau-Ponty, La Phénoménologie de la perception (1945), Éd. Gallimard, p. 40
Passons au problème moral : connaître autrui est une entreprise contestable car toute connaissance se fonde sur l’opposition d’un sujet (moi, évidemment) et d’un objet (l’autre, qui est à connaître).
Là, il y a encore une fois un problème de méthode (l’autre n’est pas stable ni prévisible comme un objet : il est libre).
Et surtout un problème moral : sa réification. Connaître l’autre, cela revient à figer sa liberté ; à réduire à néant (à une) ses possibilités. Ainsi, la connaissance de l’autre recèle une violence exercée sur l’autre.
Etymologie de comprendre : com/prendere : prendre avec soi, englober : connaître, c’est toujours un peu posséder OR on ne peut jamais posséder une personne.
Illustration par celui des Contes d’Hoffman (opéra comique en cinq actes, d’Offenbach) qui s’appelle « Maître Puce » : Pérégrinus a reçu un minuscule verre grossissant qui, placé sur la pupille, permet de lire dans les pensées d’autrui. Mais quand Rosette, jeune fille dont il est tombé amoureux, lui avoue sa flamme, il résiste à la tentation d’utiliser sa lentille magique. S’il l’avait utilisée, Rosette aurait été réifiée…sans doute aurait-il été désormais impossible à Pérégrinus de l’aimer (une VRAIE personne = quelqu’un de mystérieux pour moi).
Les rapports humains (a fortiori amoureux) sont des rapports qui impliquent que l’autre soit sujet. Mettre la lentille, c’est comme « manger le fruit défendu ».
Griffin, le héros du livre de H.G Wells : L’Homme invisible, s’aperçoit que l’invisibilité n’est bonne que pour deux choses : 1) la fuite ; 2) l’attaque (tuer) ….pas le plaisir. La jouissance suppose la présence avec l’autre.
L’homme invisible = celui qui regarde sans être regardé ; celui qui regarde les autres comme s’ils étaient des objets. Or, transformer les autres en « non-semblables », en objets, rend possible de les tuer ( cf O.Rey p 65)
Au fond, il y a deux façons de méconnaitre autrui : on peut nier qu’il soit différent ou nier qu’il soit semblable, ce qui, au fond, revient au même (cf KH L p 79). J’explique.
- nier qu’autrui est différent, c’est le rabattre sur moi. Faire comme s’il était en tous points semblable à moi. Cela débouche sur le fait que je ne l’écoute pas (que pourrait-il m’apprendre ?) : je m’enferme dans un monologue satisfait.
Montaigne : « Qui se connaît, connaît aussi les autres car chaque homme porte en lui la forme entière de l’humaine condition »
- Antidote : la leçon que nous donne Merleau-Ponty : malgré les ponts tissés par la sympathie, « lui, c’est lui et moi, c’est moi ». C’est la transcendance d’autrui: il est irréductible à moi (la fusion est impossible même dans l’amour le plus fou).
- Nier qu’autrui me soit semblable, c’est nier son humanité : le rejeter dans la barbarie (il n’y a rien de commun entre lui et moi). Les conséquences extrêmes en sont : le mépris ; le meurtre.
Qu’est-ce que cela vous évoque ? Xénophobie, racisme, sexisme.
Cf : les débats théologiques du Moyen-Age : Les femmes ont-elles une âme ? Sexualité = zoophilie ?
Le point commun entre ces deux attitudes, c’est la domination, et donc le risque de la violence (violence douce de qui ne veut pas m’écouter – meurtre symbolique – violence maximale de la mise à mort)
Texte de Lévi-Strauss : Hatier texte 8 p 68 : Race et Histoire p 19 à 22
(NB : Cuzco, capitale des Aztèques – actuelle ville du Pérou – dont le nom signifie : « le nombril de l’Univers »)
Montaigne : « Chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage »
ETHNOCENTRISME : tendance à prendre sa propre ethnie pour une norme absolue et à projeter ses propres valeurs sur des cultures différentes de la mienne (les mécomprendre, les dénigrer)
Dans la mesure où toute tentative de connaissance d’autrui contient le risque de la violence, il faut abandonner le projet de connaître autrui : passage de la connaissance à la reconnaissance.
Reconnaître autrui, c’est admettre que je ne suis pas le seul sujet, qu’il existe une pluralité des consciences ; notion d’égalité (= équivalence en dignité, pas de dissymétrie)
Valeur (morale, politique) basée sur l’acceptation d’une équivalence en dignité entre autrui et moi.
« C’est au cœur de la conscience singulière que se découvre pour Hegel un rapport nécessaire à d’autres consciences singulières. Le Je pense n’est possible que si, en même temps que dans ma pensée, je suis en rapport avec d’autres pensées. Chaque conscience singulière est en même temps pour soi et pour autrui. Elle ne peut être pour soi que dans la mesure où elle est pour autrui. Chacune exige la reconnaissance par l’autre pour être elle-même, mais elle doit aussi reconnaître l’autre, parce que la reconnaissance par l’autre ne vaut que si l’autre est lui- même reconnu. C’est là que réside le dépassement de l’immédiat (pour Hegel, toute pensée est une pensée entre consciences; elle est immédiate quand elle ignore cette relation entre consciences; l’immédiat, c’est le cogito tout seul). »
Lévinas (Dieu, la Mort et le Temps), Hatier p 67 : (19)
(Je croise autrui, non pas seulement dans le face-à-face de la rencontre mais au cœur de ma subjectivité / notion de réciprocité / « Nous sommes, DONC je pense » / deux modalités de la conscience : pour-soi ET pour-autrui)
- II. SE CONNAITRE GRACE A AUTRUI
- A. La personne et le personnage
(préparation : personne /personnage /personnalité)
C’est une idée à la fois très banale et complètement paradoxale : en effet, autrui est par excellence celui devant lequel je porte un masque (le « persona », qui fait de moi un personnage). En même temps, il semble évident que j’ai besoin d’autrui
1) pour me construire comme humain
2) pour me connaître comme individu
Un petit mot sur la notion de personnage : c’est l’aspect social de l’individu : sa fonction, son statut, son « pour-autrui »
Risque constant d’une contamination de la personne par le personnage :
Jacques Lacan : « (…) si un homme qui se croit un roi est un fou, un roi qui se croit un roi ne l’est pas moins »
Montaigne : « la peau et la chemise » : (20) (13 ou 14)
« L’habit ne fait pas le moine »/ « Le roi est nu sous son costume d’apparat » : perspective d’une égalité de tous les hommes : même nudité, même mortalité : humanité
cf la phrase de Montaigne : « Sur le plus beau trône du monde, on n’est jamais assis que sur son cul ».
Equilibre à maintenir :
- il faut « se donner » à ce qu’on fait, adhérer au rôle pour bien le tenir sinon opportunisme, cynisme
- il ne faut pas « s’y croire »
Jusqu’où faut-il s’impliquer dans nos rôles ? Quelle est la bonne distance de la personne au rôle ?
Remarque : La morgue des importants = une sorte d’oubli de soi (paradoxal car enflure du soi)
Ici, soi= ce qui est pareil à tous (et non pas exaltation de la différence individuelle)
Horizon commun à tous les hommes : n’avoir qu’une peau + mourir bientôt = condition humaine (c’est ce qui fait des autres nos alter ego) : nudité 1ère, modestie, humilité / « pour qui il se prend » : de quelqu’un qui oublie la part de boue, la part d’excrément qu’il y a en lui. Misère de la condition humaine : « Inter faeces et urinam nascimur » (nous naissons entre l’urine et les excréments, Porphyre de Tyr, philosophe…dépressif)
Les « importants » sont à plaindre : ils se laissent plus facilement piéger par leur rôle. Même s’ils semblent y trouver leur compte, ils sont victimes de la société qui leur a donné leur rôle : d’un point de vue humain, ils sont perdants. Ainsi, les « Grands » de ce monde courent plus le risque que d’autres de s’aliéner à leur personnage (parce que ce personnage est plus valorisant)
Aliénation de la personne au rôle (identification au rôle = perte de soi, plus de distance ; plus de transcendance). Oubli de soi au profit de l’image de soi.
Pb : Est-il si facile de distinguer la peau de la chemise ? Quand on s’investit, on « mouille sa chemise » et elle colle à la peau (transparence). La personne n’est pas laissée intacte par le rôle, le travailleur s’use au travail (mains, dos : les travaux physiques marquent les corps // les tâches intellectuelles impriment dans l’esprit des habitudes). Dans les deux cas, certaines de nos virtualités disparaissent à jamais. Richesse virtuelle de l’enfant : actualisation de certaines de ses capacités dans la vie adulte ; disparition des autres. Le travail fait et défait le travailleur. Dans le pire des cas, le travail tue l’humanité en l’homme (cf Chaplin : Les Temps modernes)
Conclusion : il y a une distance intérieure de soi au rôle qui est à conquérir, et à cultiver. Il faut maintenir une tension entre
* un complet désintérêt …et
* une implication fanatique
Il faut bien jouer son rôle mais toujours savoir qu’il s’agit seulement d’un rôle.
Marc Aurèle : « Le jugement d’un empereur doit être au-dessus de son empire et le considérer comme un accident étranger. Il doit savoir jouir de soi à part et se communiquer comme Jacques et Pierre – au moins à soi-même »
Vérité intérieure où je ne joue plus aucun rôle
« Il faut jouer dûment notre rôle, mais comme rôle d’un personnage emprunté » : il faut savoir distinguer la peau et la chemise : « Le maire et Montaigne ont toujours été deux, d’une séparation bien claire »
Dans la Rome antique, lors de la cérémonie du triomphe organisée dans les rues de Rome pour fêter un général victorieux, un serviteur – debout derrière le général – devait lui rappeler que, malgré son succès d’aujourd’hui, le lendemain était un autre jour. Le serviteur le faisait en répétant au général qu’il devait se souvenir qu’il était mortel, c’est-à-dire « Memento mori ».
Pour entrer dans la véritable connaissance de votre condition, considérez-la dans cette image.
Un homme est jeté par la tempête dans une île inconnue, dont les habitants étaient en peine de trouver leur roi, qui s’était perdu ; et, ayant beaucoup de ressemblance de corps et de visage avec ce roi, il est pris pour lui, et reconnu en cette qualité par tout ce peuple. D’abord il ne savait quel parti prendre ; mais il se résolut enfin de se prêter à sa bonne fortune. Il reçut tous les respects qu’on lui voulut rendre, et il se laissa traiter de roi.
Mais comme il ne pouvait oublier sa condition naturelle, il songeait, en même temps qu’il recevait ces respects, qu’il n’était pas ce roi que ce peuple cherchait, et que ce royaume ne lui appartenait pas. Ainsi il avait une double pensée : l’une par laquelle il agissait en roi, l’autre par laquelle il reconnaissait son état véritable, et que ce n’était que le hasard qui l’avait mis en place où il était. Il cachait cette dernière pensée et il découvrait l’autre. C’était par la première qu’il traitait avec le peuple, et par la dernière qu’il traitait avec soi-même.
Pascal (début du premier des Trois Discours sur la condition des Grands)
(Lire la suite sur : http://www.etudes-litteraires.com/pascal-trois-discours.php#ixzz1b7V4AQ4h) : grandeurs naturelles (mérite) / grandeurs d’établissement (convention)
Mais enfin ne nions pas ce rôle de la société dans la construction de soi :
L’Homme, privé d’autrui, ne devient pas humain : l’enfant sauvage (mensonge de Mowgli dans Le Livre de la jungle: on ne devient pas humain sans éducation // Tarzan). Ainsi, c’est l’éducation qui fait de nous des humains, bien plus que nos gènes.
Illustration ethnologique pour cette idée que c’est la socialisation qui humanise : la pratique du « bouchonnage » dans certaines sociétés africaines : massages qui donnent forme humaine.
En même temps, autrui est celui dont je me protège, devant qui je joue un rôle, à cause duquel je peux être tenté de tricher :
Cf Erwin Goffman (La mise en scène de la vie quotidienne): la vie sociale comme une mise en scène : la tricherie de l’apparaître.
Cependant, nous savons bien qu’autrui fait apparaître sur nous-mêmes une vérité essentielle
Mounier : « la personne n’existe que vers autrui, elle ne se reconnait que par autrui, elle ne se trouve qu’en autrui » : personne ≠ individu : pas d’autarcie possible
Vauvenargues (moraliste du XVIIIème siècle) : « Nous découvrons en nous-mêmes ce que les autres nous cachent, et nous connaissons dans les autres ce que nous nous cachons à nous-mêmes » (ex : fanfaronnade = fragilité)
Proverbe biblique : « il est plus facile de voir la paille qui est dans l’œil du voisin que la poutre qui est dans son œil » (ex : mesquinerie : celle des autres)
Et aussi, que si nous perdons le lien avec autrui, nous nous perdons nous-mêmes :
Quand on est un adulte humain, rien n’est définitivement acquis qu’on ne puisse perdre si l’on est soumis à une solitude radicale :
L’histoire de Robinson Crusoé
Le fait divers : en 1705, un marin écossais, Alexandre Selkirk, se fait déposer à sa demande sur une île minuscule au large du Chili (il y restera 5 ans) ; cela fait scandale
Les œuvres : en 1719, Daniel Defoe publie The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoé, of York, Mariner
Au XXième siècle, roman de Michel Tournier Vendredi ou les limbes du Pacifique : au début, Robinson pour ne pas sombrer dans la folie, fait tout comme s’il vivait encore en société : il s’autoproclame Gouverneur de l’île, il y construit des bâtiments pour l’élevage, un fort pour se défendre en cas d’attaque (sa lutte contre la folie ressemble déjà un peu à la folie…). Le dimanche, il célèbre la messe.
Quand il en vient à perdre jusqu’à la notion d’autrui, Robinson se déshumanise (il perd la notion du temps, reste des jours entiers dans « la souille », perd la faculté de sourire – la panique le prend quand il le constate). (N.B aussi l’isolement carcéral comme une punition très redoutée).
Pour finir, il est facile de constater que le sujet n’est que trop enclin à se faire des illusions sur son propre compte ; pour se connaitre soi-même, le détour par autrui est indispensable : il n’a pas nos raisons de nous voir autrement que nous sommes (exemple : je me prétends flûtiste virtuose ; il faut que ce talent soit reconnu par autrui pour que ce ne soit pas vaine prétention de l’ego). Le regard d’autrui confère à mes qualités une objectivité que je suis impuissant(e) à me donner tout seul.
Vérité scientifique : hypothèse = V.probable (propriété d’un gaz)àV.objective (universelle) : c’est une démonstration qui opère le passage
Vérité empirique (ex :psychologique), certitude subjective àV.objective (partagée) : c’est la reconnaissance qui opère le passage.
B. Sartre : « Autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même »
Déjà au niveau de l’accès à mon corps, autrui change quelque chose. Je connais mon corps, mais je le connais d’abord du dedans : le corps-pour-soi et non pas le corps-objet : quand je suis vu par autrui, il se passe quelque chose au niveau de mon corps (il devient simple objet vu) comme au niveau de ma conscience (je passe du mode du « pour-soi » au mode du « pour-autrui »)
Idem pour mes actes : tant que je suis seul, mon acte ne se détache pas de moi (= sujet agissant : ma liberté est à l’œuvre dans mes actes) / quand mon acte est vu par autrui, c’est comme si autrui « figeait ma liberté » : Je prends conscience de mon acte comme d’un objet posé devant moi.
Autrui juge mon acte comme il l’entend ; je n’ai aucun pouvoir sur l’interprétation qu’il fait de mon acte. Je suis le spectacle ; il est le spectateur. L’intelligence du spectacle appartient au spectateur.
De plus, l’acte est posé pour l’éternité (irréversible : je ne pourrai jamais faire que ce geste n’ait pas eu lieu). Les choses sont posées une fois pour toutes parce qu’il y a autrui : entre moi et moi-même, rien n’est « solide », tout est toujours négociable : le réel existe parce qu’il y a autrui.
Texte de Sartre sur la honte (photocopie) : (21) (15)
Exemple de dépossession de moi-même par le regard d’autrui quand mon acte est répréhensible.
Tant que l’acte n’appartient qu’à moi-même, je m’arrange avec lui (Sartre ne croit pas à l’introspection qui ferait que je comparaitrais à mes propres yeux) : le « dédoublement réflexif », je l’effectue quand il m’arrange.
Quand j’ « apparais à autrui » * je ne choisis pas l’occasion
* mon acte prend tout à coup l’évidence d’une chose
* le moi tout entier devient chose vue = chose jugée
Thèse de Sartre : si autrui n’existait pas, si cette expérience-là n’était pas donnée, je ne pourrais jamais faire œuvre de réflexion. C’est parce qu’autrui existe que la réflexion est possible.
Regardons de plus près ce que dit le 2ème § :
Je suis, j’agis autrui porte un regard sur moi (cliché), il se fait de moi une certaine image agacement, colère (c’est réducteur)
Mais, dans la honte, il se passe autre chose : je reconnais que je suis cet objet qu’autrui voit. La honte est porteuse d’une reconnaissance implicite : je suis comme il me voit.
Dans l’idée de liberté, il y a l’idée de transcendance : je suis libre = je transcende mes actes : j’ai fait ceci ; j’aurais pu faire cela + aucun de mes actes ne me définit : c’est la totalité de mes actes qui me définit.
Dans la honte, plus de transcendance : j’ai fait cela, c’est irréversible.
Conclusion : ça fait mal. L’expérience est pénible // « l’enfer, c’est les autres » in Huis clos
Ça fait mal, mais ça fait du bien : pas d’exploration de soi (« connais-toi toi-même ») si autrui n’est pas donné.
Texte de Sartre sur le regard : (22) (16)
La rencontre d’autrui = la rencontre d’un autre sujet libre.
L’épreuve du regard = l’épreuve d’autrui comme sujet.
Le risque, c’est qu’autrui fige mes possibilités = fasse de moi un objet.
En même temps, il y a là un gain (cf « épreuve ») : c’est parce qu’autrui existe que je peux « concevoir mes propriétés sur le mode objectif ». Par exemple, c’est parce qu’autrui existe que je peux appliquer à mon corps les notions de l’anatomie : mon corps = mon point de vue sur le monde : je le sens toujours de l’intérieur (le corps-propre, corps-senti, corps-vécu = la chair de Merleau-Ponty) ≠ le corps comme objet de la science médicale).
L’être humain = une conscience = l’Homme existe sur le mode d’être du pour-soi.
Dès lors qu’il existe, autrui me fait violence : il me fait passer d’un certain mode d’être (le pour-soi) à un autre : le pour-autrui.
Illustration de la différence sartrienne entre pour-soi et pour-autrui : l’injure, l’injure sexuelle
« pour-soi » : j’aime Lise. J’aime sa peau, j’adore quand elle rit. J’aime sa façon de voir les gens : bref : je suis amoureuse de Lise
« pour-autrui » : j’entends qu’on crie dans mon dos : « sale gouine ! » : l’injure me fait passer brutalement du pour-soi (un choix sexuel privé, qui ne regarde que moi) au pour-autrui : l’injure dit, dans le mépris, mon appartenance à un groupe minoritaire (les femmes qui aiment les femmes).
Or, je peux aimer Lise sans me sentir solidaires des gays et des lesbiennes.
« P.D » : toute la personnalité est prise dans le faisceau de la sexualité ; comme si mes pratiques sexuelles étaient une identité (pour les hétéros, non). C’est l’exclusion qui pousse à passer de la pratique à l’identité revendiquée : appartenir à une communauté, cela aide quand on est en minorité.
La scène que Sartre se représente, c’est : le regard d’autrui pèse sur moi. Et, dans ce regard, j’éprouve son « infinie liberté » : il est libre de détourner le regard quand il veut, de penser de moi ce qu’il veut.
On est proche du texte du « Jardin public » (L’Etre et le Néant p 300) (23): il suffit qu’un autre soit là pour que je ne sois plus entièrement sujet ; pour que le décor ne soit plus entièrement pour-moi. Tant qu’il n’y a pas d’ « autre », tout ce qui m’entoure me regarde, converge vers moi, semble être fait pour moi : je jouis de tout dans l’oubli de moi-même / quand l’autre survient, j’ai conscience d’être « en représentation » ; je prends conscience de mon corps comme un objet du monde vu par autrui (avant, j’étais mon corps ; maintenant, j’ai un corps : dualisme réalisé)
Essayons de critiquer Sartre : est-ce que ce n’est par un peu triché ? Biaisé ? Est-ce que l’expérience du regard est toujours celle-là ?
Regard à sens unique, regard dominateur ≠ réciprocité du regard (tu me regardes/ je te regarde): regard amoureux
Texte de Merleau-Ponty p 505 Russ : au regard inhumain de Sartre est opposé le regard accompagné du geste et/ou de la parole : le regard comme le début d’un acte de communication avec autrui.
C. L’amour comme connaissance participante
L’amour comme seule voie d’accès satisfaisante à l’autre. En lui coïncident l’ouverture sur l’autre et l’accès à soi-même.
Saint-Exupéry : « l’essentiel est invisible pour les yeux ; on ne voit bien qu’avec le cœur »
Part importante des expériences amoureuses dans l’accès à soi-même : à l’adolescence, on reporte sur ses pairs une bonne partie de la libido que l’enfant avait investie sur ses parents (l’amour se détache de ses bases œdipiennes). On n’est pas véritablement adulte tant qu’on n’a pas connu d’une part une expérience positive, d’autre part, une déception amoureuse.
Dans l’amour, il se produit une sorte d’hémorragie du moi vers l’autre.
Donc, le sujet humain commence par s’aliéner dans l’amour qu’il porte à ses parents puis, à l’adolescence, il transpose sur des gens de son âge cette aliénation et enfin le jeune adulte s’aliène une 3ième fois dans une seule personne. Bizarrement, il faut passer par ces trois aliénations successives pour devenir autonome : il faut se perdre dans autrui pour se trouver soi-même.
(cf article de Didier Lauru, psychiatre et psychanalyste. Le Monde)
L’amour que j’éprouve pour autrui me sauve d’un excessif amour de moi-même : narcissisme (cf texte d’Ovide p129 in Russ) : à lire chez soi
Il y a néanmoins un cas où l’amour ne sauve pas : si, comme le narrateur de Proust, on aime un Autrui-objet (Albertine) qui n’est qu’un alibi pour s’aimer soi-même. Alors, l’amour se nourrit du narcissisme et le renforce. C’est aussi ce qui donne lieu à la jalousie : tout amour qui postule une prise de possession sur l’autre-objet.
Trois sortes d’Amour : Eros/ Philia / Agapè
Eros : amour d’autrui basé sur la notion de manque et qui inclut le désir sexuel (débouche sur la passion amoureuse)
Philia : être heureux du simple fait que l’autre existe.
Agapè : c’est l’amour prôné par le Christ. Complètement désintéressé, il s’étend à tout le genre humain.
D. Que devient le sujet dans un monde sans autrui ?
Pour étudier les effets de la privation d’autrui, prenons le livre de Michel Tournier : Robinson est absolument seul sur son île : il est l’homme sans autrui par excellence (N.B : la solitude absolue est un mythe littéraire ; notre solitude à nous est toujours peuplée de divers autrui : attente = autrui présent sur le mode de l’absence- média….)
Ce livre, on peut le voir comme un roman d’aventures : que va-t-il arriver au Sujet dans un monde sans autrui ? Sous l’effet de l’absence d’autrui, Robinson va changer progressivement, profondément. A partir des effets de la privation d’autrui, on va découvrir – a contrario – les effets d’autrui sur moi.
Lecture du texte de Tournier : (24)
- 1er effet d’autrui, il me donne le réel. En effet sans autrui, « je suis assailli de doutes sur la véracité du témoignage de mes sens » (lg 24). Sans autrui, tout vacille. Lui seul me sort du doute. Sans lui, comment distinguer perception vraie et illusion des sens ? Passage de l’opinion à la Vérité.
- 2ème effet d’autrui : il relativise le non-perçu, le non-su = il m’offre le possible (Deleuze : « Autrui comme structure, c’est l’expression d’un monde possible » // autant d’hommes, autant de « phares dans la nuit ». Pour Robinson, au-delà de ce qu’il connait, c’est la nuit noire, le néant dichotomie stricte du connu et de l’inconnu ≠ pour nous, il y a le connaissable (= ce qui n’est pas connu par nous mais dont nous savons qu’il l’est par d’autres)
ex : je crois aux microbes à la manière dont dans certaines tribus on croit à la magie mais ma croyance repose sur le connaissance effective d’une poignée de spécialistes.
- 3ème effet d’autrui : il fait la liaison entre les différents objets du monde qui m’entourent. Grâce à autrui, les objets font système (c’est la dimension de « monde» : les objets sont organisés en systèmes qui ont un sens. Grâce à autrui, il y a – autour de chaque objet que je perçois, autour de chaque idée que je pense – une sorte de monde marginal organisé, une sorte de « fond » dont les objets peuvent sortir) ; Pas : 1objet + 1objet + 1objet + …mais les objets forment un tout.
Autrui = celui qui est à tout moment susceptible de venir me déranger, me distraire : mettre tout d’un coup au centre de mon attention des objets jusque-là périphériques
- 4ème effet : autrui donne au monde épaisseur et relief : il enrichit mon monde d’une multitude de points de vue différents (métaphore des phares).
C’est cette dimension qu’Husserl appelle l’intersubjectivité : relation réciproque et constitutive des consciences comme sujets + accord possible sur un monde commun.
C’est grâce à autrui que le monde existe. C’est la seule possibilité d’une vérité qui dépasse la sphère privée de ma croyance (si seul existait mon point de vue, on serait toujours dans la représentation).
III . LE DEFI DE L’EGALITE
- Hegel : la « dialectique du maitre et de l’esclave » (Herrschaft und Knechtschaft) : la lutte pour la reconnaissance
Hegel : 1770-1831 ; Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé (cf « Démarches » chez Belin : commentaire de Charles Bourgeois p 150)
Phénoménologie de l’Esprit : livre pour lequel le sujet (celui de l’Histoire) est l’Esprit Absolu
Vision positive de l’Histoire : l’Esprit absolu se réalise toujours un peu plus dans chaque étape de l’Histoire (période, civilisation).
Etude de ces différentes étapes
- le sentiment animal de soi (conscience enfoncée dans l’être de la vie)
- la conscience de soi (réflexivité, indépendance)
- la Raison
Or, on ne peut pas passer du stade du sentiment animal de soi au stade de la conscience de soi sans l’intervention d’une autre conscience de soi (ce qui rappelle Sartre) : « la conscience de soi n’est qu’en tant qu’être reconnu »
Enjeu fondamental de la rencontre entre deux consciences de soi : la reconnaissance
Chose vivante Chose qui a la certitude
(Ce que je suis aux yeux de ® de la conscience de soi ® Vérité de la cs de soi
l’autre) (à mes yeux)
La reconnaissance, c’est le passage de la seule certitude (intérieure, subjective) de soi comme conscience de soi ; à la vérité de la conscience de soi.
Chaque conscience de soi se sait absolue (en tant qu’homme, je sais que je suis une fin en soi) mais, avant cette lutte, elle ne l’est pas pour l’autre : pour l’autre, je suis d’abord une chose vivante, pas une conscience de soi.
Etre une chose (moyen) ð être une fin en soi
Pour se montrer à l’autre comme elle se sait être (un Absolu, une Fin en soi), la conscience de soi doit risquer sa vie (= se nier comme chose seulement vivante)
L’être-pour-soi, en montrant qu’il est au-dessus de la vie, se présente à l’autre comme il est pour soi.
Sens du risque mortel : se montrer comme pure négation de sa manière d’être objective : montrer qu’on n’est attaché à aucun être-là déterminé : montrer qu’on n’est pas attaché à la vie.
Pb : en perdant la vie, je perds aussi cette conscience de soi si précieuse pour laquelle je me bats : dans cette expérience, la conscience de soi apprend que la vie lui est aussi essentielle que la pure conscience de soi. Celle des deux qui comprend cela recule devant le risque de la mort : elle abdique.
Cette lutte débouche sur une inégalité : un gagnant (celui qui est reconnu) et un perdant (celui qui reconnait l’autre sans en être reconnu)
En conclusion :
1) Je ne me connais qu’en reconnaissant l’autre : tant que je ne suis qu’en présence de choses, ces choses sont soit des obstacles soit des moyens / c’est tout à fait autre chose quand je suis en présence de quelqu’un (une personne, douée d’intention) : face à elle, je prends conscience de moi-même comme doué d’intentions.
2) Cette reconnaissance ne s’effectue que sous la forme du défi ou du combat (penser à l’importance des défis dans les groupes d’adolescents) : c’est seulement dans l’action que l’autre m’est donné : dans une foule, les autres sont neutres = ils sont à peine des autres = c’est comme s’ils n’existaient pas : c’est quand la volonté de l’autre contrarie la mienne que je prends réellement conscience de lui.
3) Il y a violence, mais non pas mise à mort : la suppression physique de l’autre serait une mauvaise solution : elle renverrait le sujet à la solitude…et donc à l’inexistence.
4) Importance extrême du désir d’être reconnu par l’autre (le besoin porte sur la survie ; le désir est fondamentalement désir de reconnaissance : il forme la trame de la vie en commun des hommes) ; c’est pourquoi la violence est omniprésente dans les sociétés humaines.
B. Le déni d’égalité
1) L’esclave
Texte d’Aristote Les Politiques, livre I, chapitres 4 et 5 (Hatier p 443) / (25)
Pour « réhabiliter » Aristote, cette phrase des Politiques (I, 4,1253b) (26): « si les navettes tissaient d’elles-mêmes et les plectres jouaient tout seuls de la cithare, alors les ingénieurs n’auraient pas besoin d’exécutants ni les maîtres d’esclaves »
Antithèse fournie par Rousseau (Contrat social): Hatier p 444 : « Aristote avait raison mais il prenait l’effet pour la cause : tout homme né dans l’esclavage naît pour l’esclavage, rien n’est plus certain. Les esclaves perdent tout dans leurs fers, jusqu’au désir d’en sortir ».
T.L : Texte de Jacques Bouveresse La Parole malheureuse : Roussel (Nathan édition 2001) : (27)
Bouveresse parle du rapport entre les membres d’une certaine tribu et leurs esclaves :
2) la Controverse de Valladolid
Evénement datant de 1550 / film de Jean-Claude Carrière (1992)
Nous sommes au XVIème siècle, en train de gérer les suites de la conquête de l’Amérique par Christophe Colomb : les deux protagonistes de la controverse sont Bartolomeo de las Casas, missionnaire dominicain, évêque du Chiapas, démis par les colons, auteur d’une Très brève relation de la destruction des Indes (Jean-Pierre Marielle dans le film de Jean-Claude Carrière) / le philosophe Sépulveda, auteur du Democrates alter, dont il est question d’autoriser ou non la publication.
Un arbitre éminent : le Cardinal Roncieri, légat du Pape (Jean Carmet dans le film)
- Les femmes sont-elles les égales des hommes ?
Source : Youtube, vidéo d’Eléonore Pourriat : « Majorité opprimée »
Concept de différence et concept d’égalité : sommes nous capables de ne pas traduire toute différence en termes d’inégalité ?
- Qu’est-ce que le racisme ?
Texte de Todorov : Racisme et racialisme (28)
Cas de « La Vénus hottentote » : Dans les années 1810, à Londres et à Paris, fut exhibée dans des foires la Sud-africaine Sawtche, femme du peuple khoïkhoïe, baptisé « hottentot » par les Afrikaners, rebaptisée Saartjie Baartman. C’est de son personnage que s’inspire Abdellatif Kechiche dans son film Vénus noire (sorti en 2010).
Deux faits du XIXème siècle : la tradition d’exhibition des « monstres » dans les foires (montré aussi dans le film Elephant man , David Lynch , 1980). De plus, entre 1800 et 1950, c’est la grande période des « zoos humains » (L’exposition universelle de 1900 contient un bon nombre de « villages cannibales »).
Après sa mort, le corps de Saartjie Baartman est annexé par la science, et spécialement l’anatomiste Georges Cuvier, dans la perspective d’établir une hiérarchie des races.
Cuvier cherchait un « chainon manquant » entre le singe et l’homme. Il prétend le trouver chez Saartjie : obsédé par son soi-disant prognathisme + sa callypigie + trouvant insuffisamment de circonvolutions dans son cerveau. Il effectuera des moulages du corps de cette femme, il gardera en bocal son utérus, son cerveau…ce qui nous permet d’établir la fausse analyse qu’il fait de celui-ci, absolument normal. Ces bocaux seront entreposés au Museum d’Histoire Naturelle, et ne seront restitués à l’Afrique du Sud qu’en 2002.
N.B : à l’époque, les thèses racistes servaient à justifier le colonialisme.
Un des aspects intéressants du film, c’est le côté oppresseur du regard, celui des spectateurs sur son corps quand, vingt fois par jour, elle faisait son spectacle
Voir la vidéo Youtube : extrait 3
C. Le problème de l’inhumain
L’inhumain, c’est encore une figure d’AUTRUI, que je ne veux pas voir comme mon semblable : auquel je nie cette caractéristique d’être « mon semblable ».
Ici, on va parler de ceux qu’on qualifie précipitamment de « monstres », histoire de créer un fossé protecteur entre eux et nous.
Réflexion à partir du document intitulé « Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur, mon frère… ». Mémoire rédigé en prison par l’auteur du meurtre (fait divers datant de 1836) découvert et exploité par Michel Foucault. Pierre est un paysan normand âgé de 20 ans. Un jour, il tue à coup de serpe sa mère, sa sœur adolescente, son petit frère. Il se pend dans sa prison 5 ans après les faits.
Pierre Rivière fut très vite qualifié de bête et aussi de fou, histoire de dire : on ne peut pas « faire cela » et être un homme = notre civilisation ne peut pas produire le meurtre (cf les « sauvageons » de Chevènement : même déni). Histoire de dire encore : je suis très différent du meurtrier (Rivière réputé fou alors que son mémoire est un modèle de cohérence, de précision…)
C’est en 1789 qu’est vraiment affirmée l’égalité entre les hommes : tous sont égaux, tous sont sujets : dans la société, on est « entre soi » (p 253)
Le problème est que le fonctionnement de la société est toujours inégalitaire. Mais on est désormais dans une « Société du contrat » : je participe à mon oppression (contrat de travail) : le monde est désormais soumis aux puissances abstraites de l’argent.
Dans ce monde, dont la valeur affichée est l’égalité, l’inhumain dérange plus qu’avant : celui que je désigne comme un monstre = mon égal
Le monstre pose le problème de la limite entre l’humain et l’inhumain
| LE MOI | L’AUTRE |
| Le dominant, le notable (= le seul qui mérite d’être noté) | L’indigène, le sauvage, le péquenaud, le plouc, le « cas social » |
L’Ancien Régime aboli, il n’y a plus de place pour un homme qui était entièrement marqué par la sujétion.
En même temps, il y a de vrai déni d’égalité inscrits dans la loi : tuer un homme ou un autre, ce n’est pas pareil. Pour preuve : au XIXème, le Code Pénal assimile le parricide au régicide (promotion de la famille comme modèle de la société). Il fait du parricide le pire des crimes (plus grave que l’empoisonnement, que l’infanticide)…hiérarchie des meurtres qui nie l’égalité des individus. Aujourd’hui, certains voudraient parler de féminicides pour ce qu’on nomme pudiquement les « crimes passionnels », avec un vocabulaire disculpatoire. 80% de ces meurtres sont commis par des hommes/ dans les 20% qui restent, une très grande majorité sont commis par des femmes dans le but de se protéger ou protéger leurs enfants
Autre exemple visant à réfuter la qualification de « monstre » pour un être humain : LE PROCÈS EICHMANN
La philosophe Hannah Arendt, juive résidant à New-York, s’est portée volontaire pour couvrir le procès du nazi Adolf Eichmann qui s’est tenu à Jérusalem en 1961 (un an après qu’Eichmann eut été capturé dans une banlieue de Buenos Aires).
Elle en fera, en 1963, un livre : Eichmann à Jérusalem, Rapport sur la banalité du mal.
Elle prend le contre-pied de la diabolisation d’Eichmann, cantonné pendant son procès dans une cage de verre. Eichmann était un lieutenant-colonel S.S, spécialiste de l’évacuation et de la déportation des Juifs vers les camps d’extermination.
Eichmann a contribué à un terrible génocide…mais il n’est pas un monstre pour autant. Pas même antisémite convaincu, il est juste un fonctionnaire zélé, soucieux d’appliquer au mieux les ordres du Führer. Il représente le mal/ il est « comme tout le monde » (il a, constate-t-elle, un rhume pendant son procès) : c’est CELA qui est dérangeant. Ce n’est pas une personnalité perverse et sadique.
Il est, selon Arendt, l’incarnation de l’absence de pensée chez l’être humain. Il n’éprouve pas de remords, déclarant : « Je n’aurais eu mauvaise conscience que si je n’avais pas exécuté les ordres »
Voir Youtube, procès Eichmann 3’33
IV. LA PERSONNE ET LA MORALE
- Autrui ouvre la dimension de la morale
C’est à partir d’Autrui que la Morale existe. Pourquoi ?
Parce que c’est Autrui qui rend la morale indispensable.
Parce qu’Autrui est pour moi l’occasion du Mal (dans un vocabulaire chrétien : la tentation).
Parce que nous sommes rivaux : nos objets de désirs sont les mêmes : nous sommes dans une situation de concurrence.
- a) la tentation
Texte de Freud : « L’Homme n’est point cet être débonnaire… » in Malaise dans la civilisation chapitre 5 (PUF Collection Quadrige p 53 / ancien PUF p 64) : (54) : cours sur la société
b) le regard
Reprenons le thème du regard ;
A la fin du texte de Sartre sur le regard (22), il est question de « l’ordre et de la défense » : quel rapport avec le regard ?
Le regard = ce par quoi je reconnais l’autre comme une personne (les choses ne me regardent pas)
Texte de la p 498 (Russ) : Lévinas : la signification essentielle du regard c’est « Tu ne tueras point »
Là est l’interdit fondamental, celui qui fonde toute l’éthique (n.b : c’est aussi un ressort dramatique bien connu des polars : la difficulté à tuer qui me regarde bien en face)
Texte de Lévinas : Ethique et infini : extrait photocopié : (29 ):
- la qualité fondamentale de l’autre, c’est son altérité: « Autrui (…) est ce que moi je ne suis pas » : même dans l’amour, c’est la dissemblance qui attire et non l’idéal de fusion ; cf avant-dernière phrase du texte : « l’échec de la communication dans l’amour »: l’amour ne doit pas se donner la fusion pour idéal, sinon il achoppe sur l’incompréhension. Autrui est mystère : je ne peux ni le comprendre ni le posséder (mariage ?). C’est peut-être face à celui dont je suis le plus proche (j’en suis amoureux) que je prends le plus conscience de l’étrangeté d’autrui, de son altérité.
Le Nous et le Tu : Lévinas choisit de penser l’autre plutôt au singulier : ni la sociologie qui dit « les autres » : collectif ; ni la solidarité des Hommes côte-à-côte dans l’horizontalité de la vie quotidienne. Ce qui l’intéresse, c’est le face-à-face du Je-Tu L’expérience primitive de la personne, c’est la seconde personne : le Tu.
Avec cette précision essentielle : ce qui fonde l’affirmation de Lévinas, ce n’est pas le constat de la différence de l’autre mais l’affirmation du principe de son altérité.
- Asymétrie de la relation éthique
- Idée de la responsabilité : je suis moi dans la seule mesure où je suis responsable d’autrui. C’est une vraie différence avec la notion ordinaire de responsabilité : d’habitude, je suis responsable :
- de moi–même, de mes actes
- de mes enfants, de mes très vieux parents, de mes chiens et chats
- ? …PAS de l’humanité toute entière !
Dostoïevski XIXème (cité par Lévinas) Les frères Karamazov : « Nous sommes tous responsables de tout et de tous, et moi plus que les autres »
- B. La personne humaine = la valeur par excellence
- La personne selon Orou :
Diderot, Supplément au voyage de Bougainville) (30)
La personne est ce qui, dans chaque homme, ne peut être traité comme un objet
Texte de Mounier : (Le Personnalisme, collection « Que sais-je ? » p 5) : photocopie : (31)
La personne comme fondement de la morale
Kant : Fondements de la métaphysique des mœurs (Russ : Texte 17 p 290)
La distinction fondamentale de la morale est, pour Kant, celle qui sépare les choses des personnes.
Les choses, c’est ce qui peut être considéré comme réductible au statut de moyen, ce que l’on a le droit d’utiliser (on peut « en disposer comme bon nous semble » : c’est aussi ce à quoi nous réduisons les animaux)
Les personnes, c’est ce dont la nature exige qu’elles ne soient pas simplement employées comme moyens mais qui ont le statut de fin en soi. On peut, à la limite, les utiliser, à condition que ce ne soit pas une utilisation qui rende impossible leur propre réalisation comme personne, leurs propres projets.
(Commenter la formule de l’impératif catégorique)
Conclusion : Dédoublement d’autrui
– le prochain : celui que je suis en situation de rencontrer → le respecter, c’est mon affaire
– le lointain : → celui qui suscite la formulation de la Morale en principes universels.
L’Inconscient

Chacun connaît la phrase inscrite au fronton du temple d’Apollon, à Delphes :
« Connais-toi toi-même », idéal de l’Antiquité, (en grec : « Gnothi seauton ») élevé par Socrate au rang d’idéal de la philosophie.
Mais est-ce seulement possible ?
Si on part du postulat de l’entière clarté et transparence à elle-même de la conscience, sans doute ; mais si on fait l’hypothèse d’une certaine obscurité de la conscience à elle-même : si on pense qu’il y a vraisemblablement de l’inconscient en l’homme, cet idéal devient inaccessible.
Freud, médecin viennois qui vécut entre le XIX° et le XX° siècle, est reconnu comme l’inventeur du concept d’inconscient. Pourtant, il y a beaucoup d’occurrences antérieures, dans la littérature ou dans la philosophie, de cette notion d’inconscient. Tâchons d’expliquer cela.
Les inconscients préfreudiens :
LEIBNIZ (XVIIème): « théorie des petites perceptions » : des perceptions sans aperception… ?
L’inconscient, c’est l’inaperçu (au plus bas sur l’échelle de la conscience) : cf Kh L tome 3 p33 : à tout moment, il y a beaucoup d’objets qui frappent nos yeux ou nos oreilles :
« L’âme en est touchée aussi sans que nous y prenions garde », parce que nous n’y faisons pas attention, mais si soudain l’objet redouble ses stimuli et attire l’attention sur soi, nous en prenons soudain conscience.
« C’est une grande source d’erreur de croire qu’il n’y a aucune perception dans l’âme que celles dont on s’aperçoit ».
Elles concourent à nos actions délibérées…sans que nous en sachions rien
Ex : qu’est-ce qui fait qu’à cet instant je tourne la tête vers la gauche plutôt que vers la droite ? C’est qu’il y a eu « tout un enchaînement de petites impressions dont je ne m’aperçois pas » mais qui rendent le mouvement vers la droite plus malaisé que le mouvement vers la gauche.
C’est ainsi que des perceptions conscientes (bruit) peuvent devenir inconscientes sans pour autant disparaître (habitude du citadin).
DESCARTES : la physiologie : ensemble de mécanismes (locomotion, respiration, digestion, pousse des ongles et des cheveux…) qui sont totalement inconscients (automatismes du corps)
La spécificité de l’inconscient freudien :
C’est un inconscient qui concerne la conscience, qui agit sur elle ; qui joue avec elle.
Les inconscients préfreudiens sont seulement des négatifs de la conscience (inconscient = non conscient). Avec Freud, on a autre chose :
l’inconscient est une force psychique active, qui obéit à des règles, même si ces règles sont autres que celles de la pensée consciente.
Insistons sur le fait que Freud n’est pas philosophe de profession : c’est un médecin, un praticien ; et c’est en tant que médecin qu’il a inventé, dans un but thérapeutique, une méthode d’exploration des zones inconnues du psychisme. Cette méthode s’appelle la cure analytique (ou : psychanalytique). Son but premier est donc de guérir un certain type de malades : les névrosés.
Ces sont en effet des malades qui ont mis Freud sur la piste d’une région inconsciente du psychisme humain.
Parmi les premiers indices de l’existence d’un inconscient : le somnambulisme ; l’écriture sous hypnose, pratiquée par certains psychiatres dans l’entourage de Freud (Breuer, par exemple).
I – L’Inconscient selon Freud
Russ : texte 3 p 399 ; de l’abandon de l’hypnose ; en extraire les définitions de la résistance et du refoulement.
La première patiente que Freud dit avoir guérie, il l’a guérie grâce à l’hypnose (Cinq leçons sur la psychanalyse : cas d’ Anna O.) : une hystérie qui se manifeste par une incapacité à boire alors qu’elle éprouve une soif dévorante. Sous hypnose, la patiente remonte au souvenir du jour où s’est manifesté pour la première fois ce dégoût de l’eau : après avoir vu le chien de la gouvernante, qu’elle détestait, boire dans un verre d’eau (et n’avoir pu, par politesse, manifester son dégoût). A son réveil, la malade demande un verre d’eau et le boit : son trouble a disparu pour toujours. Néanmoins, elle n’a aucune conscience de ce qu’elle a confié sous hypnose.
Hatier : texte 4 p 46 et 10 p 52 (à lire chez soi) : l’adresse de la Psychanalyse au Moi.
- Première Topique (1900)
Ce que Freud appelle « topique », c’est une représentation spatiale d’une réalité non spatiale.
Le préconscient : une perception présente est rapidement transformée en souvenir ; elle est alors rangée dans le préconscient. Il suffit d’un effort de mémoire pour faire réapparaître ce souvenir à la conscience.
On voit que dans cette topique, le cerveau humain présenté comme une sorte d’iceberg, avec – de façon sans doute assez choquante, la partie consciente moins importante que la partie inconsciente.
Lire le texte 2 p 398 (Russ) : avec l’Inconscient, c’est la découverte d’une autre façon de penser que celle de la pensée consciente.
Deuxième topique (1920)
Le psychisme est dès lors représenté comme une sorte de « maison à trois étages » :
Le Ça (das ES) instance du « sous-sol », est l’instance la plus élémentaire de l’appareil psychique. C’est le siège des pulsions inconscientes (on appelle pulsion quelque chose qui est proche de l’instinct, de l’expression des besoins du corps, mais instinct métamorphosé par le fait qu’on se le représente). Ces pulsions cherchent constamment à traduire leurs exigences au sein de la conscience claire.
Freud le décrit parfois comme la « marmite où bouillonnent tous nos désirs refoulés »
Le Moi (das ICH) est le « noyau limité, organisé, cohérent et lucide de la personnalité » comme le dit Françoise Dolto. Il est à la fois conscient et inconscient. C’est l’instance qui assure l’ensemble des perceptions et des activités. Freud postule qu’il émerge vers 15 mois, quand est atteint le célèbre « stade du miroir ». (N.B : ne pas faire reposer là-dessus seulement toute prise de conscience : les dauphins et les chimpanzés aussi (on le constate quand on met une trace rouge sur le front des chimpanzés pendant leur sommeil)).
Le Surmoi (das UBERICH) est constitué par l’ensemble des interdits moraux intériorisés (interdits parentaux mais souvent en définitive interdits sociaux) : il est l’instance qui cherche à refouler les instincts : c’est lui qui exerce la censure, qui empêche le contenu du Ca d’accéder à la conscience.
Hatier : Texte de Bergson : 1 p 418 : l’interdit parental comme expression de la société toute entière
Hatier : Texte de Dolto : 5 p 47 (18’): l’intériorisation de la contrainte : la métaphore des poissons rouges
Inhibition // intériorisation : avant 7-8ans, le Moi se heurte à la Réalité / après, il se heurte au Surmoi
Ces trois instances sont rivales. Il y a, notamment, un combat permanent entre le Ça et le Surmoi.
Russ : texte 10 p 405 : le pauvre Moi et ses trois « maître sévères »… « La vie n’est pas facile ! »
La vie psychique est donc le lieu du conflit, les exigences sociales et morales étant tenues pour incompatibles avec des désirs toujours affreusement inconvenants.
D’où, le refoulement (voir la définition donnée dans la note 7 du texte 5 p 431, Russ)
« L’homme devient névrosé parce qu’il ne peut supporter le degré de renoncement exigé par la société au nom de son idéal culturel » Malaise dans la civilisation p 34
« Il est impossible de ne pas se rendre compte en quelle large mesure l’édifice de la civilisation repose sur le principe du renoncement aux pulsions instinctives » : elle postule la non-réalisation de « puissants instincts » (ibid p 47)
C’est comme s’il y avait en chacun de nous un « petit sauvage » affreusement bridé par la Civilisation.
Freud, dans son Abrégé de la psychanalyse : « Si le petit sauvage était abandonné à lui-même, qu’il conservât toute son imbécillité et qu’il réunît au peu de raison de l’enfant au berceau la violence des passions de l’homme de trente ans, il tordrait le cou à son père et il coucherait avec sa mère » (ceci fait penser à Hobbes quand il parle du « méchant » comme d’un enfant brutal)
N.B : ambivalence de Freud qui tantôt a l’air de considérer que la civilisation, trop exigeante, nous fait du tort/ tantôt semble penser que « l’homme au naturel » est invivable)
Le refoulement est donc un fonctionnement absolument normal et que tout le monde connaît : un des apports principaux de la psychanalyse a été de remettre en cause la dichotomie précédemment admise entre normal/pathologique : d’une part, l’équilibre mental est quelque chose de très compliqué, jamais acquis définitivement. D’autre part, les névroses ne sont pas toujours graves ni irréversibles. La psychanalyse n’a donc pas ses « clients » attitrés : elle est susceptible de concerner tout un chacun, à un moment ou un autre de sa vie.
Entre le Ça et le Surmoi, le moi exerce un rôle d’arbitrage : il cherche à satisfaire les exigences du ça tout en respectant les interdits du surmoi : il cherche à concilier le principe de plaisir avec le principe de réalité.
Le « principe de plaisir » est issu des pulsions, qui cherchent toujours leur satisfaction immédiate (ainsi, le ça peut être vu comme une sorte de tyran qui veut « tout, tout de suite »)
Le « principe de réalité », ce sont les conditions matérielles de l’existence et les injonctions de la société (au sein de la réalité, la « res » = ce qui nous résiste) (définition : voir aussi note 3 p 408 ; Russ) : « il exprime la nécessité où se trouvent nos tendances de tenir compte du monde extérieur ».
N.B : Attention à ne pas considérer trop vite que le ça est naturel (comme est naturelle la soif de jouir) et que le surmoi est culturel : nos désirs sont traversés par la culture / le surmoi est culturel parce qu’il est constitué par les interdits sociaux mais il prend aussi racine dans des aspirations instinctives : par exemple, le désir de protection et d’amour qu’éprouve le petit enfant envers ses parents. Un moyen de les obtenir, c’est de respecter les interdits parentaux.
Ainsi, parce que tout se noue au tout début de la vie psychique, les parents sont très importants pour le sujet : ils sont la clef de voûte de sa construction de lui-même.
Or, ils ont une position complexe puisqu’ils sont la source de toute affectivité et aussi de tous les interdits
N.B : Refoulement ≠ frustration (Sévérité du Surmoi)
Tout individu normal, vivant en société, est tenu de contrôler ses instincts (c’est-à-dire de leur refuser certaines satisfactions) : chacun s’impose donc une certaine dose de frustration (« tous frustrés »…) mais, le surmoi du névrosé est plus exigeant : non seulement il interdit aux instincts de se satisfaire mais il les refoule.
N.B : Le degré de sévérité du surmoi n’est pas directement corrélé à la sévérité des injonctions parentales : des individus ayant eu une éducation très douce peuvent élaborer une conscience morale extrêmement rigoureuse. Inversement, chez l’enfant élevé sans amour, la tension entre le Moi et le Surmoi tombe : toute son agressivité est alors susceptible de se tourner vers l’extérieur.
« La sévérité de la conscience provient de l’action conjuguée de deux influences vitales : la privation de satisfactions instinctuelles (qui déchaîne l’agressivité) + l’expérience de l’amour (qui m’incite à retourner cette agressivité vers l’intérieur et la transfère au Surmoi) » cf Malaise… p 88
A partir de là, il arrive que l’instinct refoulé se « venge » en réapparaissant sous une forme symbolique : par des troubles psychiques divers (des « symptômes » : troubles du sommeil, de la vue, de la voix, de la motricité, phobies etc)
Nous refoulons tous certaines pensées mais nous ne sommes pas tous des névroséS.
Quand l’inconscient est en quelque sorte saturé, des complexes peuvent se constituer :
Un complexe est un ensemble de tendances psychiques refoulées qui perturbent l’équilibre mental du sujet ;
Le plus connu est le « complexe d’Œdipe » des petits garçons (dont le pendant féminin est appelé « complexe d’Electre ») : tendance à s’identifier à / à jalouser le parent du même sexe que lui et à aimer / désirer le parent de sexe opposé. Ce complexe est censé trouver sa « solution » entre 6 et 12 ans …ou bien être une cause (fréquente) de névrose.
II. Les voies d’exploration de l’inconscient psychique
- Psychopathologie de la vie quotidienne
On peut être mis sur la piste de l’existence d’un inconscient psychique par de nombreuses manifestations « anormales » qui surviennent dans la vie de tous les jours
Texte 5 p 400 (Russ) : Freud : Les actes manqués
- les bris d’objets
- les oublis
- les lapsi (lapsus linguae ; lapsus calami) : le mot prononcé par erreur = celui que l’inconscient aurait aimé nous voir dire
La source de ces « ratés », ce sont les désirs refoulés. Nous sommes devant des manifestations soit verbales soit non-verbales de désirs refoulés. C’est là que l’inconscient se révèle.
Principalement de deux manières 1) dans les actes manqués
2) dans les rêves
Pour Freud, ce qui importe le plus, chez l’homme, c’est le désir : c’est lui qui dit la vérité de l’homme : je ne suis pas défini(e) par mon identité sociologique, ni professionnelle ni…mais par mon désir.
Nous sommes des machines désirantes (≠ Descartes : des machines pensantes)
- Les rêves et leur interprétation
Pour Freud, le rêve est la « voie royale de l’exploration psychique » = le moyen d’expression favori des machines désirantes que nous sommes.
Un rêve est l’accomplissement illusoire (symbolique) d’un désir, une « réponse de pacotille » : les désirs – inconscients parce que refoulés à l’état de veille – se satisfont dans les songes.
Il y a principalement deux fonctions du rêve :
- il est le « gardien du sommeil » : nous rêvons pour continuer à dormir
- il est l’accomplissement symbolique d’un désir inconscient : processus de travestissement du désir. Pour tromper la vigilance de la censure (engourdie mais pas abolie), trois « astuces » : 1) le symbolisme
2) le déplacement : Ce qui occupe le premier plan dans le rêve est loin d’être le plus important sur le plan de l’inconscient.
3) le verrouillage : c’est une sorte d’élaboration secondaire : à l’approche du réveil, le rêve devient plus anodin ; c’est la dernière défense du secret de l’inconscient à l’égard de la conscience)
N.B : pour accéder à ses rêves, l’écrivain Van Vogt (auteur de science-fiction) se réveille volontairement toutes les heures et demie : il met son réveil 5 fois par nuit.
Trois catégories de rêves :
■ le rêve infantile (NB : tout le monde peut en avoir) : le rêve qui voit la manifestation d’un désir clairement reconnaissable mais refoulé dans la vie diurne : dans le rêve, le désir apparaît de manière non-déguisée
Voir Le rêve et son interprétation p 31 : la petite fille de 19 mois soumise à la diète et qui nomme, dans son sommeil, tout ce qu’elle voudrait manger
Exemple donné par Freud : la cabane du petit garçon de Halstatt (Cf. Cinq psychanalyses)
■ le rêve qui exprime de façon voilée le désir refoulé
Il y a alors une différence notable entre le contenu manifeste du rêve (la scénette qui se déroule en moi) et son contenu latent (les désirs cachés qu’elle exprime). Pour aller de l’un à l’autre, on est obligé d’avoir recours à une interprétation
En 1900, Freud écrit Die Traumdeutung. Il fait rentrer l’interprétation des rêves dans les compétences de l’analyste : le décryptage que l’analyste fait de nos rêves correspond exactement à l’inverse de ce que fait la censure (cryptage, symbolisation…)
On a le signifiant (la « scénette ») ; manque le signifié (le désir refoulé)
Pendant le sommeil, la censure n’est pas supprimée. Elle est cependant affaiblie. C’est pourquoi un certain nombre de désirs interdits se satisfont dans le rêve, à condition de savoir tromper la vigilance de la censure.
Exemple donné par Frinck : la dame qui achète un magnifique chapeau noir très cher (veuvage, séduction, difficulté // mari infirme, malade)
NB : le contenu émotif apparent du rêve est totalement déconnecté de son contenu émotif réel : exemple du « rêve des excréments » de Freud (dégoûtant / valorisant).
De même, un rêve qui fait rire le rêveur n’est pas pour autant un rêve joyeux.
Exemple du « rêve du vieux monsieur » : un monsieur âgé rêve d’un homme qui pénètre dans sa chambre pendant son sommeil et qu’il n’arrive pas à faire partir, non plus qu’il n’arrive à allumer la lumière. Echec des tentatives de sa femme (en déshabillé) pour éloigner l’inconnu. Le rêve se termine par une crise de rire inextinguible (et atroce) du sujet. Ce rêve est un rêve de mort : l’inconnu indésirable = la mort ; ne pas parvenir à rallumer la lumière de la vie ; l’intervention de son épouse fait référence à sa collaboration à de récentes tentatives de coït, ratées. Le jour qui suit le rêve, le sujet se sent épuisé et accablé.
- le cauchemar : là, le désir profond n’est pas refoulé : l’angoisse va prendre alors la place de la censure. Sa fonction est de susciter rapidement le réveil. L’angoisse est alors l’outil de la censure pour éviter le passage de l’inconscient à la conscience.
Quand le représentant du désir est mal déguisé, il y a naissance d’un conflit anxiogène.
Russ, texte 6 p 431 : contenu manifeste et contenu latent du rêve. Ceux que le rêve intéresse peuvent aussi lire le texte 7 p 402 ( Russ) : le rêve //l’hystérie : le rêveur ne décrypte pas plus ses rêves que l’hystérique ses symptômes
- B.La cure psychanalytique
Russ, texte 4 p 399 : le « cas Elisabeth » : Freud et Breuer Etudes sur l’hystérie
C’est la toute première guérison par la psychanalyse dont se targue Freud.
Elisabeth s’appelle en réalité Ilona Weiss ; c’est une jeune femme de 25 ans de nationalité hongroise. Elle est atteinte de douleurs aux jambes qui, par période, lui procurent même des difficultés à marcher.
Avec « Elisabeth », Freud élabore la technique de la libre-association des idées ; grâce à laquelle le barrage de la censure est dépassé : Freud découvre la jeune fille amoureuse de son beau-frère. C’est parce qu’elle rejette l’idée de cet amour « inconvenant » qu’Elisabeth voit l’apparition de ses premiers symptômes lors du décès de sa sœur (ayant désiré –inconsciemment la mort de sa sœur, Elisabeth ressent une insupportable culpabilité – inconsciente elle aussi – lorsque cette mort survient). Si ses cuisses sont neutralisées, c’est à cause du plaisir érotique que son surmoi a refoulé : conversion (typique de l’hystérie) du psychique vers le somatique (cf. Magnard p 40).
C’est aussi sur ce cas que Freud théorise la notion de résistance (manifestée ici par la rébellion de la malade placée devant l’interprétation de l’analyste)
Quelles maladies Freud prétend-il soigner ?
Les névroses : affections mentales (ex : impulsions suicidaires, insomnie, frigidité, obsessions, phobies, hystéries…) sans altération profonde de la personnalité. Parmi elles beaucoup sont des hystéries : névroses où les symptômes sont essentiellement des substituts de satisfaction de désirs sexuels non-exaucés.
Le nom de névrose est issu du XIXème siècle : dans l’ignorance où l’on était de ce genre de troubles, on les rattachait aux « nerfs »…de la même manière qu’on ramenait l’hystérique à son utérus, la sexualité féminine étant désignée comme morbide.
Chorbak, médecin viennois : la seule ordonnance valable pour l’hystérique : « pénis normalis, à renouveler »
Rappelons aussi que Molière se moque des « malades imaginaires » et que l’Eglise recommande l’envoi de prêtres exorcistes dans les hôpitaux psychiatriques.
Bref, Freud a grandement contribué à ce que ce type de maladies, ce type de souffrances, soit pris au sérieux ;
Freud en propose une cause toute nouvelle : les conflits entre le Moi, le Ça, le Surmoi.
Les psychoses : affections mentales altérant la totalité de la conscience et aliénant complètement la personnalité (ex : schizophrénie ; paranoïa ; délire hallucinatoire). Il y a alors abdication du Moi sous l’empire du Ça. Freud reconnaît, dans la plupart des cas, être impuissant à guérir les psychoses. Dès lors, elles relèvent plutôt de la psychiatrie.
Dans les névroses, le patient est conscient de son état et souhaite être guéri/ dans les psychoses, non.
Quelle est la fonction de la cure psychanalytique ?
Faire passer le refoulé de l’inconscient à la clarté de la conscience
A cela, deux buts possibles : 1) guérir
2) vivre une sorte d’ « aventure de l’esprit », où l’on remonte aux tréfonds de son enfance et où l’on a l’occasion – unique- de découvrir qui l’on est vraiment (au cœur de l’homme : le désir)
Quelle est sa méthode ?
On a deux participants : l’analysant / l’analyste
« Transformer les conflits en récits » (sur le principe : un mal des mots)
La psychothérapie est souvent nommée « talking cure ». En effet, la parole est le matériau analytique par excellence.
Freud part du principe que, dans le développement de la vie psychique, toutes les étapes antérieures sont conservées (possibilité de régression) : dans Malaise dans la civilisation, illustration par une analogie avec la ville de Rome (s’il était possible de voir en elle toutes les enceintes et les monuments successifs) :
Trois stades de développement du petit d’homme : 1 : Stade oral
2 : Stade anal
3 : Stade génital
Le patient remonte ainsi au plus lointain de son enfance (moment très important car formation de la personnalité et moment de l’apprentissage de la frustration) :
L’enfance est aussi l’âge des traumatismes : les plus graves sont inconscients autant qu’indélébiles. (ex : Dans Dreams of my father, Barack Obama raconte ce qu’il présente comme son premier traumatisme, à 9 ans, dans une salle d’attente : il y découvre la photo d’un homme noir âgé, souffrant de multiples dégâts physiques laissés par un traitement « blanchissant »…le monde dans lequel le petit garçon a été bercé s’écroule !)
Dans Cinq leçons sur la psychanalyse, Freud explique que dans le rêve, c’est l’enfant qui s’exprime en nous.
C’est aussi dans l’enfance que se fait l’apprentissage de toutes les contraintes liées à la sexualité
Reprise des mots du poète romantique anglais Wordsworth : « l’enfant est le père de l’homme »
Son but ?
La catharsis : purification, sorte de « purge » des passions. La verbalisation des souvenirs refoulés joue le rôle d’une sorte de « ramonage psychique »
Dès que quelque chose d’inconscient redevient conscient (tel souvenir obsédant), l’état mental s’améliore.
Son protocole ?
Le divan (photo du divan de Freud in Russ p 403) = l’abandon du corps
La pénombre = pas de vision directe de l’analyste
On est proche de la méthode scientifique d’isolement d’un corps chimique : la situation d’expérimentation qu’on veut créer en laboratoire : l’évacuation de tous les paramètres extérieurs
La « règle de non-omission » : le patient est tenu de ne rien cacher des idées qui lui traversent l’esprit (même insignifiantes, même inconvenantes) : il lui est simplement demandé de parler de tout ce qui lui « passe par la tête » selon la libre-association des idées. Telle est la méthode dont Freud pense qu’elle peut faire tomber les blocages de l’esprit critique (« je vais me ridiculiser ») et de la censure
L’analyste écoute l’analysant dans une attitude de « conscience flottante » : il fait autant attention à ce qui n’est pas dit qu’à ce qui est dit (silences, hésitations, bégaiement…). Il est attentif au comportement global de l’analysant (les instants où il se trouble, ses oublis de séance, ses « blancs ») : par là, il tâche de repérer les résistances du malade (c’est là que la censure est au travail)
Les paroles prononcées par l’analysant sont tout sauf abstraites : elles font jouer pour lui des choses très profondes : distinction parler / bavarder
Parce que les paroles prononcées lors de la séance engagent l’affectivité du Sujet, il peut arriver que se produisent des phénomènes d’abréaction : manifestation somatique, décharge d’émotion par laquelle le Sujet se libère de l’affect attaché au souvenir d’un événement traumatique.
Le transfert : le processus par lequel les désirs refoulés s’actualisent en se transportant sur certains objets dans le cadre de la relation analytique.
Par exemple « l’homme aux rats », jeune homme suivi par Freud, rendu malade par l’insupportable tension psychique qu’il éprouvait entre, d’un côté, son père et le « mariage de raison » proposé par celui-ci et, de l’autre côté, la jeune femme désargentée dont il est tombé amoureux. Lors de la cure (qui a lieu au domicile de Freud), il croise régulièrement dans l’escalier la fille de Freud : elle le trouble beaucoup par ce qu’elle incarne : la jeune fille « convenable ».
Dans le transfert, il y a une actualisation du passé (souvent, la répétition de stéréotypes infantiles)
Il y a également un déplacement de la libido du Sujet sur la personne de l’analyste. L’analyste joue ainsi le rôle de catalyseur.
N.B : Breuer, qui a longtemps été l’associé de Freud, avait pour patiente la célèbre Anna.O. Un jour, Anna a déclaré qu’elle attendait un enfant, dont Breuer était le père. Outré par ce mensonge, Breuer a rompu toute relation thérapeutique avec elle ; elle est alors devenue la patiente de Freud. S’il avait réagi plus placidement, il aurait découvert le mécanisme du transfert.
La libido, c’est la pulsion sexuelle telle qu’elle apparaît dans la vie psychique.
On parle de transfert positif pour les cas (ou : les moments) où le Sujet ressent de l’amour pour l’analyste / on parle de transfert négatif quand le transfert prend le visage de la haine (voire : du désir de meurtre)
Au transfert, il est très important que l’analyste réponde par le silence ou par le refus (il ne doit pas faire de « contre-transfert » : le bon analyste sait bien qu’il n’est pas le véritable destinataire de cet amour/haine)
La psychanalyse fait une large place à la notion d’interdit, très souvent envisagée comme une notion positive : l’inter/dit est l’écart qui vient rompre la relation duelle (ex : besoin/satisfaction). De plus, c’est lui qui ouvre l’espace du « dire ».
Sans oublier le rôle structurant de la Loi (cf. Jacques Lacan).
Une des modalités de l’interdit : le silence. Il joue un rôle très important dans une cure analytique (les silences du patient = ses résistances ; le silence constant de l’analyste ; celui qui répond au transfert : refus qui renvoie à la loi).
Le silence joue le rôle de la mort : celle de l’imaginaire.
Parce qu’il y a de l’interdit, l’homme peut se lancer dans la voie de la sublimation, investissement de la libido dans les domaines intellectuels, artistiques etc.
« Comme l’être humain ne dispose pas d’une quantité illimitée d’énergie psychique, il ne peut accomplir ses tâches qu’au moyen d’une répartition opportune de sa libido. La part qu’il en destine à des objets culturels, c’est surtout aux femmes et à la vie sexuelle qu’il la soustrait » Malaise dans la civilisation p 55
Texte de Freud sur l’art : Russ : 13 p 407 / Hatier : 14 p 147 : c’est le passage du principe de plaisir au principe de réalité qui suscite la création (compensatoire) d’un monde imaginaire.
- Quelle est la différence entre l’artiste et l’homme ordinaire ?
A la fin de la cure analytique, l’analyste nomme la vérité du désir du patient.
Rôle majeur de l’histoire personnelle : aux yeux du psychanalyste, l’individu est tel que son histoire l’a fait : il est son passé.
La cure a pour but de me faire prendre conscience de mon passé, et, ce faisant, de m’en délivrer, de m’en détacher : si la cure réussit, on ne plus dire simplement que le malade est son passé mais, plus sainement, qu’il a un passé.
Rôle majeur de la sexualité : pour Freud, il s’agit d’une donnée fondamentale – et même, de LA donnée fondamentale de la personnalité: la libido est la source principale de toute l’énergie psychique.
Cette hypothèse a beaucoup choqué les contemporains de Freud.
On parle du pansexualisme des théories psychanalytiques.
Texte de Freud in Essais de psychanalyse appliquée, Roussel 100 p 174 / KH.L 1 p 32 :
« Tu crois savoir tout ce qui se passe dans ton âme (…) tu te comportes comme un monarque absolu »
III. Critiques de la psychanalyse
■ Critique féministe : Critique qui porte sur la façon dont la psychanalyse parle des femmes et des hommes (le « continent noir de la sexualité féminine », selon les mots de Freud). La petite fille, disent les féministes, n’est pas le « petit garçon avec un pénis en moins » que s’imagine Freud. En effet, la vision que Freud se fait des sexes semble être entachée de ses propres préjugés (voire : de ses propres fantasmes). Ainsi, l’angoisse de castration….n’est-ce pas interprétable comme un retournement ? (par exemple de l’immense déception ressentie par le petit garçon quand il comprend que jamais il ne portera de bébé dans son ventre… ?). Sans cesse, les théories freudiennes ont une vision négative de l’être-femme : la femme serait habitée par le « désir de pénis » ; elle serait passible des catégories du manque, du vide, du « trou » (obstination à voir le sexe féminin comme une absence de sexe).
Certaines lectures féministes ont l’intelligence d’inverser le rapport analytique = on lit les théories de Freud comme un psychanalyste décrypterait le discours du patient : Freud nous parle-t-il d’un « inconscient universel » ou de sa névrose personnelle ?
■ Critique de Deleuze et Guattari (in L’Anti-Oedipe) : La psychanalyse est critiquée pour son réductionnisme : sa tendance à tout ramener au seul « triangle oedipien ». Or, il est grotesque de prétendre que l’enfant, même petit, ne connaît que Papa-Maman : il sait toujours très bien que Maman a un patron ; que la famille est aisée ; que Papa est au chômage ou que le pays est en guerre. Ainsi, la psychanalyse commet une grave erreur en faisant abstraction de toute dimension sociale, historique, économique.
(Voir aussi l’article de Robert Castel « le Psychanalisme » in Philosopher tome 1)
De même, Freud ne fait-il pas trop peu de cas des différences de cultures (ethnocentrisme) ?
Ainsi, l’ethnologue Malinowski, étudiant en 1924 les habitants des îles Trobriand, a montré que, dans cette culture, fondée sur le droit maternel, la notion de complexe d’ Œdipe n’avait aucun sens.
■ Critique de Karl Popper : Il existe deux catégories de théories et deux seulement :
1) les théories scientifiques
2) les théories métaphysiques
Les deux types de théorie ont leur mérite (encore que la préférence de Popper aille aux théories scientifiques). Le tout est que leur statut soit clair. Or, ce n’est pas le cas des théories psychanalytiques. Les théories psychanalytiques sont des théories métaphysiques qui tendent à se faire passer pour des théories scientifiques.
Il y a deux façons d’appuyer une théorie (« tous les corbeaux sont noirs ») :
- soit trouver des faits qui vérifient la théorie (mais combien en faut-il ?) : vérification
- soit trouver UN fait qui contredit la théorie (la théorie est alors réputée fausse et abandonnée) : invalidation.
(Soit l’affirmation « tous les corbeaux sont noirs », la vérification consiste à compter combien de corbeaux valident la théorie/ l’invalidation consiste dans le fait qu’un seul corbeau blanc suffit pour abandonner la théorie).
Les théories non scientifiques procèdent par vérification. Seules les théories scientifiques se soumettent à l’invalidation.
Les théories scientifiques ont l’immense mérite d’être des théories falsifiables, c’est-à-dire des théories qui acceptent pleinement la valeur invalidante de l’expérience (toute théorie réfutée par l’expérience est abandonnée) ≠ les interprétations de la psychanalyse se prétendent définitives (l’inconscient est infalsifiable).
La théorie scientifique, c’est celle qui admet un déséquilibre : on peut avoir 100 faits qui semblent confirmer la théorie et un seul qui l’infirme, on prend au sérieux le fait qui l’infirme.
Au contraire, en psychanalyse, on cherche les « preuves » du côté de la vérification (« vous voyez bien : je vous ai guérie ! ») et on dénie à quiconque contredit la théorie toute capacité à la remettre en cause.
Ainsi, la psychanalyse est un système clos.
En effet, tout rejet de la psychanalyse est interprété comme une manifestation de la résistance et donc…commué en preuve (si vous rejetez mes thèses, c’est que cela vous gêne : vous avez donc bien quelque chose à cacher !). Le psychanalyste est habitué au refus de son interprétation, cela lui paraît normal ; mais, dès lors, il est très difficile d’adresser à la psychanalyse des objections qui soient prises au sérieux.
■ Critique de Sartre : L’inconscient psychique fonctionne comme un alibi : il nous permet d’éviter de nous sentir libres (d’éluder le « courageux combat de la liberté »). Si l’âme est l’ « iceberg » décrit dans la 1ère topique, la responsabilité humaine en est beaucoup minorée. Qui peut se dire : « ce n’est pas (le) Moi, c’est (le) Ça ! », a la conscience plus légère.
A contrario, être conscient de tout, c’est être responsable de tout : Sartre remplace l’idée d’inconscient par l’idée de la mauvaise foi: il nous tient en quelque sorte ce discours : « ce que vous ne savez pas, c’est que vous ne voulez pas le savoir »
Hatier 9 p 51-52 / Russ 5 p 488 : Sartre réfute le schéma de la 1ère topique : l’opposition duelle de la conscience à l’inconscient. Ce dualisme Conscience / Inconscient n’existe pas car il y a un 3ème terme : la censure.
Or, pour être à même de censurer, ne faut-il pas savoir ce qui est à censurer ?
Ainsi, Sartre pose que la censure a nécessairement conscience des désirs inconvenants.
C’est donc tout à fait consciemment que s’effectue le refoulement.
Par conséquent, « la conscience prend conscience de la tendance à refouler pour n’en être pas conscience » : le refoulé, c’est ce que je me cache à moi-même.
N.B : dans un mensonge « normal », il y a deux sujets :
1) le trompeur
2) le trompé
Pour Freud, le schéma fonctionne car le trompeur (le Ça) n’est pas le trompé (le Moi)
Pour Sartre, ce dualisme n’existe pas :
La mauvaise foi est un « mensonge à soi-même » où :
le trompeur = le trompé = le Moi
Alors que Freud base son raisonnement sur un dualisme conscience/inconscient, Sartre pose l’existence de trois instances ( il y rajoute la censure)…mais ces trois instances se réduisent finalement à une seule : le Surmoi (= la censure) ramène cette « trinité » à UN car pour censurer, il faut connaître le contenu des pensées que l’on censure : Sartre, en définitive, n’accepte pas l’hypothèse de l’existence de l’inconscient freudien ( sans pour autant être dans la croyance naïve d’une pleine transparence à soi-même) : il le remplace par le concept de mauvaise foi. Pour lui, il n’y a pas d’inconscient mais seulement un mensonge à soi-même de la conscience (je pense quelque chose + je refuse de me l’avouer)
C. Freud parmi les « philosophes du soupçon »
La psychanalyse touche à un domaine sensible : elle touche de très près à l’idée que l’on se fait de la normalité, de ce qu’est un être humain. Avant elle, on tenait qu’un homme normal, sain de corps et d’esprit était un homme maître de ses pulsions.
Ainsi, elle atteint directement l’Homme dans les représentations qu’il se fait de lui-même ; et plus spécialement, de sa conscience, c’est-à-dire de la supériorité qu’il s’accorde par rapport aux autres êtres vivants.
De plus, les pulsions représentent presque un sujet-tabou : définir l’homme par ses pulsions, c’est le ramener à son animalité, c’est un véritable crime de « lèse-rationalité ».
Trois philosophes ont été surnommés « les maîtres du soupçon » (appellation qui a surgi au XXème siècle et qu’on doit à Paul Ricoeur) : il s’agit de Nietzsche, de Marx et de Freud.
En effet, tous les trois mettent à mal l’idée qu’on se fait du sujet : et si l’homme n’était pas cet être idéal, capable de maîtrise de soi, d’autodétermination, de sublimation constante ? S’il était tout simplement terrorisé par l’inconnu, au point d’accepter n’importe quel enfantillage pour calmer ses angoisses (morale, illusions, religion) ? S’il ne déterminait pas son existence mais était déterminé par elle (Marx) ? S’il n’était même pas maître de sa propre conscience ? S’il n’était conscient que d’une toute petite partie de ce qui se produit en lui (Freud) ?
Hatier 12 p 35 / Russ 9 p 404 : la « triple blessure » de l’humanité
Freud se présente comme l’auteur d’une révolution majeure dans la façon de concevoir l’homme.
1) Galilée/Copernic : géocentrisme —– héliocentrisme
2) Darwin/ Wallace : Théorie de l’Evolution des Espèces (nous sommes issus des grands primates)
3) Freud : le Moi n’est pas maître dans sa propre maison.
LA CONSCIENCE
Kant : « Ceci que non seulement l’homme pense mais qu’il peut aussi se dire : je pense, en fait une personne »
La conscience comme fait ou la conscience immédiate (conscience / inconscience, inertie) :
N.B : en anglais, il y a deux mots : « conscience » = l’état de conscience / « consciousness » = la conscience morale.
La conscience comme savoir (prendre conscience de… ; être conscient que…) lucidité, comme des yeux pour voir à l’intérieur de soi…et le monde : latin: con/scientia = avec savoir, avec connaissance.
La conscience morale (avoir bonne conscience ; avoir sa conscience pour soi ;…tranquille ; juger en son âme et conscience…)
La conscience réflexive : savoir qu’on sent, savoir qu’on sait, savoir qu’on pense.
La conscience est au centre de nos rapports avec le monde comme avec nous-mêmes : voilà pourquoi on l’étudie en premier :
I La conscience, c’est ce qui me rend sujet
- A. Qu’est-ce qu’un sujet ?
* Enorme ambiguïté du mot :
Prenons d’abord le sens négatif :
C’est le sens qu’on utilise en Histoire : Ancien Régime : le sujet = celui qui est assujetti ; objet de pouvoir (soumis au bon vouloir du Seigneur ou du Roi)
la sujétion = l’absence de Liberté
Le sens positif (en philosophie, c’est ainsi qu’on l’entend) :
La personne est SUJET = elle donne sens au monde qui l’entoure ; elle est conscience et non simple réceptacle passif : elle source de représentations, de finalité
Activité, Liberté, capacité à faire des choix autonomes
= PERSONNE =ETRE HUMAIN
Être sujet, c’est être capable de fournir ma libre interprétation du monde (ce qui voudrait dire que les hommes sont plus ou moins sujets : certains sont ignorants ; d’autres sont aliénés)
Subjectivité = singularité de mes représentations psychiques (c’est ce qui explique qu’il y a infiniment plus de différence entre un homme et un autre qu’entre un corbeau et un autre)
* Importance de ce que l’on vit « de l’intérieur » : la conscience comme intériorité, vie intérieure, intimité à so* Sub/jectum : « jeté dessous » Substance pensante (âme, esprit)
Idée que quelque chose reste et sert de support
Idée de quelque chose de stable, fixe, permanent, qui résiste au changement et qui me permet – à 18 mois comme à 88 ans – de dire « Moi » : je suis soumis(e) à des fluctuations permanentes de mes idées et de mes sensations mais je peux dire « je » car il y a une substance qui ne change pas (base invariante)
Identité : du latin « idem » = même. L’identité d’une chose : ce qui fait qu’elle demeure la même à travers le temps et malgré les changements.
Paradoxe du « j’ai changé »
B. Le moi existe-t-il ?
Qu’est-ce que le Moi ? Comment puis-je dire moi ?
Texte de Pascal (photocopie) (2) : Pensée 323 : la somme des qualités empruntées
Distinction essence / accidents : cf « repère: essentiel/accidentel » Russ p 54 / Hatier p 455
La substance = la réalité permanente, qui sert de support aux attributs, qui, eux, sont soumis aux changements. Exemple de l’eau : elle existe sous plusieurs états (liquide ; gazeux ; solide). Elle change énormément. Mais c’est toujours de l’eau : ce qui ne change pas, c’est la substance. De même, vous avez, ces 10 dernières années, énormément changé ; si vous êtes toujours vous-même, c’est à cause de la substance.
Texte de Hume (XVIIIème) (Hatier S : 6 p 30 / Russ : 2 p 247) :
Voilà ce que dit Hume : il y a des philosophes qui sont persuadés, par une sorte d’évidence intérieure, qu’il existe un centre de la personnalité dont nous sentons l’existence : si je fixe sur moi-même un regard intérieur, je découvre le Moi. Hume est sceptique par rapport à cela.
Sa position est que nous n’avons aucune idée du Moi ; car une idée, cela vient toujours d’une perception (d’une impression : empirisme).
L’empiriste, c’est le philosophe qui pense que toutes nos connaissances proviennent de l’expérience, que seule l’expérience est source de vérité.
Pour Hume, il existe deux sortes de perceptions : les impressions et les idées.
Laquelle de ces deux notions vous semble la plus valable ? …sans doute les idées
Nous sommes une civilisation qui valorise l’abstrait / pour Hume, ce sont les impressions qui sont les plus fortes : elles seules sont réelles / les idées dérivent des impressions : elles sont les traces mentales laissées par les impressions quand les impressions ne sont plus.
Impressions = toutes nos sensations, émotions, passions, telles qu’elles font leur 1ère apparition dans l’âme
Idées = images effacées des impressions dans nos pensées et nos raisonnements
Revenons aux thèses du texte : le Moi (ou la personne) n’est pas une impression particulière mais ce à quoi sont ramenées nos diverses perceptions et impressions.
Les impressions sont diffuses, variables, fluctuantes :
ARG (lg 31) : « quand je pénètre le plus intimement dans ce que j’appelle moi-même, je tombe toujours sur une perception particulière ou une autre : chaleur/froid ; lumière/ombre ; amour/haine ; douleur/plaisir ». Quand il n’y a plus de perception : je dors, je suis sans conscience.
L’Homme est un faisceau de perceptions différentes qui se succèdent les unes aux autres.
J’ai des consciences successives. Mais l’idée de l’existence d’un MOI est le fruit de mon imagination.
Tout ce qu’on peut affirmer, c’est qu’il y a des liens entre mes différents états de perception (≠ Bergson : le Moi est ce qui assure la continuité entre les différents états psychologiques)
Le Moi n’est qu’une belle idée rassurante : une fiction, pas une réalité.
Et pourtant je dis MOI !!
Je ne peux faire autrement
Ai-je raison ?
Texte de Kant : Hatier p 31 / Russ 31 p 303 (lire en parallèle le texte de Kojève p 330) : « Le pouvoir de dire JE »
Lire la 1ère moitié du texte :
- quelles sont les implications du fait de posséder (ou pas) le « Je » ?
- qu’est-ce qui justifie l’assimilation des animaux à des choses ?
| HOMMES | CHOSES |
| Le Je | animaux |
| Personne ; personnalité | Nous pouvons en disposer à volonté |
| supériorité | infériorité |
| Dignité, respect | |
| Raison | Sans Raison |
Postulat de l’ « unité de la conscience dans tous les changements qui peuvent lui survenir » : c’est l’idée du Je qui fait la différence entre l’être humain et l’animal ou la chose.
N.B : un postulat est une hypothèse non vérifiable (= ce qu’il faut accepter sans preuve pour pouvoir entrer dans le raisonnement proposé)
On pense grâce au Je ; sans lui, on serait noyé dans le « divers sensible », ballotés comme le décrit Hume entre nos fluctuantes perceptions, bombardés de messages perceptifs que nous ne saurions interpréter, hiérarchiser, comprendre, décoder….
L’accès au monde est toujours médiatisé par ma conscience
« sans cela, j’aurais un moi aussi divers et d’autant de couleurs qu’il y a de représentations dont j’ai conscience »
Autre texte de Kant (T.L) : KHL 10A et 10B : la pensée « je pense » accompagne toutes mes représentations (c’est une 1ère représentation qui accompagne toutes les autres).
Ce « je pense » est antérieur à tout ce qui vient de l’expérience et c’est elle qui rend possible « l’expérience sensible ».
Le Je est transcendantal = donné avant toute expérience = a priori.
Il n’est impliqué dans aucune expérience, c’est lui qui rend toute expérience possible.
Kant l’appelle l’ « aperception originaire ». Elle précède toutes les perceptions.
C’est la conscience de soi, qui rend possible de recevoir des stimuli des sens et de les transformer en informations c’est-à-dire de les organiser en connaissances.
N.B : la représentation du « je pense » « est une et identique en toute conscience » : il n’est pas question de l’identité personnelle du sujet.
C’est une fonction : j’ai le pouvoir de lier, dans une conscience, le divers des représentations. Je peux faire leur synthèse.
Être sujet , c’est être au centre de tout un ensemble de perceptions et à l’origine de tout un ensemble de représentations.
L’unité de la conscience « précède les données des intuitions » : « par elle seule toute représentation des objets est possible ».
S’il n’y avait pas cette « aperception originaire », je serai dans la situation décrite par Hume : un prisme, traversé en permanence par des flux.
3 remarques :
- Le « je » est originel : il existe avant qu’existent les données sensibles
(≠ Hume : une idée vient toujours d’une perception)
- Le « je » est une fonction et non pas une chose. J’ai le pouvoir de lier, dans une conscience, ce qui me vient des sens ; en faire une synthèse, élaborer des représentations.
- Ce « Je » n’est pas le « je » de l’identité personnelle : c’est une fonction que tout Homme possède et qui fait l’Homme
(lecture de la fin du texte)
1. La prise de conscience de soi
Alexandre Kojève (vulgarisateur de Hegel) : Texte 5 p 313 (Russ) : l’animal = « le sentiment de soi » / l’homme = la conscience de soi. Le sentiment animal de soi = une sorte de connaissance spontanée, non réflexive / la conscience de soi = une connaissance réflexive.
Nous sommes des consciences, la chose est entendue. Mais ce n’est pas immédiat (pas inné) : il y a un travail à faire/ un chemin à prendre, pour parvenir à la conscience de soi. Voyons ce qu’en dit Hegel :
Texte de Hegel : Hatier 8 p 32 / Russ : 7 p 314 :
La chose n’a qu’une façon d’être : en soi / la personne en a deux :
1- en soi : comme objet, comme corps
2-pour soi : comme esprit, comme conscience.
L’être en soi est ce qu’il est / la conscience est dualité
Adhésion entière à la réalité / prise de distance avec soi
Coïncidence parfaite avec soi / non coïncidence avec soi (Sartre KH L 11 p 27)
N.B : exemple amusant de Hegel : « faire des ronds dans l’eau » : non pas une œuvre mais l’activité éphémère (et futile) par excellence ! Hegel aurait pu, à l’autre extrême, prendre l’œuvre d’art : il a choisi l’action humaine la plus modeste qui soit.
Bilan :
Pour Hume, non seulement le Moi n’est pas donné mais …il n’existe peut-être pas (scepticisme)
Pour Kant, la conscience est donnée d’emblée : on ne peut pas ne pas être humain : la Raison est un cadeau que nous fait la Nature.
Pour Hegel, il y a quelque chose à faire pour accéder à ce qui fait vraiment de nous des Hommes. La conscience de soi est une conquête
(Trois moyens de conquête de la conscience de soi :
1) l’introspection ;
2) le travail : modification du monde extérieur : projeter sur le monde ce que nous sommes ;
3) la reconnaissance – dialectique du maître et de l’esclave)
Question : Sommes-nous conscients ou avons-nous à être conscients ?
Derrière cette question : est-ce qu’on peut être plus ou moins homme ?
Est-ce que, si l’on ne fait rien, on devient moins qu’un homme (une brute, un abruti, un idiot…)
La conscience serait-elle susceptible de plus et de moins ? De degrés divers ?
Blaise Pascal : Russ 4 p 203 (à projeter pour le texte intégral)
La grandeur de l’homme est grande en ce qu’il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. C’est donc être misérable que de se connaître misérable ; mais c’est être grand que de connaître qu’on est misérable.
Penser fait la grandeur de l’homme.
Je puis bien concevoir un homme sans mains, pieds, tête (car ce n’est que l’expérience qui nous apprend que la tête est plus nécessaire que les pieds). Mais je ne puis concevoir un homme sans pensée : ce serait une pierre ou une brute.
L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature ; mais c’est un roseau pensant. Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser : une vapeur, une goutte d’eau, suffit pour le tuer. Mais, quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu’il sait qu’il meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui, l’univers n’en sait rien. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C’est de là qu’il nous faut relever et non de l’espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser : voilà le principe de la morale.
PASCAL Pensées, Brunschvicg 558-759-347-348
II. Corps et âme: la conscience est-elle tout le Moi ou seulement une partie ? Peut-on définir l’homme par la conscience ? (Deux oppositions : *âme / corps
*conscience / inconscient)
A) Descartes et le Cogito (raccourci pour « cogito ergo sum »)
Texte de Descartes : / Russ 3 p 174, Discours de la Méthode 1637 : le doute méthodique
- Quel est le but de Descartes dans le & 1 ? rendre l’erreur impossible
- …dans le & 2 ? démarquer le doute cartésien (méthodique, optimiste) du doute sceptique
- 4ème & : expliquez la métaphore fondation= fondements + progressivité de la démarche (étage par étage)
2) Statut du COGITO : certitude 1ère et inébranlable, fondement possible de toutes les autres certitudes. Le « Je pense » est le fondement de toutes les autres connaissances.
N.B : JE ≠ René Descartes mais un Je universel abstrait
Importance énorme du COGITO dans l’Histoire de la philosophie : avec lui commence (XVIIème) une philosophie du sujet (qui se prolongera avec Kant)
Désormais, ce n’est plus sur Dieu que tout reposera désormais mais sur l’Homme comme individu. Descartes est le premier philosophe à avoir fait de la conscience le fondement même de la pensée // émergence du Moi dans toutes les dimensions de la culture.
Ex : au XVème siècle, Jan Van Eyck a pour la première fois signé ses tableaux.
Le cogito est la première idée claire et distincte à partir de laquelle l’on peut élaborer une réflexion. Il garantit l’établissement d’un jugement indubitable du moment que l’on avance méticuleusement dans son raisonnement. Cette idée est claire, c’est-à-dire qu’elle est « présente et manifeste à un esprit attentif » (Principe de philosophie, I), mais aussi distincte, c’est-à-dire « précise et différente de toutes les autres (…) qui ne comprend en soi que ce qui paraît manifestement à celui qui la considère comme il faut » (ibid.). C’est le principe sur lequel peut être fondé un enchaînement de raison, donc une manière de s’assurer un point de départ vérace.
Du fait que je pense, je peux en déduire que je suis, et du fait que je suis, je sais du même coup que j’existe.
Dans les Méditations Métaphysiques, Descartes se lance à la recherche des vérités premières et il décide pour commencer, de faire table rase de ses certitudes. Il endosse alors le rôle du sceptique et doute de tout même jusqu’à la véracité des vérités mathématiques. Il élabore également l’hypothèse d’un malin génie qui le ferait se tromper toujours. Mais à ce doute poussé à un point extrême, hyperbolique, il s’aperçoit que quelque chose résiste : il ne peut pas douter qu’il pense pendant qu’il pense. Ainsi la réalité de sa propre pensée s’impose à lui comme une évidence absolue. En effet, quoi que je pense, je ne peux pas douter que je pense au même moment, et donc que je suis. Descartes pose donc comme certain que j’existe en tant que chose qui pense.
« Je pense, donc je suis » est tout simplement l’affirmation que je suis un sujet doué de conscience. Le sujet conscient de soi est ainsi posé comme ce que la pensée ne saurait éliminer sans se nier elle-même. Il faut bien comprendre que c’est en partant du sujet et de la conscience que Descartes fonde sa philosophie.
Pour Descartes, la pensée = toutes les opérations de la conscience (« toutes les opérations de la volonté, de l’entendement, de l’imagination et des sens sont des pensées »), voir texte 13 p 182 (Russ)
La pensée se saisit immédiatement elle-même : Penser = savoir qu’on pense
Toute pensée est consciente d’elle-même : Alain : « Savoir, c’est savoir qu’on sait »
Sartre : « il n’y a qu’une façon d’exister pour la conscience, c’est de savoir qu’elle existe »
Le psychique (toute la vie mentale) est assimilé au conscient.
(Psychique = conscient/ Physiologique = inconscient)
Nous ne pouvons pas vouloir une chose sans savoir que nous la voulons (« l’âme est transparente à elle-même »)
≠ Freud : je peux vouloir une chose (la mort de ma mère) sans savoir que je la veux
Il y a des zones d’ombre. Il y a, dans mon comportement, de l’inexplicable. Cette dose d’inexplicable s’explique par l’hypothèse d’un inconscient psychique.
Exemple de la patiente qui fait suivre son mari par un détective privé : elle ne sait pas qu’elle n’aime plus son mari.
3) L’Homme = une « res cogitans » (pas de lieu, pas d’étendue…pas de substance matérielle : pas de corps)
L’Homme = une Substance pensante, totalement indépendante de ce qui est Matière (Substance Etendue) / enjeu : la vie éternelle
L’Homme = une chose immatérielle, une âme
Moderato : au terme de l’expérience du doute, Descartes sait qu’il existe mais il ne sait pas encore ce qu’il est : la conscience du monde et l’apport d’autrui sont indispensables pour cela.
B) Le Dualisme (Matière et Esprit)
La conscience met en lumière la double nature de l’homme (duel = deux, double):
Comme esprit → comme sujet → comme personne
Comme corps → comme objet → comme chose
Version britannique: the mind-body problem :
-What is mind? demande le matérialiste
– No matter, répond l’idéaliste
-What is matter? (le matérialiste)
– Never mind ! , répond l’idéaliste
Dualisme : théorie qui distingue de manière radicale l’âme et le corps ( ils sont d’essences absolument différentes : il y a divorce) et qui pose une inégalité entre eux ( l’âme semble définir l’Homme à elle seule, comme chez Descartes)
Selon la pensée dualiste : il y a moi ≠ il y a mon corps
Entre l’âme et le corps, il y a opposition : soit conflit soit subordination de l’un à l’autre.
Si c’est une subordination du corps à l’Esprit : Bien
Si c’est une subordination de l’Esprit au corps : Mal
Les relations entre l’âme et le corps doivent être unilatérales et se faire dans le sens:
Ame → Corps (que ce soit consciemment – je lève le bras- ou inconsciemment – maladies psychosomatiques, ou effet Placebo).
Mais il peut exister des relations dans l’autre sens (Corps → Ame) : elles sont alors pensées comme néfastes : les passions.
Le mot âme a des connotations trop religieuses : parlons de l’esprit. Il y a une antinomie entre l’Esprit et la Matière ; l’intelligence et l’exécutant ; qui est largement passée dans la pensée commune, dans le langage courant: hiérarchie entre le haut et le bas, le noble et le vil
(cf. « t’es bête comme tes pieds ! »)
La pensée dualiste imprègne toute notre civilisation. Elle est très fortement représentée depuis le début de la philosophie : rapide parcours de l’histoire de la philosophie :
PLATON (V avt JC) : Phédon « l’âme ressemble de très près à ce qui est divin, immortel, intelligible, simple, indissoluble, toujours le même et toujours semblable à lui-même, et le corps ressemble parfaitement à ce qui est humain, mortel, non intelligible, multiforme, dissoluble et jamais pareil à soi-même ». Ainsi, le corps se dissout rapidement et c’est une libération pour l’âme.
Philosopher, c’est exercer son âme à se dissocier le plus complètement possible du corps : apprendre à mourir. Le philosophe doit mépriser profondément le corps.
Ailleurs dans Le Phédon : « l’âme ne raisonne jamais mieux que quand rien ne la trouble, ni l’ouïe, ni la vue, ni quelque plaisir, mais qu’au contraire elle s’isole le plus complètement en elle-même en écartant le corps, et qu’elle rompt, autant qu’elle peut, tout commerce et tout contact avec lui ». (Pourtant, dans le Banquet, le corps a un rôle d’initiation (vers la Beauté). Mais, très vite, il faut s’éloigner du corps).
Le philosophe = celui qui fait usage de « la pensée toute seule et toute pure » après s’être « débarrassé de ses yeux, de ses oreilles et de son corps tout entier, parce qu’il trouble l’âme et ne lui permet pas d’arriver à la vérité et à l’intelligence » (vx Russ p 49) Et encore : « l’âme du vrai philosophe est indifférente aux passions, aux désirs et aux craintes, autant qu’il lui est possible »
L’âme est prisonnière du corps (jeu de mots : sema= prison/ soma= corps) : le corps est une prison ; un clou qui nous arrime à ce monde-ci ; une entrave qui m’assigne à un endroit précis (ubiquité) ; qui est limité dans ses capacités (alors que l’imagination m’emmène partout, le corps est un « machin » lourd et lent – pesanteur)
« Théorie platonicienne des Idées » (La République, livre VI, 509d)
Hiérarchie entre
| Le monde sensible | Le monde intelligible |
| Les apparences
Un beau corps Le temps Les copies |
Les modèles
L’idée de la Beauté L’Eternité Les Réalités, les Essences (« eidos »), les Idées |
ARISTOTE (IVème avant JC) :
« Je suis dans mon corps comme un pilote en son navire »
dichotomie : gouvernant / gouverné ; activité / passivité (n.b : le mot « gouvernail » a donné la notion de « gouvernement ») + extériorité totale et indépendance du pilote par rapport au navire (il le quitte quand il veut). « Rendre l’âme » : expérience heureuse : restitution (elle est rendue à elle-même, une fois dépouillée de l’« enveloppe charnelle » : libération
STOICIENS (IVème avant JC – IIème après) :
Nous sommes les locataires de notre corps : nous l’habitons à titre provisoire. Les Stoïciens prônent une morale du détachement : j’ai un corps mais il est extérieur à moi et ne m’appartient pas vraiment.
EPICTETE (50 ans après JC) : Manuel (écrit par son disciple Arrien) (Hatier p 437/ Russ 2 p 133):
Précepte 1 : Il faut distinguer : ce qui dépend de nous (les pensées, les tendances, les désirs)/ ce qui n’en dépend pas (santé, richesse, opinion des autres, honneurs) … parmi quoi : mon corps (« tout ce qui n’est pas notre œuvre ») : êtes-vous d’accord ?
Précepte 9 : « la maladie est une gêne pour le corps, mais pas pour la volonté, si la volonté n’y consent pas. Boiter est une gêne pour la jambe, mais non pas pour la volonté. Dis-toi la même chose pour tout ce que le sort t’inflige, car tu découvriras que, si c’est une gêne pour une part de toi-même, ce n’en est pas une pour toi-même ».
Exemple : mon corps est affecté par la maladie / je ne suis pas affecté par la maladie. Si je deviens obnubilé par médecins et médicaments au point de ne parler plus que de ça, c’est moi qui l’ai choisi.
Autre exemple : Toulouse- Lautrec, au corps mal fait : projection identificatoire sur les danseuses de cabaret
Moi souverain des Stoïciens (rapprochement Stoïcien // stoïque) : il convient de se rappeler que les temps sont durs : les guerres font rage ; la torture est une pratique fréquente.
Epictète : esclave affranchi qui- sous la torture- a déclaré au Maître, parlant de son bras : « Tu vas le casser ! Tu peux tout sur mon bras/ tu ne peux rien sur moi ! »
Ascétisme : choix de l’ascèse : exercices par lesquels s’affirme la domination du Moi sur le corps.
Devise des Stoïciens : « Sustinere et abstinere » (« Supporte et abstiens-toi »)
CHRISTIANISME : Paul de Tarse
Séparation de l’âme et du corps (l’Esprit / la chair) + indignité du corps (thème du péché)
Saint Paul aux Romains : « par la Raison, je sers une Loi de Dieu ; par la chair, une Loi de péché »
Saint Paul aux Corinthiens : « Il est bon pour l’homme de s’abstenir de la femme » (l’Homme s’identifie à l’esprit : il se constitue – sans même s’en apercevoir- comme seul référent : du coup, la chair = la chair désirée = la femme = le péché)
Il faut être vertueux c’est-à-dire être frugal et chaste : « jeûne et abstinence ». Il faut « tenir le corps en laisse » : toujours le contrôler, toujours le dominer.
Ascétisme chrétien. L’ascétisme est le socle de la vie monacale au Moyen-âge (et la vie monacale est très importante au Moyen-âge) ; parmi les pratiques religieuses valorisées : la mortification (mortifier sa chair = se faire souffrir, la flagellation, le port du cilice
Pour Paul, le corps est sinon le péché, au moins la tentation du péché = danger.
Poids énorme dans la tradition de l’Eglise des interdits portant sur la sexualité (LE lieu des interdits)
Conclusion : même si aujourd’hui, les théories dualistes sont largement contestées, la trace que la pensée dualiste laisse dans les mentalités est considérable : on considère alors le corps comme un mécanisme, une sorte de statue ou encore de « boîte » : l’âme est en quelque sorte le « fantôme » qui habite la boîte. Pour Gilbert Ryle, la séparation établie par Descartes aboutit à une fiction : celle du « fantôme dans la machine ».
C) Contestation du Dualisme
◙Nietzsche : l’Eglise nous apprend le mépris du corps ; ce faisant, elle promeut un homme chétif, pétri de culpabilité, humilié, couard. Ces valeurs sont des non-valeurs, des valeurs nihilistes qui tirent l’homme vers le médiocre. Mépris du corps, mépris de nous-mêmes, voilà qui fait de nous des impotents, des impuissants.
Le film The Magdalene sisters (Peter Mullan, 2002) dont l’action a lieu en Irlande, en 1964 retrace la réalité des « Madgalene Asylum », couvents ultra répressifs (pénitentiaires) où plus de 30 000 jeunes femmes (orphelines, violées, filles considérées comme perdues) sont mortes au XIXème siècle et jusqu’en 1996.
Ainsi parlait Zarathoustra : « Des contempteurs du corps » (photocopie) : (10)
◙Critique de la conscience par le bouddhisme, notamment le bouddhisme Zen (proche du Taoïsme):
Petit texte du « mille-pattes » (11)
De même, on prend pour modèle un artisan, capable de tracer des cercles avec ses mains mieux qu’avec un compas : ses doigts semblent s’accommoder si naturellement à ce qu’il façonne qu’il est superflu pour lui de fixer son attention : ses facultés mentales fonctionnent ainsi, globalement, sans qu’il éprouve aucune inhibition
« N’avoir pas conscience de sa taille signifie que votre ceinture n’est pas trop serrée. N’avoir pas conscience de ses pieds, qu’on est à l’aise dans ses chaussures. » (Alan W.Watts Le bouddhisme zen)
Dans le bouddhisme, c’est l’inconscience qui est valorisé alors que la conscience porte la trace du négatif.
Mise en valeur du te : le savoir-faire inconscient
De même : « la pensée peut-elle analyser la pensée ? Non, elle ne le peut pas. Tout comme la lame d’une épée ne peut se trancher elle-même, la pulpe du doigt se percevoir elle-même » (page 84)
Remarque : avoir conscience du temps qui passe = s’ennuyer (n’en avoir pas conscience= s’amuser)
Non-dualité de l’esprit, qui rend vaine toute auto-analyse.
Se saisir soi-même revient à avoir une épine sous la peau : le bouddhisme est alors une seconde épine, qui sert à extraire la première. Lorsque celle-ci est extraite, on les jette toutes les deux (p 211) : viendra un moment où le bouddhisme sera inutile (donc nuisible).
Les « six préceptes de Tilopa » : « Ni pensée, ni réflexion, ni analyse, ni exercice, ni intention, laissez-le s’installer de lui-même » (« Voie courte », dans le bouddhisme tibétain)
Le degré de conscience le plus élevé est atteint lorsque l’esprit est débarrassé de tout contenu, de toute idée, de tout sentiment, de toute sensation.
Eloge de la vacuité.
« Ce n’est que lorsque vous n’avez aucune chose dans l’esprit, et aucun esprit dans les choses, que vous êtes libre et spirituel, vide et merveilleux ! » Te-shan
Le Zen incarne tout cet aspect de la vie, situé hors de notre contrôle. Le bouddhisme en général prône ainsi la libération, comprise comme dé-prise.
Du point de vue taoïste, une vie sans but et vide ne suggère rien de déprimant, mais au contraire la liberté des nuages et des torrents de montagne.
D) le Dualisme dépassé
1) Descartes encore : comme tout grand penseur, il va plus loin que son point de départ : il réfute son dualisme initial (il y a dans Descartes de quoi dépasser Descartes)
Descartes part du dualisme : l’Homme est double : il est pensée (conscience) et il est corps (fragment de l’étendue) mais il y a déséquilibre dans la mesure où l’Homme est plus proche de l’âme que du corps (il est plus âme que corps : « l’âme est plus aisée à connaître que le corps ») : je peux saisir toutes les possibilités de mon âme par un simple effort de réflexion, d’introspection.
Donc, pour Descartes, tout ce qui relève de la pensée est possédé par le Sujet / tout ce qui, en moi, échappe à la pensée relève du corps = s’explique par des mécanismes (pousse des ongles, des cheveux…)
Tout ce qui est psychique est conscient ≠ tout ce qui est inconscient est physiologique (Freud n’a pas inventé l’inconscient au sens où avant lui, on savait qu’il y avait des choses qui nous échappaient mais il a prouvé que cet inconscient « connaissait » la conscience, la concernait)
Pour ce qui est de l’animal, Descartes le voit comme entièrement physiologique : l’animal n’est qu’un corps. Mécanisme de Descartes : les animaux sont réductibles à des machines ; la part corporelle de l’homme est réductible à un mécanisme.
En même temps, en l’Homme, Descartes bute sur la difficulté qu’il y a à isoler le psychique du physiologique. Voyez-vous en quoi réside cette difficulté ?
Cf. 6ème Méditation Métaphysique (photocopie ou Russ texte 21 p 189) : Il faut envisager une union de l’âme et du corps
Qu’est-ce qui me révèle que j’ai un corps ? Les sentiments de soif, de faim, de douleur.
Aucun de ces sentiments ne laisse intacte la faculté de penser : je compose un seul tout avec mon corps.
L’Homme = un composé substantiel d’un corps et d’une âme (alliage, mélange)
C’est-à-dire que, même en considérant le corps et rien que le corps, on s’aperçoit qu’il appartient à « un être de raison »
Cf. Aristote : la caractérisation de l’Homme comme animal raisonnable repose sur la structure de la main : son organisation (pouce opposable) + la sensibilité de l’épiderme.
Cf. Des parties des animaux : toutes les conditions de l’habileté technique de l’Homme le montrent comme privilégié par la Nature : désigné par elle comme le possesseur de la Raison
(Le sportif : illustration de l’intelligence du corps. Ex : le savoir inconscient du sportif : partir de son pied d’appel à « telle » distance du tremplin)
2) le corps intelligent
Feuerbach (allemand, XIXème : Hegel ® Feuerbach ® Marx) : « Le matérialiste dénué d’esprit déclare : « L’Homme se distingue de l’animal par sa seule conscience, c’est un animal MAIS doué de conscience » mais il ne remarque pas qu’il se produit dans l’être qui s’est éveillé à la conscience une modification qualitative de l’être tout entier ».
On ne peut pas dire : « l’Homme se distingue de l’animal par sa seule conscience ; c’est un animal mais doué de conscience »
Homme = animal + conscience
Pourquoi ? Parce qu’ « il se produit chez l’être qui s’est éveillé à la conscience une modification qualitative de l’être tout entier » (Feuerbach)
Non pas superposition (addition, adjonction) mais modification totale : « qualitative » : notre corps est un corps intelligent.
L’Homme ne voit pas et n’entend pas comme une mouche ou un mouton (voir ≠ regarder ; entendre ≠ écouter) (les sens seuls ≠ attention consciente et volontaire)
3) le corps comme attitude
On n’est jamais face au corps comme face à un objet inerte : on est face à un sujet qui a un certain usage de son corps. Nos manières d’user de notre corps, de nos sens, sont façonnées par la culture, fruit de la Raison.
Cf. texte de Merleau-Ponty : « l’usage qu’un Homme fera de son corps… » (Russ : texte 7 p 506) (9):
Le corps de l’Homme n’est pas seulement biologique : il est socialisé, éduqué, domestiqué : rien en l’Homme n’est simplement naturel, rien en l’Homme n’est seulement matériel, corporel. Nos manières de dormir, d’éternuer, de pleurer et de rire disent à quelle civilisation on appartient et quelle place on y tientAutre texte de Merleau-Ponty (T.L) « nous sommes habitués par la tradition cartésienne à nous déprendre de l’objet… » (vx Russ p 501) : photocopie (12)
Merleau-Ponty est celui qui nous rappelle qu’il n’est pas possible d’étudier le corps comme une chose inerte : le corps est toujours le corps animé.
Notion de CHAIR : corps-propre ; corps-vécu : je ne peux pas analyser mon corps comme si c’était un objet extérieur à moi.
Mon corps = mon point de vue sur le monde / ne pas le considérer comme un objet du monde parmi d’autres.
Je vis mon corps : c’est toujours de l’intérieur que je le perçois
(regard > œil : Moi > Autrui, le miroir)
Paradoxe du corps-propre : il appartient à la fois au monde et à la conscience (une chose que je sens « du dedans »).
Non pas « j’ai un corps » (Descartes) mais « je suis mon corps »
Enjeu : ai-je le droit de l’utiliser, à des fins commerciales, comme s’il était un simple objet ? (prostitution ; ventes d’organes : migrants qui dans certains pays y sont quasiment contraints ; vente de mon sang quand j’ai un groupe sanguin rare, location d’utérus (mères porteuses) etc
E) Le cerveau et la conscience (Matière et Esprit – bis)
Comment rendre compte de la pensée ? Est-ce par le cerveau (= matière) ; est-ce par la conscience (immatérielle) ?
La pensée est-elle le résultat d’un processus organique comme un autre ?
Est-ce que la vie intérieure, la vie mentale, est seulement le résultat de l’activité cérébrale ?
Le Psychisme = une entité (choses non-matérielle), cause des phénomènes de la vie mentale, consciente et inconsciente. Il est lié aux mécanismes physico-chimiques du système nerveux central (= du cerveau)
Le cerveau est-il l’organe de la pensée ? Est-ce que les médecins peuvent étudier la production des pensées ? (sous-entendu : on connait encore imparfaitement le cerveau ; quand on le connaitra parfaitement, la pensée n’aura plus de secrets pour nous)
ENJEU : quand on comprendra parfaitement comment la pensée apparait, on sera en mesure d’agir directement sur les pensées (celles des autres)
Manipuler / résister aux tentatives de manipulation :
Exemple des images subliminales (= sous la conscience): image indécelable à l’œil nu mais que (peut-être ?) le cerveau traiterait quand même. Au cinéma, on nous projette 24 images par seconde OR, la persistance rétinienne est de 1/10ème de seconde : il est donc possible d’intercaler des images… Dans beaucoup de pays, cette technique est interdite. EX : en 2000, campagne présidentielle étatsunienne : Georges W Busch, Républicain, dans un clip dirigé contre Al Gore, son rival démocrates, fait apparaître en fond d’image RATS. Les scientifiques restent divisés sur l’efficacité de ces images. Ex : au Canada, pendant une émission de télé très populaire, un message subliminal commandant « téléphonez maintenant » passe 300 fois : pas d’augmentation enregistrée par le centre d’appel.
Propagande politique, sectes (moyens d’une emprise efficace) ;
Méthodes de psychothérapie comportementale (soigner) ;
Surveiller et punir : Exemple : Minority Report, Steven Spielberg, 2002 : A Washington, en 2054, la société du futur a éradiqué le meurtre en se dotant du système de prévention / détection / répression le plus sophistiqué du monde. Dissimulés au cœur du Ministère de la Justice, trois extra-lucides captent les signes précurseurs des violences homicides et en adressent les images à leur contrôleur, John Anderton, le chef de la « Précrime » devenu justicier après la disparition tragique de son fils. Celui-ci n’a alors plus qu’à lancer son escouade aux trousses du « coupable »…
Médias (techniques visant une normalisation de la pensée)
De l’intérêt d’avoir toute puissance sur ses pensées : ex : se défaire, grâce à la médecine, d’un souvenir indésirable. C’est l’idée qui a inspiré Michel Gondry (Eternel Sunshine of the spotless mind, film de 2004) : Jim Carrey (le héros) demande à une entreprise spécialisée de retirer de sa mémoire sa dernière histoire amoureuse (le « déconditionnement mémoriel d’un souvenir » a déjà été réussi sur le rat).
HISTOIRE DES IDEES : je situe le conflit : XIXème :
Positivisme (scientisme) ≠ Spiritualisme (primauté et irréductibilité du spirituel)
Je vais exposer ce conflit historique mais il faut constater qu’aujourd’hui encore, il y a deux discours sur le cerveau qui ne se rencontrent pas :
Les uns parlent d’ADN et d’ARN, de synapses et de dendrites, de neurones et de cortex, de neurotransmetteurs et d’acides aminés / les autres, de répertoires d’objets, de mémoire à court terme (ou à long terme), du Je, du Moi, du ça et du Surmoi, du sens de l’humour…
- Positivisme
Cabanis (1795) : « le cerveau secrète la pensée comme le foie la bile »
La peur = une poussée d’adrénaline. Cela signifie que, quand j’ai peur, mon cerveau secrète de l’adrénaline. Mais ceci ne nous aide pas à comprendre pourquoi, dans une situation donnée, les uns ont peur et les autres pas : on n’a pas tout compris sur la peur quand on a mis au jour la corrélation avec une poussée d’adrénaline.
2d XIXème :
*découverte de l’influence du courant électrique sur le cerveau :
– la pensée est-elle la conséquence de l’électromagnétisation de la masse encéphalique ? (aujourd’hui : efficacité des antidépresseurs : nos « états de conscience » sont peu de choses…Ainsi, il ne parait pas utopique de créer une sorte de « pilule du bonheur » qui maintiendrait en permanence ceux qui la prennent dans un état de discrète euphorie !)
*découverte (Gall, 1810) du rôle très important de l’encéphale et des deux hémisphères cérébraux.
Les positivistes sont porteurs d’une vérité cruelle : Le cerveau « siège de toutes les facultés intellectuelles et morales », est une masse de chair grisâtre (verdâtre) de la taille d’un gros pamplemousse, qui pèse le poids d’une grande bouteille d’eau.
Ce qu’on en a tiré : la phrénologie (cranoscopie fondée sur l’idée d’une correspondance entre contenu et contenant
Tableaux anthropométriques (photocopie)
Conséquences possibles :
Dépistage précoce des aptitudes (pédagogie) : Linné (naturaliste suédois du XVIIIème), raconte-t-on, tâtait le crâne de ses étudiants avant de les accepter ( !)
Répression médicalisée des déviances (lobotomie) ; définition et contrôle des populations dites« à risques » (police) ; orientation et sélection professionnelles « rationnelles »
Importance du faciès (« délit de sale gueule ») ; la « bosse des maths »
Sous-entendu : rien n’échappe à la matière. Innéité des qualités morales et intellectuelles
Quelles notions philosophiques rencontre-t-on ici ?
Déterminisme (Destin) / Liberté ; Morale…
Ce qui reste de cette façon de penser, c’est la recherche du côté du biologique pur de ce qui explique les capacités (QI) et l’identité (homosexualité) des individus
Exemple : recherche du chromosome des surdoués, du gène de la violence, ou de l’homosexualité, de l’hérédité génétique de l’intelligence
*(retour aux découvertes) : 1ères localisations cérébrales de fonctions intellectuelles : troubles de la parole et de la mémoire des mots (neuropsychologie) : troubles psychiques dont l’origine est physiologique (neurones endommagés)
(je vous propose un petit exercice :
http://ww3.ac-poitiers.fr/svt/activite/j-coutable/AiresCerebrales/AiresC.htm#haut )
Broca (1861) : découverte du lien entre l’aphasie et un hémisphère gauche endommagé (neurologie cérébrale)
Hémisphère gauche : fonctions intellectuelles principales (classer, faire des catégories, compter…)
Hémisphère droit : fonctions de la reconnaissance et de la cohésion de l’identité personnelle (juger, éprouver)
Oliver Sacks (neurologue anglais) : L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau : un cas d’agnosie visuelle : perte du sentiment de reconnaissance des visages ou des objets, de ce qui différencie un visage d’un objet…).Le malade, un prof de musique, sait décrire ce qu’il voit mais pas l’identifier (gant : « surface continue repliée sur elle-m avec 5 excroissances…). Il n’arrive même plus à identifier son visage…
Au siècle précédant, il serait passé pour fou (≠ blessé)
Pourquoi est-ce que je vous en parle dans la rubrique « positivisme » ? parce que cela explique le JUGEMENT par la MATIERE cérébrale
Résumé : le positivisme est un matérialisme. Pour le positiviste, il suffit, pour connaître le psychisme, d’en faire la topographie.
Epiphénoménisme : doctrine qui soutient que le phénomène de la conscience est accessoire par rapport aux mécanismes biologiques du corps (monisme matérialiste)
N.B : Aujourd’hui, on découvre la plasticité du cerveau (Le Monde, article du 16 oct 2010) : on compare la capacité visuelle de trois chats sourds de naissance et trois chats entendant normalement : les chats sourds ont une meilleure vision périphérique que les autres. La fonction des zones cérébrales initialement destinées à localiser des sons a été modifiée dans le sens de la perception des mouvements : le cerveau est très efficace et ne laisse pas de zone inutilisée (adaptabilité).
Texte de Janet (neurologue et psychologue du XIXème, XXème) : photocopie : (13)
Texte de Bergson : le clou et le vêtement (Bréal p 43) (14)
Où Bergson affirme à la fois la dépendance de la pensée par rapport au cerveau et son irréductibilité à lui (de manière concordante, l’imagerie cérébrale actuelle nous indique quelles zones sont activées quand nous pensons mais en aucun cas elle ne nous renseigne sur le contenu des pensées)
Un des enjeux du débat entre positivisme et spiritualisme : la FOLIE, sa conception, sa thérapie.
Si ce n’est pas le cerveau seul qui pense, ce n’est pas seulement (pas d’abord) à cause de quelque chose d’organique que le fou est fou. Et si la folie ne relève pas tant que cela de l’organique, elle ne relève pas tant que cela de la médecine (traitement chimique des maladies).
Courant de l’ « antipsychiatrie » (Maud Mannoni) : dénonciation de la « camisole chimique » (au XVIIème, le fou est assimilé à un délinquant / au XXème siècle, il n’est pas certain qu’il soit toujours beaucoup mieux traité…cf. Vol au-dessus d’un nid de coucou film de Milos Forman ; 1975). Quand on cesse de croire en la primauté du cérébral, on devient sceptique quant à l’efficacité d’un traitement quasi-carcéral.
L’antipsychiatrie dénonce la psychiatrie comme un instrument de répression sociale de la folie.
Définition de Janet : « un dément est un homme qui ne saurait vivre dans les rues de Paris. Le mot fou est donc une appellation de police » = quelqu’un qui trouble l’ordre public….et si c ‘étaient les rues de Paris qui étaient « démentes » ?
Le fou = un inadapté. Ne peut-on pas remettre en cause l’impératif fait à tous les individus de s’adapter à la société telle qu’elle est ?
L’antipsychiatrie fait le choix de défendre le fou contre la société, aliénante.
Ceci est à rapprocher de l’explication sociologique de la folie donnée par Bateson (en 1956, école de Palo Alto) : est fou celui que les impératifs contradictoires de son milieu ont rendu fou : c’est le concept de « double bind ») : les « injonctions paradoxales » (« sois spontané ! »). Familles pathogènes (thérapies familiales). Par exemple, chacun des parents exige un lien exclusif avec l’enfant.
CONCLUSION (celle que tirent les spiritualistes) : La conscience n’est pas déductible d’une « science du cerveau ». Ainsi, même à supposer qu’à moyen terme on comprenne enfin complètement comment on pense, on ne pourra pas en déduire ce que l’on pense.
III. La conscience morale (le Devoir)
A. Conscience réflexive et conscience morale
C’est le sens du mot conscience jusqu’au XVIIème siècle.
Elle est basée sur la possibilité d’un retour réflexif du sujet sur ses propres actes afin de les considérer et de les juger.
Capacité de dédoublement : Moi → sujet de mes actes
juge de mes actes
Ainsi, elle va de pair avec la conscience réflexive : une connaissance immédiate que l’homme a de lui-même ; de sa pensée et de ses actes (l’instrument de base du « connais-toi toi-même » de Socrate)
Elle est fondée sur la capacité d’opposer ce qui devrait être à ce qui est (idéal moral, politique ou projet technicien).
En cela, la conscience est invention, elle est liberté.
C’est en ce sens moral qu’il faut entendre la phrase de Rabelais :
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme »
(La conscience est placée au-dessus de la science et la juge)
Beaucoup de philosophes postulent l’existence d’une « voix de la conscience », sorte de témoignage intérieur par laquelle chacun est à la fois lui-même et son propre juge.
Cf. l’expression « suivre la voix de sa conscience ».
Rousseau in L’Emile (p 378) : la « profession de foi du vicaire savoyard » : Russ, texte 18 p 268 (10) : « Conscience, conscience, instinct divin… » : La conscience est une espèce de boussole intérieure, innée et infaillible. La conscience est l’organe d’une sorte d’ « instinct moral » qui jamais ne se trompe.
Ambiguïté de ce que nous dit Rousseau : étant inné, le devoir est universel mais, en même temps, il repose sur une croyance : un « je crois en Dieu » qui échappe aux religions officielles (théisme). Mais il y a aussi un début de laïcisation : ce n’est plus Dieu qui est la source du Bien ; le référent moral suprême est placé en moi.
Chez Rousseau, la conscience morale relève du sentiment religieux.
On est proche de cela chez Victor Hugo quand il affirme : « Rien ne dompte la conscience de l’homme car la conscience de l’homme, c’est la pensée de Dieu »
Kant (texte photocopié) : « Tout homme a une conscience et se trouve observé… » : (15)/ (11)
Question d’élève (Lilian) : l’islamiste fanatisé qui tue des dizaines de personnes « au nom d’Allah » est absolument persuadé qu’il fait le bien : … ?
On trouve presque la même conviction que chez Rousseau, à ceci près que pour lui, la conscience morale ne peut pas à la fois être universelle et avoir sa source dans un sentiment, toujours particulier : cette voix morale est celle de la Raison.
A propos de cette voix terrifiante, voir aussi le poème de Victor Hugo intitulé « la conscience » (« L’œil était dans la tombe et regardait Caïn »)
On trouve une belle illustration de l’idée que l’homme possède une conscience morale dans Crime et Châtiment, de Dostoïevski. Raskolnikov est un étudiant qui manque d’argent. Aussi projette-t-il d’assassiner une vieille usurière (pingre, méchante avec sa sœur simple d’esprit, inutile à l’humanité). Avec cet argent, il va pouvoir aider sa mère et émanciper sa sœur de son employeur qui la harcèle. Il s’y prend assez bien pour ne pas être inquiété pour son meurtre. Cependant, à partir de là, son acte le rend malade. Si bien qu’il finit par se livrer à la police.
Le roman de Zola qui a pour titre Thérèse Raquin porte aussi essentiellement sur le sentiment du remords : c’est avec habileté et une certaine légèreté d’esprit que Thérèse et son amant Laurent ont tué Camille, le mari souffreteux de Thérèse. Mais, à compter de ce meurtre, tout amour entre eux devient impossible (et même toute sexualité). Ils finissent dans une haine sans merci l’un pour l’autre, sous l’œil vengeur de la mère du mari assassiné.
La « voix d’airain » du devoir trouve sa source non dans le cœur de l’Homme mais dans sa Raison. Cependant, point commun important avec Rousseau, je ne peux pas ne pas connaître ce que commande cette loi morale.
Suspicion de Kant : celui qui prétend être tiraillé par un « cas de conscience » (= ne pas savoir où se trouve son devoir) est quelqu’un qui se cherche des excuses pour y échapper…
B. Le cas de conscience
Texte de Kant : la restitution du dépôt (KHL T2 p 251) : (16) / (12) (L : lire le texte d’Aristote pour voir comme les philosophes se répondent) Kant y défend la thèse que nous avons une conscience immédiate du devoir.
C’est le moment où je ne sais vraiment plus comment agir pour être en accord avec la morale, avec ma conscience. C’est un moment de crise intérieure : je suis à la croisée des chemins (« crux » : écartèlement). On a un choix moral à faire et on doit trouver en soi-même seulement des ressources pour juger du Bien et du Mal.
Scepticisme de Rousseau et Kant à l’égard du cas de conscience
Et néanmoins, ça existe. Pourquoi ?
- Mon bien (= mon intérêt) = un Mal moral : divorce entre mon bien et le Bien (il est difficile d’aller contre son propre intérêt : Jean Valjean « Tempête dans un crâne » in Les misérables ). Prise en considération des conséquences négatives : du bien il résulte un mal.
- Il n’y a pas toujours dissociation complète du Bien et du Mal
Cas où le Bien et le Mal sont intrinsèquement mêlés dans les deux choix : choix politique, après une période où les droits de l’Homme ont été bafoués : Paix sociale (oubli mais injustice) ou Justice (condamnation de tous les coupables) mais risque de violence voire de guerre civile.
- Toutes les valeurs ne sont pas forcément compatibles entre elles : conflit des devoirs.
Exemple d’Antigone (Sophocle) : devoir de sœur, de Polynice, d’Etéocle (devoir de sépulture : morale) ≠ devoir de citoyenne (obéissance au pouvoir politique (Créon).
Autre exemple : Sartre et le jeune homme tiraillé entre l’assistance à sa mère et l’engagement dans les F.F.I.
Autre exemple : Le Cid, de Corneille (XVIIème) : dilemme : Si le héros accepte le duel avec le père de sa fiancée, il sauvera l’honneur de son père, humilié par le premier, mais il perdra l’amour / s’il refuse de se battre pour sauver cet amour, il perdra l’honneur.
Si désagréable soit-il, le cas de conscience a un grand mérite : il nous élève à la réflexion morale : plutôt que d’appliquer des préceptes tout faits (catéchisme), nous sommes obligés de réfléchir, de hiérarchiser entre nos valeurs. On peut aussi y voir une sorte de mise à l’épreuve : sommes-nous si moraux que nous le pensions ?
C. Critiques de la conscience morale
Kant et Rousseau postulent tous deux une sorte d’instinct moral infaillible : qu’est-ce qui les rend difficiles à croire ?
L’origine apprise de nos critères moraux ; la relativité du Bien et du mal : les normes varient selon les époques, les coutumes, les religions…
Pas d’innéité de la conscience morale mais une intériorisation progressive des normes
On a deux systèmes de pensée : l’un, qui considère que :
Les normes sont d’origine divine, donc absolues
l’autre que :
Les normes sont d’origine humaine (conventionnelles), donc, relatives
Repères L p 51/ ES-S p 450
Sujet de dissertation : « La conscience morale n’est-elle que l’intermédiaire de ce que la société permet ou défend ? »
Freud : « Notre conscience, loin d’être le juge implacable dont parlent les moralistes est, par ses origines, de l’angoisse sociale et rien de plus »
Nietzsche : Le Gai savoir (KH S 16 p27) : (17)
Ou : texte de Bergson (Hatier p 418) : Les deux sources de la morale et de la religion
Ainsi parlait Zarathoustra (1883-1885) : « Des trois métamorphoses » : Les trois moments du renversement de toutes les valeurs :
1) le CHAMEAU : l’Homme du devoir, moment du « Tu dois ! » : on subit le poids des valeurs transmises. Moment des grandes religions (Judaïsme, Christianisme). Morale qui va dans le sens d’une dépréciation de la vie.
2) le LION : l’Homme révolté : moment de la négation, de la destruction des valeurs
3) l’ENFANT : la transition vers le surhomme ; on passe du NON au OUI : affirmation totale.
N.B : il vaut mieux être un lion qu’un chameau mais on ne peut être lion si on n’a pas d’abord été chameau : il ne s’agit pas de critiquer autrui, il s’agit de métamorphoses de soi-même.
IV La conscience comme acte
- Husserl (1858-1938)
La conscience n’est ni un contenu ni un contenant : elle est un acte, une attention (cf. la « prise de conscience »). ≠ Substantialisme
Elle n’est rien « en soi » : elle doit, pour exister, se rapporter à autre chose qu’elle : « Toute conscience est conscience de quelque chose »
Elle fait qu’il existe un monde, et non pas seulement des objets juxtaposés.
Elle me situe dans le monde. La conscience et le monde sont liés comme sont liés le faisceau lumineux et l’objet éclairé : c’est ma prise de conscience qui fait exister le monde.
Cette activité qu’est la conscience par rapport au monde = l’intentionnalité
(La conscience poursuit toujours une visée, elle se rapporte toujours à autre chose qu’elle-même)
Texte de Sartre sur Husserl : Hatier : 5 p 29 / (18)
Sartre (1905-1980)
Ce dont je dois rendre compte, c’est de la liaison intime que Sartre fait entre la conscience et le néant. Titre : L’Etre et le néant : le néant est mieux que l’être : l’être, c’est le mode d’existence des choses (l’en soi). Le néant caractérise les êtres conscients.
Le point commun avec Husserl, c’est que c’est une action : on ne peut pas dire :
la conscience = le néant ; on doit dire : les êtres conscients ont une capacité à créer du néant : une faculté de néantisation.
« La conscience est un être pour lequel il est question, dans son être, de son être, en tant que cet être implique un être autre que lui »
L’être-là ne suffit pas à définir l’homme. Il faut, pour comprendre un homme, introduire l’idée d’un être autre que lui : soit celui qu’il a été (néant car il ne l’est plus)
soit celui à qui il pense (l’amoureux : vous ne le comprenez pas si vous n’incluez pas en lui l’idée de qui n’est pas lui mais est son ami(e))
« La conscience est ce qu’elle n’est pas et n’est pas ce qu’elle est »
Elle est ce qu’elle n’est pas : * temporalité : elle se projette (le possible, l’avenir) / elle est (encore) ce qu’elle n’est plus (mémoire)
*désir : un être hanté, dans son être, par un être autre que lui : je ne peux être compris que comme tension vers ce qui n’est pas moi (évasion qui est l’acte de votre conscience : je tiens vos corps prisonniers mais vos conscience néantisent mon discours et vous êtes tout entiers tendus dans l’attente de la merveilleuse sonnerie de fin du cours)
Elle n’est pas ce qu’elle est : je suis toujours au-delà des déterminations qu’on donne de moi (un garçon de café roux, un élève fainéant, quelqu’un qui est bon en physique) = le « pour-autrui ». Jamais je ne suis réductible à ceci.
L’objet est ce qu’il est : parfaite coïncidence de la chose avec elle-même ≠ la conscience n’est pas coïncidence avec soi : il y a du vide, de l’incertitude, de l’inquiétude (du néant, du possible, de la liberté).
Conclusion : c’est plus risqué, plus fatigant, d’être une conscience que d’être une chose ; mais c’est bien plus passionnant. Peut-on « avoir la flemme » ? Peut-on démissionner de sa conscience ? = se faire chose abrutie dans canapé devant télé ? Oui, on a besoin de démissionner de temps en temps (l’humanité a toujours inventé des pratiques d’abrutissement), mais… pas trop longtemps ni trop souvent.
- Bergson (1859-1941) :
La conscience comme faculté de choix et mémoire
Texte Hatier p 26/ Russ 7 p 427 / Roussel p 197 : lien entre la conscience et la temporalité.
La conscience n’est pas quelque chose d’abstrait et de mystérieux : tout le monde la connait très bien sous le premier aspect sous lequel elle apparait (N.B : concret ≠ matériel) :
* la conscience est choix : elle est sélective : deux personnes différentes font attention à des choses différentes (cf texte in photocopie « Russel » : acte automatique / acte conscient)
* la conscience unifie la succession des perceptions : elle assure une continuité entre mes différents états psychologiques. Grâce à la conscience, la succession des perceptions est continue (≠ Hume) : cohésion de l’identité.
* la conscience est au service de l’action : elle trie, parmi mes souvenirs, ceux qu’elle a intérêt à actualiser : elle va chercher ce qui, dans le passé, est à mettre en relation avec le présent, avec l’action présente (RQ : il y a une perte possible : une partie de mes perceptions est inutile une fois la chose identifiée) (Schéma)
- la conscience est mémoire (même si elle est lacunaire, peu performante, si elle ne retient qu’une infime partie du passé : « une conscience qui ne conserverait rien de son passé, qui s’oublierait sans cesse elle-même» qui périrait et renaitrait à chaque instant serait inconscience. Fonction : retenir ce qui n’est déjà plus.
- la conscience est anticipation de l’avenir: à chaque instant de notre vie (je fais la cuisine…mes devoirs, je corrige des copies) : je m’occupe de ce qui est en vue surtout de ce va être : « l’attention est une attente et il n’y a pas de conscience sans une certaine attention à la vie). Toute action est un empiètement sur l’avenir.
- la conscience fait que nous n’habitons pas la vie comme un point sur une ligne, sans surface (le pur instant, où le seul présent existerait pour nous). Nous sommes installés sur une certaine épaisseur du temps = la durée (le temps que nous vivons est fait de notre passé immédiat et de notre avenir imminent).
« appuyés sur le passé et penchés sur l’avenir » : voilà le propre d’un être conscient.
Un être conscient = un être pour qui la temporalité existe.
Le bonheur
On voit que derrière les conceptions du bonheur, ce sont des façons de concevoir l’homme qui se profilent
(= enjeu anthropologique) :
– est-il un être de nature, défini avant tout par son corps ?
– est-il un être de culture, chez lequel tout passe par l’esprit ?
Tout va rapidement tourner autour d’une question, que je formulerai de deux façons différentes:
1) Y a-t-il équivalence entre des notions comme : contentement, satisfaction, satiété, bien-être et Bonheur ?
2) Quel est le rôle de l’intelligence par rapport au bonheur ? Les vaches qui paissent tranquillement dans les grasses prairies peuvent-elles être dites « heureuses » ? Y a-t-il une vérité de « l’imbécile heureux » ; autrement dit : doit-il déplorer nos capacités intellectuelles comme un handicap par rapport au bonheur ?
(D’après Rousseau, dans le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes( p 189), l’habitant des rives de l’Orénoque (fleuve qui sépare le Vénézuela de la Colombie) se méfie de l’intelligence comme de la peste : il applique des ais sur les tempes de ses enfants pour leur assurer une bienheureuse imbécillité !)
(2 axes de réflexion :
1) contentement/satisfaction/satiété/bien-être ≠Bonheur ?
2) le rôle de l’intelligence par rapport au bonheur : la pertinence de la voie régressive)
INTRODUCTION : Le bonheur est, à nos yeux, une aspiration légitime et universelle : chaque homme, chaque femme, désire être heureux. Nous pensons donc qu’il en a toujours été ainsi. Or, il n’en est rien. Comme l’a dit Saint Just « le bonheur est une idée neuve en Europe » (fin XVIIIème). Pourquoi ?
Deux raisons : 1) avant le XVIIème, la question était de survivre, pas d’être heureux (surmortalité infantile, fréquence des décès prématurés : n.b : c’est encore le cas d’un certain nombre d’hommes sur cette planète ex : Niger, Somalie, Syrie,Gabon)
2) laïcisation, or, le bonheur est un idéal laïc
Avant le XVIIème siècle, la Société se donnait d’autres valeurs : au moyen-âge, l’honneur, par exemple, était placé plus haut que la vie. D’un point de vue religieux, la bonté morale (vertu), qui ouvre la possibilité du Salut, est placée beaucoup plus haut que le bonheur.
Dans le discours chrétien, la vie terrestre (« ici-bas ») est appelée « vallée de larmes » : c’est le lieu de l’épreuve (notre mise à l’épreuve) ; l’au-delà étant au contraire le lieu de la récompense ou celui de la punition.
Citons le poème des « Béatitudes » (dans le Nouveau Testament, Evangile selon Matthieu, chapitre V) :
« Heureux les affligés car ils seront consolés.
Heureux les doux car ils possèderont la terre.
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. »
… après la mort : c’est l’au-delà qui est proposé comme lieu de la félicité (de l’union avec Dieu) : pas ici-bas.
Par ailleurs, le christianisme se méfie bien fort du corps (appelé « l’abominable vêtement de l’âme » par le pape Grégoire le Grand – VIIème siècle). De même, le pire des péchés, c’est « la gula » : péché de gourmandise…presque toujours associée à la luxure.
Dernière idée : le bonheur participe d’un mythe égalitaire : tout le monde peut y arriver ; tout le monde y a droit : c’est le fantasme d’une société individualiste (et matérialiste). Ce n’est donc pas un idéal collectif : seulement un souhait, d’ordre privé.
On est peut-être même en train de passer du droit au bonheur à une sorte de « devoir d’être heureux » (on publie des livres dont le titre est : « C’est décidé : je suis heureux ! ou : le bonheur en 25 leçons », voir aussi comme la chanson « Happy » est serinée à la radio), qui diffuse des injonctions (caractère normatif de l’appel au bonheur, conformisme, par exemple, l’idée qu’il FAUT avoir une vie sexuelle).
I. Est-ce que le bonheur est une suite de plaisirs?
- A) l’hédonisme et l’eudémonisme
Explorons les différences qui opposent les notions de bonheur et de plaisir :
-la question de la durée : durable / éphémère, ponctuel
-la question de l’intensité : stable, continu / ruptures, discontinuités mais intensité très forte
(échelles différentes : qualité / quantité) : modèle de l’électroencéphalogramme : l’un, haut et plat / l’autre, en dents de scie (mais capable d’aller plus haut)
-la question de la nature : spirituel, mental, total / physique, matériel, circonscrit.
Les hédonistes sont les philosophes qui pensent que la seule voie d’accès au bonheur est le plaisir.
Etre hédoniste, c’est adhérer à la maxime latine que vous connaissez : « Carpe diem » (Horace). Une de ses versions les plus connues nous est donnée par le poème de Ronsard « Ode à Cassandre » (pour Cassandre Salviati, dont Ronsard, qui a 20 ans, est amoureux fou (« Madame, allons-voir si la rose » 1545…). Une version plus commune de l’hédonisme : « sea, sex and sun ». Le sens commun appelle « épicurisme » cette façon de voir l’existence… au mépris des textes du vrai Epicure.
L’hédonisme fait donc l’apologie des jouissances terrestres. Vous en connaissez certainement la version Walt Disney ( Le Roi lion : « Acuna matata » : il en faut peu pour être heureux , leit-motiv de Timon et Pumba ; même chose dans le Livre de la jungle , où l’hédonisme est, cette fois-ci, incarné par Baloo ) : accueillir tous les plaisirs, « ne pas se faire de bile », ne pas « se prendre la tête » : ce discours est assez actuel : notre société est hédoniste : elle juge que vous avez le droit de vous faire plaisir (de « craquer » et de « claquer ») parce que « vous le valez bien ! » . « Vivre sans temps mort, jouir sans entraves » proclame un des slogans préférés des situationnistes…aucun chef d’entreprise n’aurait trouvé mieux ! L’hédonisme est un moteur central du marché.
Apologie du moment présent : fable de La Fontaine : « le savetier et le financier » : le savetier est un homme pauvre mais joyeux et insouciant/ le financier, un homme aisé, soucieux, sérieux. Le jour où le financier donne une grosse somme d’argent au savetier, c’en est fini de son insouciance…au point qu’il rend même l’argent reçu ! Version contemporaine : YOLO ! (you only live once)
Pour les hédonistes, non, rien ne dépasse le bonheur ; pour eux, oui, le bonheur n’est rien d’autre que la succession des petits plaisirs de l’existence : le croissant chaud, le vent dans les cheveux, la vitesse pendant le trajet en scooter, le sourire de l’ amoureux(se)…
Juste pour le plaisir du titre, ce livre de Philippe Delerm : La première Gorgée de bière et autres plaisirs minuscules.
Leurs adversaires philosophiques sont les eudémonistes : (manuel STG Nathan technique p 200) leur nom vient du grec « eudaimôn »= heureux : ce sont les philosophes pour lesquels la finalité de l’action humaine consiste en la recherche du bonheur (Platon, Aristote, Epicure). Pour eux, le bonheur est le souverain bien : il y a une hiérarchie des biens au sommet de laquelle on trouve le bien le plus précieux, le seul qu’on ne cherche pas pour autre chose que lui-même. Pour eux, le bonheur est une fin en soi. En effet, tous les biens possibles sont d’une part des fins, d’autre part, des moyens (pour accéder à une fin qui les dépasse) : au terme de cette chaîne, on trouve le « souverain bien ».
L’hédonisme comme l’eudémonisme sont donc deux doctrines qui visent à la recherche du bonheur (but de la philosophie).
Jusqu’ici, on ne voit pas du tout en quoi ils s’opposent.
Ce qui les oppose, c’est leur façon de concevoir le bonheur : pour les eudémonistes, le bonheur est identifié à la vertu (il ne peut y avoir de divorce entre le bon et le bien) / pour les hédonistes, le bonheur est assimilé au plaisir (c’est le plaisir qui est le souverain bien).
Pour bien faire comprendre la différence, prenons l’exemple de la sexualité : l’hédoniste cherchera le bonheur du côté de la jouissance sexuelle / l’eudémoniste prétend qu’il n’y a bonheur que si le simple plaisir physique est dépassé (faire l’amour à quelqu’un qu’on aime : un sentiment plus plein, un plaisir qui dépasse l’excitation physique).
Les eudémonistes formulent à l’encontre des hédonistes deux types d’objection : d’ordre psychologique et d’ordre moral.
Objection d’ordre psychologique : le plaisir est éphémère : une fois possédé, l’objet convoité (désir) perd tout prestige à mes yeux (ou : disparait dans l’acte de consommation). Il en résulte que tout plaisir (satisfaction) est suivi par un sentiment d’insatisfaction : la succession des plaisirs (de la recherche des plaisirs) n’a aucune raison de s’arrêter. On voit mal par quel miracle ce parcours chaotique aurait pour résultat le sentiment profondément satisfaisant, stable et uniforme qu’on appelle le bonheur. Selon eux, il y aurait donc une différence profonde entre les plaisirs et le bonheur : les plaisirs appartiennent au registre de la quantité (intensité de l’excitation sensorielle) quand le bonheur appartiendrait au registre de la qualité (caractère non mesurable du sentiment d’une parfaite harmonie entre soi-même et le monde).
Cette analyse renvoie aux différences profondes qu’il y a entre la notion de désir et celle de besoin (travail de distinction conceptuelle à faire faire)
| LE DESIR | LE BESOIN |
| Importance de l’Imaginaire | Procure la satisfaction (satiété) |
| Qualitatif (inquantifiable) | Mécaniste (il y a un vide : on le comble) |
| Sans limites=débouchant sur l’insatisfaction | Bien circonscrit=facile à satisfaire |
| Portant sur des personnes (même si c’est par le biais des objets) | Portant sur des choses |
| HUMANITE | ANIMALITE |
(NB : distinction entre besoins primaires (qui concernent le corps) et besoins secondaires (culturels, acquis. Exemple : le besoin de musique)
Dans le bouddhisme, tout « bonheur mondain » est éphémère et insatisfaisant « comme du miel sur une lame de rasoir » (la souffrance le suit « comme la roue du char suit le bœuf »).
Objection d’ordre moral : si le plaisir est le souverain bien, cela signifie que tous les moyens qui procurent du plaisir sont bons : on ne saurait opposer le principe du bien moral au plaisir puisque, si ce bien moral est une valeur, il est subordonné au souverain bien.
A quel titre le plaisir peut-il être incompatible avec la morale ?
– on pense aux pratiques qui vont dans le sens de l’autodestruction (ex : les paradis artificiels et la recherche « chimique » du plaisir (mais au nom de quoi les déclarer immorales ?)
– on pense que les plaisirs des uns ne sont pas forcément compatibles avec les plaisirs des autres (monde où le mode de vie des pays riches épuise les énergies non renouvelables de la planète toute entière) : injustice
– on pense surtout aux plaisirs qui reposeraient sur la souffrance infligée à autrui : Sade (XVIIIème) qui déclarait : « La nature n’a créé les hommes que pour qu’ils s’amusent de tout sur la terre (…) Tant pis pour les victimes, il en faut ».
* Réhabilitation du plaisir de fumer :
Le plaisir de fumer rencontre-t-il le domaine de la morale ?
Non, car c’est un rapport de soi à soi, qui ne rencontre pas le tort fait aux autres (on se parle pas des parents qui fument longtemps à l’intérieur de la voiture, toutes fenêtres fermées, alors que les trois bambins sont à l’arrière/ on ne parle pas non plus du tort fait à la société toute entière par le biais des frais de soin des cancéreux : tort indirect à la société toute entière)
Une action immorale est une action où l’on fait de manière directe et consciente un tort à autrui.
Tirade de Sganarelle, Dom Juan, Molière, 1665 :
« Quoi que puisse dire Aristote et toute la Philosophie, il n’est rien d’égal au tabac ; c’est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n’est pas digne de vivre »
- prise de position du côté de la modernité (contre Aristote, les anciens, le principe d’autorité). Aristote prône les « vertus dirigées vers soi-même » parmi lesquelles, la tempérance. Au XVII ème, société où les libertés sont fragiles : Dom Juan fut arrêté par la censure après la 15ième représentation.
- Le tabac est du côté de l’égalité : l’éloge du tabac par un valet résonne comme la thèse d’un droit au plaisir pour tous. Ainsi « c’est la passion des honnêtes gens » : plaisir social, socialisant, partagé. Le tabac enseigne la vertu : la gratuité, le don, contre le rapport marchand. Il est souvent lié au plaisir de la conversation (par opposition à l’hypocrisie des dévots qui condamnent le tabac mais vont fumer en cachette dans les toilettes). Sous Louis XIII : première prohibition du tabac en France.
- « qui vit sans tabac n’est pas digne de vivre » : alexandrin provocateur, qui joue sur l’opposition entre la vie comme simple fait biologique et la pleinement humaine, qui fait une place au plaisir. Ainsi, on prend position contre l’idolâtrie d’une défense de la vie humaine entendue au sens purement biologique (qui entraîne la condamnation du tabac au nom de la santé). Sganarelle oppose la vie comme simple survie (qui est le fait des esclaves) et la vie digne de l’humanité (faite de libertés et faisant une place aux plaisirs). Sganarelle proclame ainsi que tous les hommes, y compris les valets, sont libres.
* Platon : Le Philèbe (à partir de 60 a) : Comment être heureux ?
Philèbe/Socrate : pour Philèbe, « le plaisir est le vrai but de tous les êtres vivants et la fin à laquelle ils doivent tendre tous » : identification du bon et de l’agréable.
Pour Socrate, c’est la sagesse qui est la clef du bonheur.
Cependant, si l’on sépare de manière radicale la sagesse et le plaisir, ni la vie de plaisirs sans sagesse ni la vie absolument sage et sans aucun plaisir n’apparaissent comme désirables.
Conclusion N°1 : ni le plaisir ni la sagesse ne sont le souverain bien.
Conclusion N°2 : « il ne faut pas chercher le bien dans la vie sans mélange, mais dans la vie mélangée. » Assimilons-les à deux fontaines : l’une de miel (le plaisir) ; l’autre d’eau (la sagesse) : il faut absolument avoir à notre disposition l’une et l’autre.
Faut-il donc, aussi, jouir de tous les plaisirs ?
Non : pas ceux qui sont « les compagnons inséparables de la folie et du vice » : certains plaisirs sont manifestement incompatibles avec la sagesse.
Le Bonheur : un savant dosage ; un composé (avec l’art des proportions).
Les biens qui le composent sont :
1) la mesure
2) le beau (la proportion)
3) l’intelligence et la sagesse
4) les arts, les sciences, les opinions vraies
5) le plaisir
Conclusion N°3 : ni l’intelligence ni le plaisir ne peuvent prétendre être le Bien absolu…et le plaisir moins que l’intelligence. Et l’argument selon lequel « c’est le but que poursuivent toutes les bêtes du monde » ne vaut rien (« on n’est pas des bêtes » !).
- B) la joie selon Spinoza (grand philosophe hollandais du XVIIème siècle)
La joie : une piste pour dépasser l’opposition du bonheur et du plaisir ?
Revalorisation de la joie au détriment de la tristesse, de l’humilité, du remords (« passions tristes », valorisées au sein des religions juive et chrétienne)
Quelle définition donneriez-vous de la joie ?
La joie = un état mental extrêmement agréable, où l’on déborde d’une espèce de grâce (une émotion profonde et agréable)
Pour Spinoza, la joie fait partie de la grande famille des affects (ce par quoi l’esprit est affecté : modifié). Les affects sont soit des diminutions soit des augmentations de puissance. Il y a deux grandes familles d’affects : les affects à base de tristesse/ à base de joie.
Les diminutions de puissances = les tristesses / les augmentations de puissance = les joies.
Les tristesses sont généralement en rapport avec la haine / les joies, en rapport avec l’amour.
Ainsi, la tristesse engendre la haine (je veux détruire ce qui n’entre pas en rapport avec moi : ce qui me détruit) ex : quelqu’un qui rentre soudainement dans la pièce dans laquelle je suis en train de rêver en paix.
Réciproquement, une chose qui me donne de la joie est une chose qui augmente ma puissance d’agir (la rencontre avec une œuvre d’art par exemple). La joie survient quand je rencontre quelque chose qui convient avec mes rapports (ex : la musique que j’aime).
Spinoza dit que deux individus dont les rapports se composent forment comme un troisième individu qui les englobe (Moi + la musique que j’aime = un Tout puissant).
Au contraire, la musique que je n’aime pas (le crincrin du supermarché) diminue ma puissance d’agir : je mobilise une partie de mes forces pour me protéger de ces sons blessants.
On est proche de Nietzsche, qui affirme dans l’Antechrist (GF p 46) : « Le bonheur, c’est le sentiment que la force croît, qu’une résistance est surmontée ».
Là où c’est un peu plus compliqué, c’est qu’il y a des joies de la haine (ex : quand j’imagine mon ennemi malheureux, mon cœur éprouve une étrange joie). Ces joies sont des joies indirectes. Mais, on a beau essayer de croire que le cœur s’épanouit dans les joies de la haine, on trouve toujours la sale petite tristesse dont on est parti : ces joies sont des joies de compensation. Seules sont bonnes les joies directes.
Il en résulte que c’est très compliqué de vivre, parce que vous ne savez pas d’avance quels sont vos rapports (= qui vous êtes) et avec qui ou quoi ils vont bien se composer : la démarche est forcément tâtonnante. Et c’est, bien sûr, différent d’un individu à l’autre…cf. marche en montagne. On passe sa vie à essayer de savoir ce qui nous procure de la joie.
L’aide que nous donne Spinoza : tâcher de démêler les vraies joies (saines, directes) des joies de compensation (joies mesquines).
Voilà qui permet de réfuter l’hédonisme : on n’a pas toujours l’équation : plaisir = bien (il existe des plaisirs mauvais, des joies mauvaises).
Ce qui est intéressant, c’est qu’on est loin de l’argument moral classique : c’est mal de faire du mal à autrui (que faire face à qui répond : « Et après ? »). Ce qu’explique Spinoza, c’est qu’en faisant du mal à autrui, je me cause du tort (je cultive des affects qui me diminuent)
Texte de Spinoza (Russ 10 p 220) :
Spinoza critique implicitement l’Eglise : au Moyen-Age, les pieux laïcs (dont Saint Louis) s’astreignent à des mortifications physiques : port du cilice (vêtement volontairement rugueux), flagellation, sommeil à même le sol etc.
Spinoza refuse d’opposer le corps et l’âme : ce qui est bon pour le corps est bon aussi pour l’esprit : l’homme n’a pas à restreindre ses désirs si ceux-ci le poussent à être heureux.
Le bonheur ne fait qu’un avec l’accomplissement de nos tendances naturelles (il est tout sauf une récompense accordée d’en haut par un Juge)
Le maximum de bonheur, c’est la béatitude ou : bonheur du sage, bonheur dans la vérité (pas par des moyens artificiels : drogue, alcool, divertissement).
Tous les hommes cherchent le bonheur mais tous ne cherchent pas la vérité. Les philosophes sont ceux qui cherchent le bonheur (comme but) dans la vérité (comme norme).
« La béatitude n’est pas le prix de la vertu » : le bonheur, c’est la vertu elle-même
Béatitude : amour de Dieu = joie de l’esprit associée à l’idée de Dieu comme cause = ce que j’éprouve quand je comprends que tout arrive selon des lois naturelles et nécessaires = le parfait contentement d’un être qui se connaît comme la partie du Tout, qui jouit de cette connaissance.
La condition de cette béatitude est la nécessité (c’est-à-dire aussi, la négation du libre-arbitre). Ceci est à rapprocher de Nietzsche, qui évoque souvent « l’amor fati » : acceptation de l’adversité : Oui au Destin, Oui à tout ce qui advient.
C) le bonheur comme extrémisme moral
La quête du bonheur est la quête d’une satisfaction intégrale, indivise, sans partage.
Paul Ricœur : « le bonheur, cet au-delà des satisfactions locales, partielles » (article de Ricœur dans « le Monde » du 5 novembre 1993)
Il est un état parfait, suprême, une sorte d’absolu. Vouloir être heureux, c’est vouloir un maximum, quelque chose d’indépassable : c’est vouloir l’absolu, le Tout.
C’est pourquoi, explique Ricœur, ceux qui veulent à tout prix être heureux sombrent si souvent dans la déception et le malheur. C’est qu’il y a dissymétrie : beaucoup de choses ont beau, dans ma vie, être très satisfaisantes, un seul souci suffit à mettre par terre cet équilibre parfait, cette totalité du bonheur.
Ainsi, ceux qui veulent non pas seulement être satisfaits (non pas seulement le plaisir) mais LE BONHEUR sont très exigeants : il y a une sorte d’extrémisme moral inhérent à la quête du bonheur : celui qui veut LE BONHEUR n’accepte pas de se rabattre sur « la menue monnaie des plaisirs ». Il ne se contente pas des satisfactions partielles (accomplissements qui relèvent des métiers – satisfactions professionnelles – des jeux (plaisirs ludiques) ou des arts (joies esthétiques): il est dans une logique du « tout ou rien » …et c’est cette logique qui amène si souvent le tragique, le malheur.
Fontenelle : « Le grand obstacle au bonheur, c’est de s’attendre à un trop grand bonheur »
(voir aussi le poème de La Fontaine, Le Héron)
Ricœur nous parle de la quête du bonheur comme d’une sorte de passion. Or, la passion veut tout. Et il y a de multiples obstacles à mes projets de bonheur (le sort, le hasard, l’accident / les propres projets de bonheur d’autrui).
Avec ce constat cruel : ce sont ceux qui cherchent le plus ardemment le bonheur qui sont le plus confrontés au malheur.
D’où cette question :
D) Faut-il renoncer au bonheur ?
Ce paradoxe : ceux qui, en matière de bonheur, sont trop ambitieux, rencontrent souvent le malheur / ceux qui ne le sont pas assez n’ont aucune chance d’arriver au bonheur : tout au plus parviendront-ils à la satisfaction, à la jouissance.
Mais n’est-ce pas là la sagesse : regarder avec lucidité le bonheur comme un objectif inatteignable et se replier sur les multiples petites satisfactions de l’existence ?
Première tentative en ce sens :
– la réponse stoïcienne (école de philosophie très importante du IIIème avant JC au IIème après lui)
Le stoïcisme : une conception négative (au sens du « négatif » photographique) du bonheur.
Pour les Stoïciens, le bonheur, c’est l’absence du malheur.
Le moment où le mal cesse = le bonheur
Par exemple, il paraît (un instant !) évident, que pour le chômeur, trouver du travail lui procure du bonheur. Plus encore, on n’a pas de mal à imaginer le bonheur fou de l’aveugle recouvrant la vue….pourtant, il est difficile de prétendre que travailler ou voir procurent à eux seuls le bonheur.
Le bonheur a pour double nom l’ataraxie (absence de trouble de l’âme : ni souvenir traumatique, ni désir inassouvi ni souci obsédant) et l’aponie (absence de trouble du corps, le « silence des organes » comme le chirurgien René Leriche, début XXème, définissait la santé).
Epicure : « La nature réclame-t-elle autre chose pour le corps que de n’avoir mal nulle part et pour l’esprit de se sentir bien ? »
Dès lors, pour un stoïcien, le bonheur se confond avec la notion de sérénité (en grec, « ataraxia »).
Le bonheur est donc aussi l’absence de ce qui cause le malheur : absence de douleur, de désir, de trouble d’aucune sorte.
Réaction normale : « mais la douleur, on ne peut pas l’éviter ! » Eh bien pour les Grecs, si.
Ils voient la douleur comme une émotion, pas une sensation (pas un phénomène physique pourvu de réalité). Le présupposé, c’est qu’il dépend uniquement de nous de ne pas ressentir une émotion (on peut donc s’entrainer à ne pas ressentir la douleur, en faisant un long tavail sur soi); une sensation : quelque chose d’incontournable. Or, on sait aujourd’hui que la douleur est un phénomène réel : il y a douleur quand il y a transmission d’information nociceptive. Ceci dit, cela n’exclut pas une assez grande part de subjectivité cf : jeu/gifle)
Etre heureux est plus ou moins vu comme une question de volonté, c’est-à-dire de discipline : ne pas vouloir l’impossible : pour Epictète : ne désirer que « ce qui ne dépend que de nous »
Epictète : « Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu désires ; mais désire que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux ». Par exemple, quand tu appelles ton serviteur, aies en tête qu’il est possible qu’il ne t’entende pas, qu’il ne soit pas disponible, qu’il ne soit pas disposé à t’obéir.
Version Descartes « changer mes désirs plutôt que l’ordre du monde » (3ième maxime de la « morale par provision » du Discours de la Méthode): la personne handicapée physique qui envisagerait son bonheur comme une personne valide se condamnerait à la dépression.
Le bonheur devient alors une question qui relève de la morale (= force mentale), et certainement pas du hasard. La recherche du bonheur suppose un travail sur soi (qui peut même en passer par une certaine ascèse) //ascétisme, socle de la vie monacale).
L’homme heureux par excellence est le sage (celui qui se maîtrise parfaitement).
Sagesse comprise comme « harmonie avec l’ordre extérieur du monde et l’ordre intérieur de soi ».
Texte d’Epicure (antérieur au stoïcisme : IVème avant JC): S-ES (Hatier) : p 82/ STG p 224/ L : 4 p 121: désirs naturels et désirs vains.
Sénèque : « Une vie heureuse, c’est celle qui s’accorde avec la nature »
La conception stoïcienne a bien des aspects très séduisants ; notamment, elle s’appuie sur la conviction d’une grande force morale de l’Homme. On retrouve une certaine proximité entre cette conception et les enseignements les plus classiques du bouddhisme. Cependant, on peut lui reprocher de conduire à une certaine passivité. En effet, si nous étions entièrement passifs, alors l’équation :
Absence de trouble = bonheur
serait pleinement convaincante.
Cependant, dans la mesure où nous sommes agissants, il est intéressant de regarder de plus près la liaison opérée par Aristote entre bonheur et action.
Le bonheur, affirme Aristote, c’est ce que nous obtenons lorsque nous accomplissons parfaitement ce que nous faisons.
On a ici une définition positive du bonheur (non plus seulement défini comme contraire du malheur) : il est accomplissement (à la fois terme et perfection).
Alain, philosophe du XXème siècle, souscrit complètement à la réorientation aristotélicienne du bonheur vers l’action.
Alain Propos sur le bonheur : « Aristote » (p 113) : « Mais parce que les sucreries donnent un petit plaisir sans qu’on ait autre chose à faire qu’à les laisser fondre, beaucoup de gens voudraient goûter le bonheur de la même manière et sont bien trompés »
Ainsi, le plaisir du spectateur est pauvre : il faut qu’il invente quelque chose pour l’accroître. Et la musique entendue procure moins de plaisir que la musique telle qu’on se la chante.
Travail possible pour T.L : le Prince / l’enfant (103) : « Propos sur le bonheur du 16 mars 1923 » : du devoir d’être heureux ou « il faut vouloir son bonheur et le faire // ES 8 p 440
On rejoint Aristote qui affirme : « Les plaisirs sont les signes des puissances » (… on pense fort à Spinoza)
Le signe du progrès véritable, en toute action, est le plaisir qu’on y prend.
Deuxième tentative sinon de renoncement au bonheur, du moins de repli de cette notion sur une conception plus modeste :
– le bonheur « dans l’instant » :
D’abord, expliquons pourquoi, traditionnellement, le bonheur dans l’instant (voire : le bonheur tout court) était dévalorisé. C’est à cause de Platon.
Pour Platon, le bonheur fait partie des désirs du monde sensible : par opposition aux Idées éternelles, le monde sensible contient des idées particulières, subjectives : non universalisables. Ainsi, la notion de bonheur est dévaluée : étrangère au rationnel, elle ne fait pas partie des Réalités ou Vérités dignes d’attention.
Ici, au contraire, on valorise le bonheur, y compris dans son caractère non rationnel : le bonheur est un état aléatoire donné comme « par-dessus le marché » : il survient comme un « don du ciel » au sens où on ne peut ni totalement prévoir ni complètement expliquer pourquoi il survient (cf. le dessin de Sempé-Kh L p 526 : on ne peut rationaliser le bonheur sans le perdre de vue). On ne peut, sans doute, être heureux que « sans cause » ; les causes ne sont donc jamais des causes de bonheur (cf Jankélévitch Kh L p 534).
Alain : « Le bonheur est une récompense qui vient à ceux qui ne l’ont pas cherchée »
Ici, l’idée aussi d’une certaine gratuité du bonheur : non pas la réponse prévisible à un certain comportement (il est déconnecté de la notion de mérite) mais une sorte d’ « état de grâce » au caractère quasi miraculeux (il peut surgir au sein des situations humaines objectivement les moins enviables).
Parler de bonheur « dans l’instant », cela signifie avant tout qu’il échappe, en quelque sorte, au temps. On suit ici l’analyse selon laquelle le temps étant la durée, l’instant (« sans durée » de même qu’un point sur une ligne est « sans surface ») constitue une sorte de sortie du temps : cela rejoint le sentiment qu’on éprouve dans les bonheurs extrêmes : notre perception temporelle est comme annihilée : le bonheur échappe à la mesure du temps. Il constitue donc une sorte de « rapt » (on est ravi), une évasion, fugace, passagère, hors du réel et de ses conditions habituelles. Les notions qu’on rejoint ici sont celles d’enthousiasme, d’euphorie.
Dernière idée : le caractère fugace du bonheur signifie qu’il est suivi du malheur comme de son ombre : ce serait seulement par contraste avec le malheur qu’on éprouverait le sentiment du bonheur : s’il n’y avait qu’un « long fleuve tranquille » du bonheur…il ne serait absolument plus ressenti comme bonheur : au mieux, il apparaitrait comme bien-être ; au pire, comme ennui (Schopenhauer, XIXème: « La vie oscille, comme un pendule, de la souffrance à l’ennui »).
II. Le bonheur est-il une affaire strictement personnelle ?
(Le bonheur est-il une affaire privée ?)
Ce que l’on entend par là, c’est : y a-t-il une dimension collective (politique) du bonheur ou est-ce une notion qui ne concerne que les individus ?
- A) un vœu privé
Le bonheur est le vœu que tout un chacun formule pour lui-même, pour l’ensemble de sa vie. Pour autant, il est impossible de faire abstraction de notre condition d’êtres sociaux par rapport au bonheur : autrui fait fatalement partie de la problématique de la quête du bonheur, soit qu’il fasse obstacle à cet objectif ( j’en suis amoureux(se) ; lui, non/ je voulais ce poste de travail : c’est lui (elle) qui l’a eu) soit qu’il y contribue (dans l’amour, dans l’amitié, autrui est la base du sentiment de bonheur que j’éprouve). Ainsi, le « vivre ensemble » est une dimension essentielle du « vivre bien ».
Pensez au livre/film Into the wild
C’est Aristote qui dit le mieux qu’on ne peut être heureux tout seul : il fait de la philia (amour, amitié) la base du sentiment du bonheur. L’homme étant un être sociable, il semble normal que l’accomplissement du bonheur ne puisse se faire que dans l’échange du « donner/recevoir »
Analysons la phrase, importante dans L’Ethique à Nicomaque, qui dit que « l’homme heureux a besoin d’amis ».
On peut s’étonner : trouver la remarque d’une platitude extrême. Mais, la platitude serait de dire que l’homme a besoin d’amis pour être heureux. Ici, ce n’est pas tout à fait cela : l’homme est déjà heureux, mais cela ne fait pas de lui quelqu’un de totalement auto-suffisant (vivant, peut-être en autarcie affective) : par rapport à autrui, il n’est pas dans la satiété mais encore et toujours dans le manque, dans le « besoin de », dans la main tendue.
Discutons à présent la petite phrase par laquelle on dit de quelqu’un qu’ « il a tout pour être heureux ». Contrairement à ce que l’on pourrait penser au premier abord, on ne dit pas cela de quelqu’un qu’on constate heureux mais bien plutôt de quelqu’un à qui l’on reproche de ne pas être heureux alors même qu’on lui trouve toutes les attributions matérielles qui semblaient être la condition du bonheur.
N’est-on pas ici en train de confondre le registre de l’AVOIR et celui de l’ ETRE ?
Analyse conceptuelle :
– AVOIR : extériorité, matérialité, possession
– ETRE : intériorité, essence, identité
Dès lors, on se rend compte qu’ « avoir des amis », bien qu’il emploie l’auxiliaire français avoir, renvoie plutôt au registre de l’être : quand on est l’ami de quelqu’un, on ne le possède pas, pas plus qu’on est possédé par lui. On « est l’ami(e) de… » : ce n’est jamais définitif : il faut toujours que la volonté de l’un comme de l’autre soutienne cette amitié.
Du reste, on ne possède jamais des personnes : c’est très abusivement même qu’on dit qu’on a des enfants ou un conjoint. Ainsi, le verbe avoir ne coïncide pas avec la catégorie philosophique de l’avoir.
Il est facile de voir que le bonheur concerne l’être plutôt que l’avoir. Le problème, c’est que la notion de Bonheur a émergé (est devenue une valeur) au moment où les sociétés occidentales commençaient à confondre l’être et l’avoir.
En effet, le Bonheur est un idéal moderne, lié au mythe de l’égalité et à la société de consommation. Or, en tant que véhicule du mythe égalitaire (tout le monde a le droit d’être heureux), le bonheur doit être mesurable. D’où l’idée, bien efficacement diffusée par la publicité, qu’il y a des critères visibles du bonheur. D’où une confusion entre bonheur et pouvoir d’achat.
In Philo-fables p 38 : « Les baguettes d’ivoire » (conte du philosophe chinois Han Fei, III ème avant JC).
NB : Selon une étude britannique réalisée en 2008, sur le sentiment d’être heureux, la France vient au 62ème rang mondial (le trois premiers pays sont le Danemark, la Suisse et l’Autriche). Dans le même temps, le PIB de la France est le 5ième au monde.
- B) le bonheur et la morale
A priori, il n’y a pas de lien si, comme on l’a dit, le bonheur n’avait rien à voir avec le mérite et qu’il survenait en quelque sorte « miraculeusement ».
Demandons-nous tout de même s’il existe un lien entre l’aspiration individuelle au bonheur et l’obligation collective de respecter la morale.
Y a-t-il un lien entre le désir d’être heureux et la volonté d’être bon ?
Si un tel lien était trouvé, ce serait « tout bénéfice » pour la morale : le désir d’être heureux est universel. Quant à la volonté d’être bon, on voudrait qu’elle le soit. Si donc on pouvait fonder le devoir (notion austère, jamais tout à fait sympathique) sur le bonheur (notion éminemment séduisante pour tout un chacun), quel gain !
Formulons donc cette hypothèse : c’est le souhait de la vie bonne qui est à l’origine de l’obligation (du devoir comme de l’interdiction).
Hélas, au niveau individuel, force est de constater que cela ne fonctionne pas : je trouve ponctuellement beaucoup plus d’avantages personnels à bafouer la morale qu’à la respecter. Cependant, au niveau collectif, on peut voir un passage : dans la mesure où autrui peut être un obstacle à mon bonheur (s’il me vole, me viole, me calomnie), il convient de limiter sa liberté afin de sauvegarder mes chances d’être heureux.
C’est le principe de l’article 4 de la « Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen » : « la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ».
Ainsi, mon désir d’être heureux (pris au sens étroit comme : désir d’être en paix) constitue une limite (légale et morale) à l’action d’autrui.
Toutefois, on a ici une interprétation nécessairement minimale du bonheur : ce que la loi sauvegarde, ce n’est pas mon bonheur, c’est la condition de possibilité de mon bonheur : que je ne sois ni martyrisé, ni réduit en esclavage. Il s’agit simplement qu’il n’y ait pas d’empêchement arbitraire à mon bonheur.
Ainsi, l’angoissante question « que dois-je faire ? » renvoie à deux objectifs possibles :
- Que dois-je faire pour être moral?
- Que dois-je faire pour être heureux?
Si pour les philosophes de l’Antiquité, les deux questions n’en font qu’une, ce n’est le cas ni pour Kant, ni pour nous : il faut donc choisir notre priorité.
Pour Kant, la chose est claire : la morale doit primer sur le bonheur.
Il ne promet pas, comme les moralistes de l’Antiquité, qu’être moral procurera le bonheur. Ni celui-ci, ni un bonheur d’une espèce plus haute.
Kant sait que Job est possible. Kant ne promet rien.
L’important pour Kant n’est pas d’être heureux, c’est d’être moral c’est-à-dire d’être digne du bonheur.
C’est seulement à ceux qui adhèrent à une religion qu’il est donné l’espérance d’une récompense : c’est la religion qui rétribue (mais : dans l’au-delà) « l’avoir été moral »par l’être heureux ; or, l’espérance n’a rien à voir avec la philosophie :
La morale n’est pas une doctrine du bonheur
Elle ne nous apprend pas à être heureux. Soyons moraux, la tâche nous suffit.
Kant : Russ 21 p 294 : court passage de la Critique de la Raison pratique
« La morale n’est donc pas à proprement parler la doctrine qui nous enseigne comment nous devons nous rendre heureux, mais comment nous devons nous rendre dignes du bonheur. C’est seulement lorsque la religion s’y ajoute, qu’entre en nous l’espérance de participer un jour au bonheur dans la mesure où nous avons essayé de n’en être pas indignes ».
Kant : texte de la restitution du dépôt (16) : (L : lire le texte d’Aristote pour voir comme les philosophes se répondent) Kant y défend la thèse que nous avons une conscience immédiate du devoir.
Il est impossible de se fonder sur le bonheur pour savoir quoi faire car il s’agit d’un difficile calcul des intérêts et des risques ainsi que d’un hasardeux pari sur l’avenir (incertain par excellence)
Dans le cas d’une action accomplie par devoir, je me reporte aux principes (accessibles à un enfant de 7/8 ans)
Dans le cas d’une action qui est accomplie en vue du bonheur, j’envisage des conséquences probables (calcul de probabilités)
c) le bonheur est-il un droit ?
D’abord, le bonheur est-il une notion qui concerne le domaine politique ?
Remarque : dans les textes politiques, on parle d’ « intérêt commun », de « Bien public » mais la notion de « bonheur public » n’aurait aucun sens. Le bonheur est avant tout une notion qui concerne l’individu.
Cependant, le véritable but du pouvoir, n’est-ce pas le bonheur des citoyens ?
De fait, à partir de la Révolution française, le pouvoir politique s’est vu, de plus en plus, assigner la tâche de « faire notre bonheur ».
Ainsi, l’article 1 de la DDH de 1793 est le suivant : « le but de la société est le bonheur commun »
Est-ce à dire que le bonheur est un droit ?
Dans la « Déclaration d’indépendance » (USA, 1776), la « recherche du bonheur » était considérée comme un des droits naturels de l’Homme, un des précieux « droits inaliénables » « on considère comme « des vérités évidentes par elles-mêmes que les hommes naissent libres et égaux ; que leur Créateur les a dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels sont la vie, la liberté, la recherche du bonheur ; que les gouvernements humains ont été institués pour garantir ces droits ») La recherche du bonheur change alors de statut : du pur souhait individuel, il tend à devenir quelque chose dont la constitution doit être garante.
En même temps, cette prise en charge du thème du bonheur par la sphère politique porte de possibles dérives :
Texte de Kant dans Théorie et pratique (105); Hatier ES-S texte 9 p 440
Parlons à présent des différentes formes de gouvernement : y a-t-il une de ces formes, qui, du point de vue du bonheur, vaille mieux que les autres ?
- Duclos, académicien : « Le meilleur gouvernement n’est pas celui qui fait les hommes les plus heureux, mais celui qui fait le plus grand nombre d’hommes heureux ».
Ce qui importe, ce n’est pas la qualité du bonheur (aristocratie) mais la quantité des heureux (démocratie).
Texte de Tocqueville (De la Démocratie en Amérique) (106) (2) : le pire, ce serait que le pouvoir croie en son pouvoir de faire notre bonheur.
- Quels sont les principaux torts de la société décrite par Tocqueville ?
- Qu’ y a-t-il de pervers ici ?
- Une peur fantasque de Tocqueville ? une menace actuelle ?
« Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde : je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres : ses enfants et ses amis forment pour lui toute l’espèce humaine (…) Au-dessus de ceux-là s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, régulier, prévoyant et doux (…) il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. (…) que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ?
Alexis de Tocqueville De la démocratie en Amérique (1840)
Cependant, le bonheur échappe à la politique dans la mesure où il n’est pas possible de donner une définition du bonheur qui vaudrait pour tous.
d) le bonheur n’est pas définissable
Texte de Kant Fondements de la métaphysique des mœurs, 1785 (107): Hatier 1 p 434 :
L’aspiration au bonheur a beau être une aspiration universelle, elle admet un nombre illimité de contenus particuliers. Le bonheur est un concept indéterminé. Cela signifie qu’on ne peut pas déterminer de façon sûre et générale quelle action peut favoriser le bonheur d’un être raisonnable. Cette impossibilité vaut à deux niveaux :
1) on ne peut pas définir ce qu’est le bonheur pour un être raisonnable, quel qu’il soit
2) moi-même (individu) je ne peux pas dire avec certitude de quoi doit être fait mon bonheur (le « connais-toi toi-même » est un idéal inaccessible)
Une des conséquences en est qu’on ne peut fonder la morale sur l’aspiration au bonheur (bien qu’elle soit universelle). Il en découle que ni les hommes politiques ni les publicitaires ne peuvent nous dicter la voie pour y parvenir.
Pour Kant, « le bonheur est un idéal non de la Raison, mais de l’Imagination »
Idéal = norme, modèle / de la Raison = idée parfaitement déterminée et identique en tous les hommes / de l’imagination = l’individu ne sait pas exactement ce qu’il entend par là.
Pascal : « L’imagination dispose de tout ; elle fait la beauté, la justice, et le bonheur, qui est le tout du monde »
III. Liens entre bonheur et imaginaire
- A) Faire son bonheur
Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que le bonheur n’est pas une réalité matérielle et incontestable (pas quelque chose qu’on possède « pour de vrai » et une fois pour toutes) mais quelque chose qui existe grâce à l’imagination, et aussi grâce à la volonté: c’est dans la mesure où je veux être heureux que je peux l’être (si j’ai décidé que le film serait nul, il EST nul !)
Il n’y a pas de bonheur sans une volonté de jouissance, relayée par le travail de la conscience (cf. l’analyse de la femme frigide que fait Sartre dans L’Être et le néant : elle est frigide parce qu’elle a décidé de ne pas jouir)
Autre connexion entre Bonheur et Imaginaire : le bonheur comme « ravissement » : quand nous sommes heureux, nous sommes comme transportés hors de nous-mêmes, volés à nous-mêmes (avec l’impression de ne plus vraiment nous appartenir, voire : de ne plus être vraiment là).
C’est sur ce constat qu’on peut faire le pari que les vaches qui « broutent leur herbe » peuvent parfaitement être « bien » sans pour autant être heureuses : elles n’ont pas assez d’imagination pour être transportées. Il y aurait donc une distinction essentielle entre le bien-être et le bonheur.
B) le bonheur et l’art
Texte de Jankélévitch Quelque part dans l’inachevé (Kh L p 534) : de la musique comme « bonheur sans cause », qui provoque une légère ivresse (« griserie musicale »)
Même s’il y a toujours eu beaucoup d’artistes tourmentés, malheureux, le bonheur habite l’art dans la mesure où on trouve, dans l’art (pas dans tous les courants artistiques toutefois), une tentative d’enchantement du monde. C’est le cas du romantisme, par exemple : ce qu’il y a de petit, de mesquin, de raté dans la vie réelle est sublimé dans la littérature ou transfiguré par la peinture. L’art peut être conçu comme ayant pour vocation de donner au spectateur une sorte de bonheur spirituel (mais pas toujours : il peut vouloir ébranler, choquer, donner à réfléchir). Il peut y avoir une certaine idéalisation du réel (où ce qui devrait être tend à supplanter ce qui est) qui rejoint un certain type de discours politique.
C) Le lieu du bonheur en politique
Le lieu où est incarné l’idée du bonheur en politique est l’utopie : autant dire que ce lieu n’existe pas (u/topia). On pense peut-être d’abord au paradis terrestre : c’est le lieu (perdu) du bonheur parce que c’est celui de l’ignorance : Adam et Eve n’ont pas encore mangé le fruit de l’arbre de la connaissance. Citons aussi le pays fictif inventé par Voltaire dans Candide : L’Eldorado. Ou bien encore l’abbaye de Thélème, invention de Rabelais. De même, Diderot invente dans Le supplément au voyage de Bougainville un pays merveilleux : celui des Otaïti, qui constitue un anti-modèle dont la fonction principale est de dénoncer certains aspects de la civilisation européenne du XVIII ème siècle.
Malheureusement, les quelques tentatives réelles (historiques) d’établissement de l’utopie se soldèrent par une négation (quelquefois dans la violence) des libertés individuelles et certainement pas par une conquête collective du bonheur promis : Il semble qu’il y ait une contradiction profonde entre la perfection et la liberté : partout où la perfection est mise en œuvre, c’est au détriment de la liberté (on ne peut pas laisser les gens libres de suivre leurs inclinations et leurs projets individuels et s’attendre à les voir s’inscrire dans un ordre parfait, préconçu et idéal).D) le bonheur EST imaginaire
A la limite, on pourrait dire que tout bonheur est une expérience imaginaire (le plaisir procuré par la lecture d’un livre policier, par un film, le bonheur que Proust éprouve à voir ressurgir tout un pan de son passé à l’occasion de la consommation de sa « madeleine ») : il n’y a pas de jouissance (pas même sexuelle), sans l’intervention d’une bonne part d’imagination.
Mais quand je dis que le bonheur est une expérience imaginaire, je n’entends pas dire que le bonheur est une illusion : autant il peut y avoir de différence entre « avoir le sentiment d’être intelligent » (ce qui est le cas de la plupart des imbéciles) et être intelligent, autant il ne peut y en avoir entre le sentiment d’être heureux et le fait d’être heureux : celui qui se croit heureux l’est ; quiconque voudrait lui prouver le contraire perd son temps (et dévoile une certaine méchanceté).
Le bonheur existe donc sous deux formes : il est soit l’aspiration de tous (auquel cas il est une idée, issue de l’imagination, d’un état parfait) ; soit le sentiment qu’éprouvent certains et qui les place dans un état mental particulièrement agréable, même si chacun sait que ce « maximum » atteint ne peut l’être « pour toujours ».
IV. La temporalité du bonheur
Rousseau Les rêveries du promeneur solitaire : Hatier ES-S p 429 / Russ 20 p 270: le sentiment du bonheur provoque une sorte d’abolition du temps : le bonheur nous offre l’éternité.
Anecdote bouddhiste : un jour, quelqu’un vient voir le Bouddha et lui demande
– Maître, comment se fait-il que tes disciples, qui sont si pauvres, qu’on voit toujours mendier quelques grains de riz, comment se fait-il qu’ils soient tellement joyeux ?
Le Bouddha répondit :
- Ils ne regrettent rien du passé, ils n’espèrent rien de l’avenir, c’est pourquoi ils sont tellement joyeux.
(T L seulement) Pascal, Pensée 172 (Russ 5 p 204) : le présent est le temps de la jouissance, c’est-à-dire du bonheur. Mais nous sommes ainsi faits que nous le négligeons constamment, au profit de l’avenir : « nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais »
Alain, Propos sur le bonheur du 17 avril 1908 (108): « La danse des poignards »
CONCLUSION :
Le vrai contenu du bonheur, c’est la joie. Impossible de croire en une félicité permanente, continue, éternelle. Non : il y a des moments de joie.
Le bonheur est un espace de temps où la joie paraît immédiatement possible.
Non pas tout espace de temps où l’on est joyeux (car même lorsqu’on est heureux il y a des moments de tristesse, d’inquiétude et une foule de soucis) mais toute la durée où l’on a le sentiment que la joie peut être là d’un instant à l’autre.
A l’inverse, le malheur, c’est quand la joie paraît immédiatement impossible : lorsqu’on se dit qu’on ne pourrait être heureux que si quelque chose changeait dans l’ordre du monde (si je n’étais pas malade ; si mon enfant n’avait pas l’air de me détester, si j’avais un emploi) : je suis séparé(e) du bonheur par un « si ».
Expérience de pensée de « la machine à expérience » :
« Supposez qu’il existe une machine à expérience qui soit en mesure de vous faire vivre n’importe quelle expérience que vous souhaitez. Des neuropsychologues excellant dans la duperie pourraient stimuler votre cerveau de telle sorte que vous croiriez et sentiriez que vous êtes en train d’écrire un grand roman, de vous lier d’amitié, ou de lire un livre intéressant. Tout ce temps-là, vous seriez en train de flotter dans un réservoir, des électrodes fixées à votre crâne. Faudrait-il que vous branchiez cette machine à vie, établissant d’avance un programme des expériences de votre existence ? […] Bien sûr, une fois dans le réservoir vous ne saurez pas que vous y êtes ; vous penserez que tout arrive véritablement. […] Vous brancheriez-vous ? » (Robert Nozick, Anarchie, État et utopie)